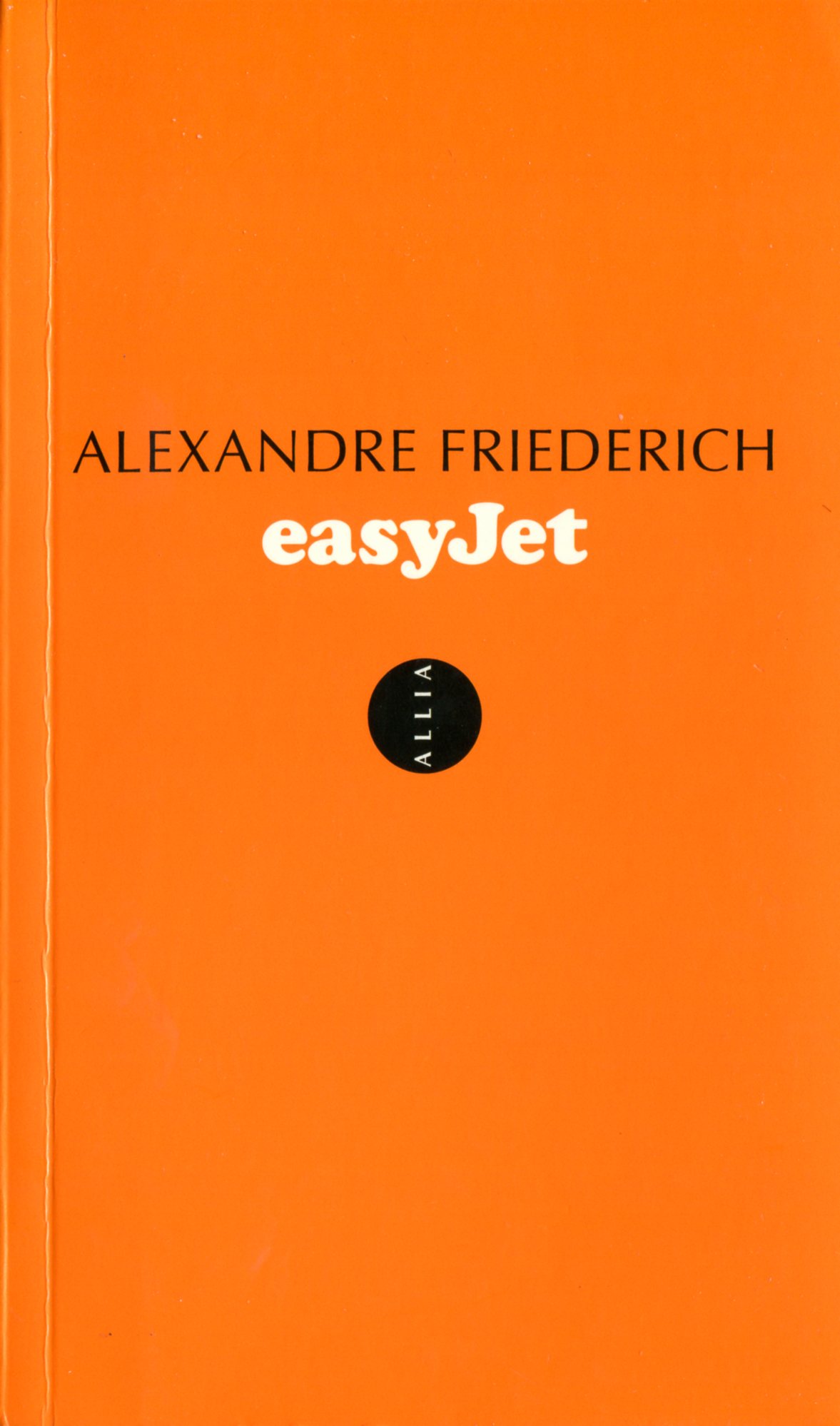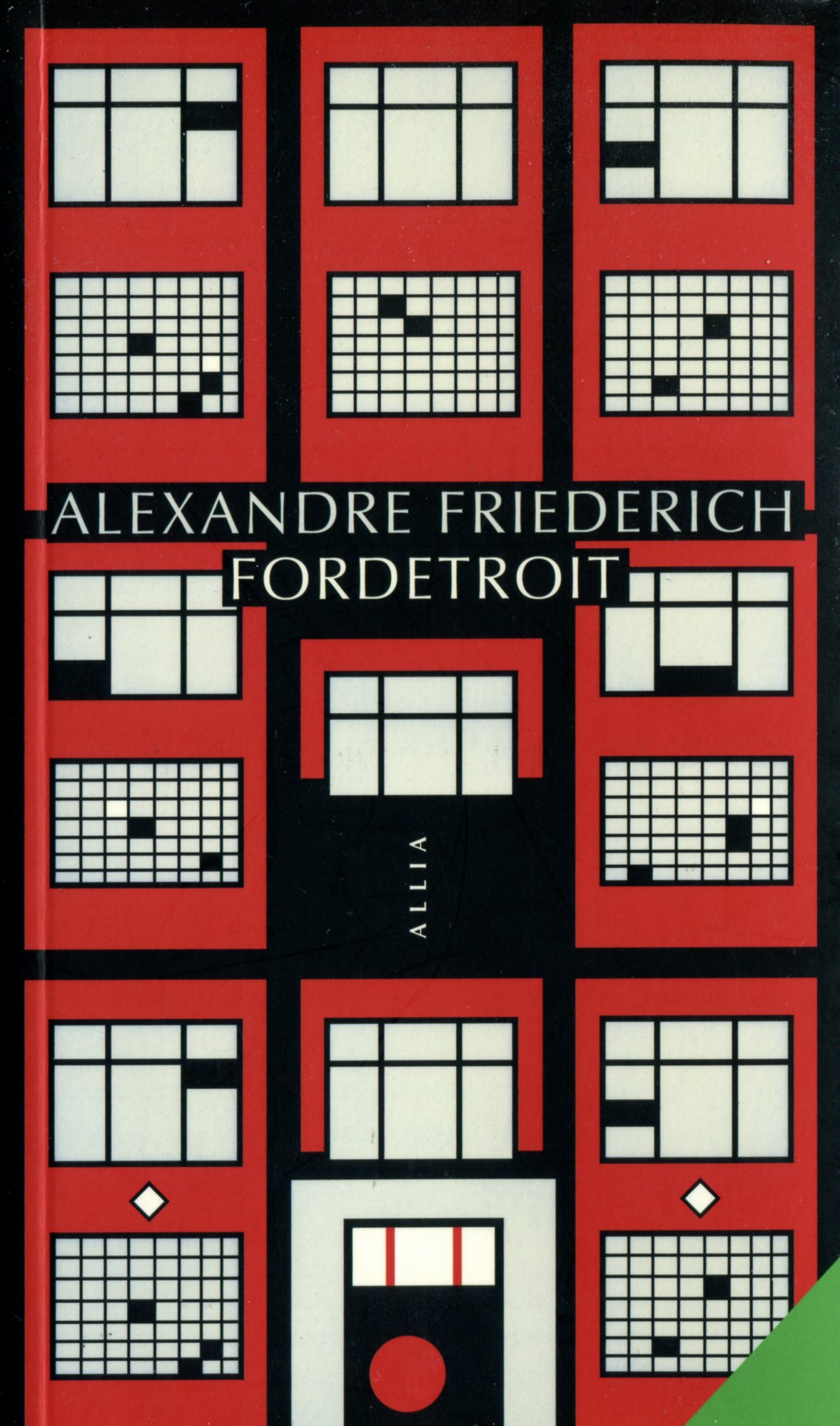Alexandre Friedrich ('easyJet' et 'Fordetroit'): quand le postcapitalisme se fait littérature
Très original, l’éditeur parisien Allia, des textes courts, des formats de poche aux couvertures design pour une collection éclectique où se côtoient l’Arétin, Sainte Thérèse d’Avila, Al-Fârâbi, Custine, Leopardi, De Quincey, Enzensperger, Lorca, Papaioannou ou Nietzsche. Tout est créatif, élégant et donne envie de lire.
À la librairie de la gare de Genève, j’ai trouvé deux livres, deux courts essais, d’Alexandre Friedrich (prix Dentan 2011 pour 'Ogrorog'), un des rares écrivains suisses qui, de manière méthodique, parle très précisément du monde dans lequel nous vivons, les deux livres publiés chez cet éditeur, les deux sur des réalités contemporaines que Friedrich teste et dont il étudie chaque aspect.
Dans easyJet (Paris : Allia, 2014), Alexandre Friedrich décortique le mythe et l’aspect marketing et se livre en passant à l’analyse complète – économique, sociologique, psychologique, historique – de toute une génération, qui, depuis 1995, date de la création de la compagnie et de ses nouvelles techniques de vente, prend l’avion comme le bus, sans se préoccuper des tenants et des aboutissants économiques ou environnementaux :
« Si easyJet possède aujourd’hui une flotte de 210 avions, elle n’était, au moment de sa création, qu’une compagnie virtuelle qui exploitait deux Boeing 737 en leasing et sous-traitait la totalité de ses opérations, des pilots aux préposés à l’enregistrement.
Le premier vol avec avion propriétaire a eu lieu en 1995. Il était à destination d’Amsterdam. à partir de 1998, easyJet procédera à des acquisitions-fusions qui expliquent le maillage actuel du territoire européen à partir de l’Angleterre et de la Suisse (55 destinations au départ de Genève). La négociation de ces plates-formes est un enjeu politique majeur pour la compagnie, car l’approche low cost consiste aussi à obtenir des avantages auprès des autorités aéroportuaires, à commencer par des tarifs préférentiels sur les services au sol (équipes de manutention, passerelles, salles d’attente), cela sans trop lâcher sur les fondamentaux : situations des pistes d’envol et d’atterrissage, créneaux de vols, taxes. Le passager a une valeur évidente dans cette guerre commerciale. Plus il y a de passagers statistiques, plus la compagnie a les moyens de faire pression sur l’aéroport. Et si ce n’est sur l’aéroport, sur la ville qui, à sont tour, fera pressions sur l’aéroport. Chaque touriste représente de fait un apport financier pour les municipalités. »
Dans Fordetroit (Paris : Allia, 2015), c’est la ville qui fut un temps la capitale automobile et le symbole absolu du capitalisme américain qu’Alexandre Friedrich visite en tant que phénomène sociologique :
« Puissante, fière, populeuse, toute en perspectives, portant sur le corps cette étrange patine que donne l’argent, elle était dans les années trente la ville nouvelle qui incarnait les promesses du capitalisme de masse. Chaque jour cinq mille immigrants foulaient les quais de sa gare centrale, monument implanté sur Michigan avenue. Derrière les marques universelles que sont General Motors, Chrysler et Ford, plus de cent fabricants construisaient des automobiles. Les ouvriers se bousculaient, l’investissement explosait : apparaissaient les premiers gratte-ciel, monstres rectilignes aux parures art-déco, et un modèle de logement empilé qui ferai recette : les appartements. Les vedettes fréquentaient théâtres et dancings, les trottoirs menaient aux boutiques et au premier grand magasin au monde, le J.I. Hudson’s Department Store, édifice de trente-trois étages bâti sur Woodrow avenue. Une ruée : en trois décennies la population a sextuplé. À la veille de la Deuxième Guerre, elle atteignait lemillion et demi. La ville était un phare. Ford, un prophète. La classe moyenne, à l’aise dans son toc, ses lumières, ses lois : l’ouvrier à la chaîne avait un salaire enviable, un habit sain, une éducation et une automobile. »
Pas de grandes phrases, pas de chichis, c’est précis, documenté, méthodique : un portrait chinois, une psychanalyse fouillée et une déconstruction passionnante de notre réalité, celle du citoyen-consommateur contemporain manipulé par le Big Brother du marketing.
©Sergio Belluz, 2018, le journal vagabond (2016).
A découvrir aussi
- Henri Roorda: conseil aux écrivains inquiets
- La vie ou le 'Train fantôme' de David Collin
- À la Radio Télévision Suisse, Alice s'émerveille quand Manuella Maury m'a fait le coup du lapin...
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 113 autres membres