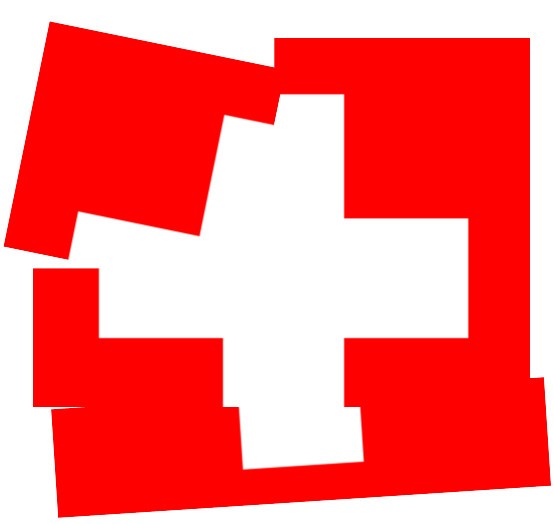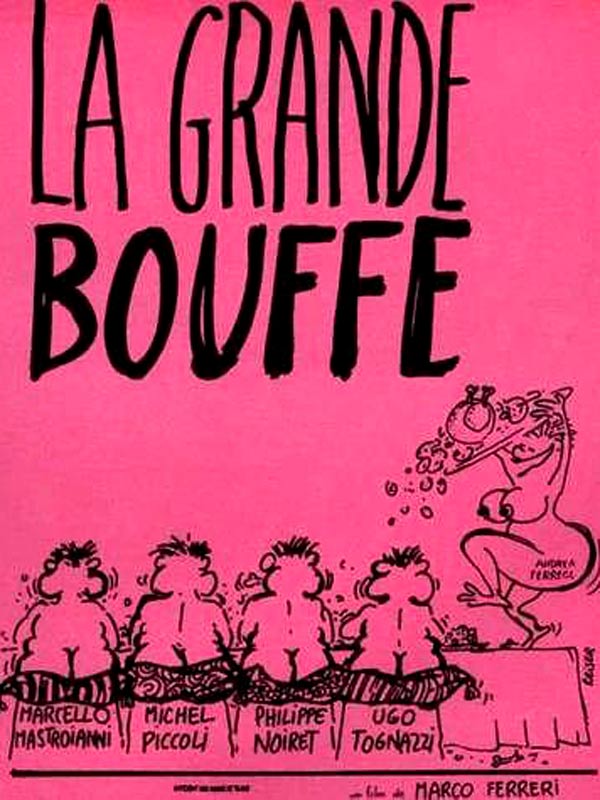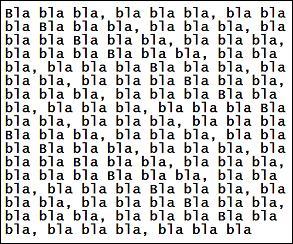* je pense donc je Suisse *
Le Professeur de Rougemont aux climato-sceptiques : « Jeux de nains, jeux de vilains »
« …Mesdames et Messieurs, chères confrères et sœurs, je voudrais d’abord remercier chaleureusement les organisateurs du Congrès Lausannois International sur le Changement Climatique (CLIC), de m’avoir invité en ces temps très graves de mutations accélérées dans la météo du pays, voire du monde.
Je me présente : je suis le Professeur Wilfrid-Adalbert-Stanislas-Frédéric-Alexandre de Rougemont, climatologue, ethnologue, rhumatologue et antiquaire.
Je suis l’auteur, entre autre, d’un ouvrage intitulé « Mais pourquoi ma glace pistache fond-elle aussi vite que le glacier d’Aletsch ? » qui se veut un poignant cri d’alarme international sur le plan du changement climatique, mais aussi sur le plan de la protection du secteur glacier, qui emploie non seulement une main d’œuvre qualifiée – qualifiée de compétente, en tout cas – mais qui, pour sa matière première, fait travailler les meilleurs pistachiers du monde, en particulier tout un collectif pistachier sensible aux importants enjeux actuels et qui cueille délicatement, une à une, les soirs de lune descendante exclusivement, et après incantations au chaman du coin – à ne pas confondre avec le charmant du coin, je vois déjà s’allumer quelques pupilles lubriques dans la salle – et qui cueille, disais-je, la pistache biologique nécessaire à la fabrication correcte et respectueuse de l’environnement de la glace susdite.
J’aime beaucoup la glace à la pistache.
Mesdames et Messieurs, chères confrères et sœurs, l’heure est grave : il est très clair que nous assistons aux premiers signes avant-coureurs d’un réchauffement général de la planète et d’une fonte dramatique des glaces à la pistache.
Selon mes propres expériences, il s’agit même d’un processus, oui, Mesdames et Messieurs, chers confrères et sœurs, j’ose l’affirmer, d’un processus ir-ré-ver-sible, ce dont chacun de nous a la preuve dans d’autres aspects de la vie de tous les jours, je pense en particulier à certains membres de ma famille qui, souffrant d’une pépie chronique – diagnostiquée très tôt, heureusement – se sont vus contraints, suite à l’assèchement progressif des nappes phréatiques que nous connaissons tous, de piocher désespérément dans leur réserve de Saint-Émilion premier cru à des fins thérapeutiques, en particulier tante Gertrude, que je salue au passage, et qui doit encore être en train de cuver – de couver, pardon – une pathologie qui sera de plus en plus prononcée vu les circonstances actuelles.
En ce qui me concerne, je ne donne qu’un seul exemple, pris au hasard : La Prussienne, ma propriété de famille sise à Saint-Aubin depuis trois siècles, parmi les saules pleureurs des riantes rives du Lac de Neuchâtel, ville et canton à qui la pratique du protestantisme a pourtant inculqué de longue date, dans l’ensemble de ses activités et de ses manifestations, une sobriété qu’une immigration étrangère incontrôlée n’a pas encore réussi à pervertir totalement.
Eh bien, par diverses expériences et observations dont je vous passerai les détails techniques, mais qui incluent des contrôles journaliers au moment d’arroser mes géraniums, mes rhododendrons, mes pétunias et mes mimosas, j’ai pu constater in situ de visu et à mon grand désespoir, que dans le vaste parc arborisé de ma chère Prussienne le réchauffement climatique faisait irrémédiablement fondre un à un toute une population de nains de jardin, la collection d’une vie entière consacrée à ces petits êtres joyeux et protecteurs quoique sans défonce, je veux dire sans défense, dont l’étude assidue m’avait permis d’écrire un pamphlet très remarqué en son temps intitulé « Lever le nain et dites ‘Je le jure’ ».
Alors je pose la question : que fait Amélie Poulain ? »
©Sergio Belluz, 2022, le journal vagabond (2022)
Genève sur Fellini
Hier après-midi, longue promenade à Genève depuis le quartier des Eaux-Vives jusqu’à Hermance.
J’ai marché jusqu’à Genève-Plage, puis ai pris le bus E, et ai visité Hermance, avec son vieux village aux balcons de bois, sa tour de guet, et son tea-room, où j’ai pris une ‘ovomaltine’ chaude qui faisait du bien avec ces froids (il y avait de la bise, et le ciel était gris lumineux, le lac agité).
On passe Genève-Plage (une plage populaire de Genève, avec tremplin), le Port-Noir, où un monument rappelle que « Les Suisses » ont débarqués ici en 1814, reprenant Genève (sur sa demande) aux Français de Napoléon.
On passe aussi le Parc de la Grange, avec sa belle maison Lullin – une sorte de grande « campagne », dont on voit bien l’organisation : la résidence des maîtres, les communs autour, la grande entrée côté lac, avec ses lions –, le Parc des Eaux-Vives...
On devine la très chic Cologny qui surplombe le lac, et sa Fondation Bodmer.
Le tronçon Cologny-Bellerive-Collonge-Villars-Hermance s’est beaucoup construit, des tas de villas modernes tout confort, et assez moches, dont les prix oscillent autour des deux millions...
Je me demande toujours comment ces prix sont supportables pour la population ?
Et surtout, jusqu’à quand le pauvre péquenot va pouvoir survivre avec des prix pareils ?
Côté Eaux-Vives, une toute nouvelle gare desservira la banlieue française de Genève côté Annemasse.
J’ai regardé les prix des loyers à l’agence en face de la nouvelle gare, celle du Grand Entrepreneur avec majuscules, dont le nom apparaît partout en grandes lettres, toujours aussi mégalomane y compris dans les descriptifs de ce qu’il vend ou met en location...
Ça doit correspondre à un gros complexe social, chez lui.
Manque de pot, la classe ne s’achète pas.
Et c’est effarant, des CHF 2500.- mensuels minimums pour un deux pièces genevois (c’est à dire un « une pièce-cuisine », puisque la cuisine compte pour une pièce à Genève).
Me revient alors un souvenir de ma mère, qui avait travaillé dans le luxueux bureau du père de l’entrepreneur – « je me suis fait tout seul », affirme-t-il partout –, au centre de Lausanne, et qui me racontait que le fils alors très jeune, arrivait en pantalons blancs souillés au bureau de papa (elle ne précisait pas souillé par quoi).
Je me souviens aussi d’un reportage de L’Illustré – magazine d’un goût toujours douteux en tout, y compris dans la façon de rédiger... – où l’on voyait le Grand Entrepreneur « dans sa grande propriété de... » avec sa compagne, une espèce de vamp noiraude à robe léopard, le sein débordant, le rouge à lèvre brun largement entouré au crayon, l’oeil (avec énormes faux-cils) souligné trois fois de noir, et la chevelure sombre, léonine et sauvage.
« La Lionne », comme dirait Sylvie Joly.
Une lionne qui avait toute la féminité exubérante et débordante de partout d’une Anita Ekberg latine imaginée par Fellini et revue par John Waters.
L’idéal pour un Grand Entrepreneur qui s’est fait tout seul.
©Sergio Belluz, 2019, le journal vagabond (2018)
Un moment à Chêne-Bourg
Juste après une pause à la buvette de la Place Favre, je me promène dans ce qui reste du vieux Chêne-Bourg en banlieue de Genève.
Il y a une pizzeria avec une belle terrasse à l’ancienne, pleine de géraniums à l’extérieur, ça s’appelle ‘La Tarantella’.
En passant devant, j’entends parler napolitain, c’est bon signe.
Un peu plus loin, une gare CEVA (le RER genevois) est en train de surgir sur l’arrêt Chêne, le lieu de l’ancienne gare qui longeait le tracé de la ligne française de train, partant de la Gare des Eaux-Vives pour Thonon et Évian.
Autour de cette gare en devenir, des vestiges de ce que fut le village de Chêne-Bourg, une très jolie maison qui doit dater du début du XXe siècle, sur laquelle on lit « Anciennement École de Musique ».
Le mot « anciennement » a été rajouté après, probablement parce qu’on ne pouvait pas effacer « École de Musique ».
Qu’est-ce qu’elle pouvait bien offrir comme cours, à son époque, cette École de Musique ?
Il y a aussi une trattoria, le ‘Borgia’, avec une belle terrasse cachée derrière.
Plus loin encore, une École Montessori squatte une petite maison de village. Comme il fait chaud, les fenêtres sont ouvertes, on voit bouger de beaux rideaux rouges.
Toutes ces maisons ont leur bout de verdure, derrière et, devant, leur portail pour y accéder.
C’est toujours ce qui me frappe, à Genève, ces poches anciennes qui résistent quand même à la spéculation et que des chanceux (ou fortunés) habitent.
©Sergio Belluz, 2019, le journal vagabond (2018).
Pauvre Suisse.
La richesse et la pauvreté, ça va, ça vient, en Suisse comme ailleurs. Toute l'Europe est en voie de paupérisation, Suisse comprise. On sabre à l’avance dans les programmes sociaux, dans l'éducation, dans la santé.
Sans parler d’assurances maladies exorbitantes et de contrats temporaires aux pires conditions salariales et horaires, des chiffres récents et officiels parlent, dans leur sabir à euphémismes techniques, de 400 000 Suisses recensés comme vivant au dessous du minimum vital (un barème administratif et donc arbitraire de M. Prix, fixé à Frs 2200.- par mois...), et de 600 000 Suisses vivant à la limite du minimum vital.
Ça fait quand même un million de personnes, un 7e de la population qui tire le diable par la queue pendant que des politiciens indifférents et de toutes tendances et couleurs (rouge, rose, vert, noir) pérorent sur la défense des valeurs helvétiques, sur l'Etat-nation, sur l'Union européenne, sur l'utilité de ne pas mêler l'Etat à la liberté de commerce et sur les prétendues régulations automatiques du marché de l'offre et de la demande.
Au même moment, des étudiants de l'Université de Genève logent dans des sous-sols, dans des chambrées avec lits à étage (la chambre d'étudiant, quand on en trouve une dans ce merveilleux marché de l’offre et de la demande qui s’autorégule, se dealant à Frs 1200.- en moyenne).
Quant aux gérances immobilières autorégulées elles aussi selon la loi naturellement équilibrante de l’offre et de la demande, on exige de ceux qui s'y inscrive pour un quelconque appartement trop cher et tout ce qu'il y a de plus cage-à-lapin, de fournir – à part les habituels certificats de salaire et autres copies payantes d'extrait de l'Office des poursuites, de toute façon caduques après trois mois –, une lettre de motivation qui servira peut-être à avancer d'un rang sur la liste dont les premiers sont ceux inscrits, moyennant finance, au ‘Club Prestige’ de la gérance.
La vraie question c'est: qu'est-ce qu'une société? Un système juridique artificiel créé pour favoriser l'enrichissement de quelques-uns connus ou anonymes (grandes familles ou multinationales) au détriment de la majorité? Ou une communauté d'intérêts (historiques, culturels, économiques), permettant aux uns de s'enrichir tout en enrichissant les autres, favorisant ainsi une certaine équité à tous les niveaux?
©Sergio Belluz, 2017, le journal vagabond (2014).
Malbouffe sans va-t-en guerre, mironton, mironton, mirontaine.
Je suis très étonné de voir à quel point la dimension sociale ou familiale des repas est en train de disparaitre. Les trains suisses, par exemple, sont devenus des aires de pique-nique, on y transporte son rata dans des tupperwares, on a son thermos pour le café (quand on ne l’a pas acheté sur le quai) et, en mangeant son repas, on écoute la radio ou de la musique sur oreillette, bien en soi, bien isolé, bien ignorant du monde extérieur et de son voisin.
Les frontières entre la vie privée et la vie sociale, ou plutôt les limites de la sphère privée se sont extraordinairement modifiées : ce qui, auparavant, était considéré comme indécent, manger en public, par exemple, est presque devenu la norme, sans doute à cause de la pression de nos sociétés, pour lesquelles le temps doit être comptabilisé au plus grand profit de l’économie, et qui considèrent que ces pertes de temps humaines (vivre, manger, dormir, faire l’amour, déféquer...) doivent être limitées au maximum, par des horaires, des contrôles, des timbreuses, des interdictions, des impossibilités matérielles...
Du coup, ce domaine « privé » empiète de plus en plus sur le domaine « public ». On gagne du temps en mangeant, pendant le trajet de bus ou de train, sa salade achetée à la Migros du coin, et on déjeune dans le train puisque « pour gagner du temps » on s’est levé juste à temps pour se doucher et pour partir.
Il n’est pas loin le temps où, pour des questions rationnelles et tout à fait défendables (déplacements inutiles, crise du logement, coût des bureaux, etc...), on généralisera le télétravail, chacun dans sa bulle productive.
Comme des poules en batterie.
©Sergio Belluz, 2017, le journal vagabond (2016).
Le retour du Moumy.
Hier, j’ai eu un moment la compagnie du « Moumy », le surnom temporaire d’un chat de quartier qui vient chaque jour, s’installe, mange, ronronne, jusqu’à ce qu’il faille s’en aller. On lui a ménagé des sortes d’étapes dans l’appartement (avec linges à son odeur).
Il y a le lit (avec deux couvertures, dont une rouge où il aime se vautrer), le bureau, et, dans le salon, son petit coussin avec son linge bleu sur le canapé – et aussi une chaise (la partie sous la nappe de la table).
C’est un chat noir et blanc, très poilu, pas du tout agressif, confiant, qui ronronne très vite et bave quand on lui fait ses gratouilles.
Il y a quelque chose de rassérénant dans le ronronnement d’un chat, quelque chose de primal et de fondamental, comme une vibration ancestrale qui va au-delà du simple contentement (ou d’un simple système de défense) du chat.
Et je lui parle, à ce Moumy, et il m’écoute. Quand je lui dis : « Reste-là » (sur son coussin du canapé, au salon), il y reste, et ne me suit pas.
Je passe ma main sur lui de la manière la plus absorbante possible, je sens sa vie, sa chaleur, sa vibration, j’absorbe et je donne.
Je pense à la phrase de Cocteau : « Ce n’est pas vous qui caressez le chat, c’est le chat qui se caresse à vous », et je me dis que dans mon cas, ce n’est pas tout à fait exact.
©Sergio Belluz, 2017, le journal vagabond (2014).
Tata Bijou.
Le taux de verbiage contemporain atteint des sommets vertigineux.
Une dame, montée dans le train à Brig avec sa petite fille, a passé tout le trajet Brig-Lausanne à appeler tout son monde, et surtout « Tata Bijou », pour lui dire de venir l’attendre à la gare, en lui disant qu’elle la rappellerait pour lui donner plus de détails.
Elle demande ensuite au contrôleur de lui préciser sur quel quai elle arriverait, et aussi dans quel wagon elle se trouvait.
Puis elle rappelle Tata Bijou pour lui expliquer en accentuant toutes les terminaisons, qu’il faut quelle vienne ab-so-lu-ment l’attendre au quai 7, et pour lui préciser qu’elle se trouve dans le wagon 4, « le wagon, c’est comme une voiture, et alors tu comptes 1, 2, 3, 4 et tu arrives au numéro 4, tu as compris ? C’est très im-por-tant que tu viennes, tu com-prends ? ».
Elle a ensuite appelé une autre de ses amies pour lui expliquer toutes ses vacances en long et large et en travers.
La faute à un forfait téléphonique illimité et à un degré zéro illimité de la communication, sans compter la communication non verbale de la petite fille qui s’emmerde pendant que maman blablate, et qui, pour attirer son attention, fouille dans le sac de sa mère, vide toute sa trousse de toilette ou tape sur la tablette pliable du train.
Mais un très joli trait de la gamine. La mère dit, pour je ne sais quelle information supplémentaire : « Je vais demander le contrôleur » (elle va le chercher et revient l’attendre à sa place). La petite : « alors, le contrôleur, il a dit quoi ? – il arrive. – il arrive où ? »
©Sergio Belluz, 2017, le journal vagabond (2014).