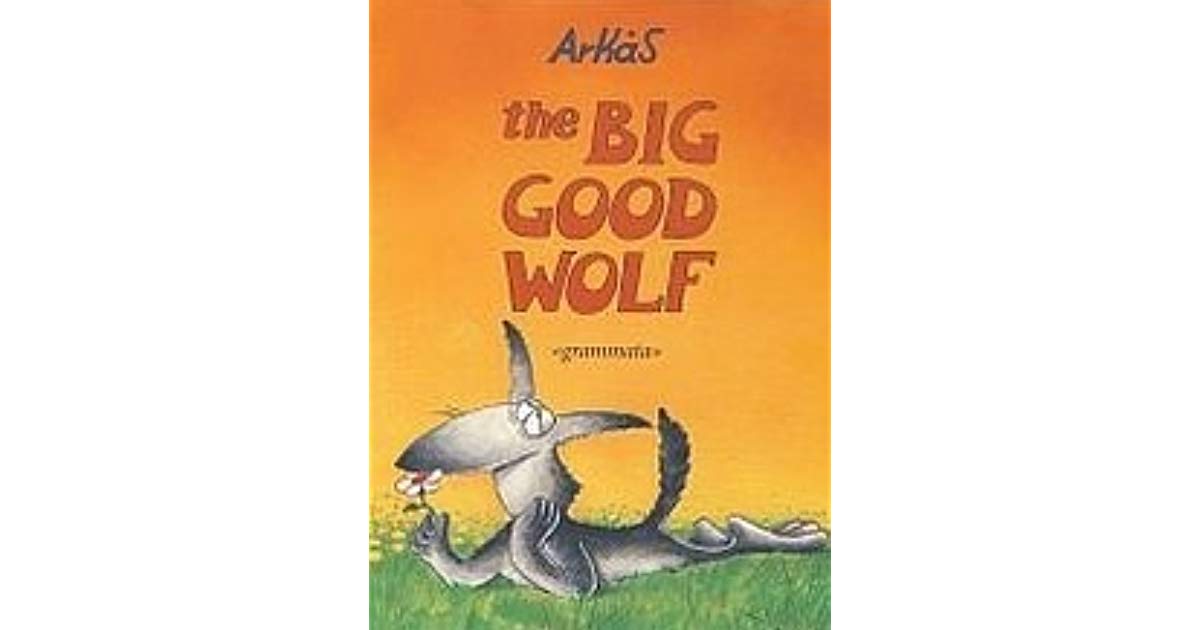* les rêveries vagabondes *
Obélisque et gratte-ciel, même combat
Une expo sur la civilisation de l’Égypte antique.
Évidemment, c’est un monde fascinant d’un point de vue esthétique, élégant, mystérieux, entre ésotérique et animiste, avec ses corps humains à tête d’animaux (Horus, Tabet, Anubis...) ou inversement (le Sphinx).
L’expo était plutôt une sorte de voyage dans l’Égypte des pharaons articulée autour de différents thèmes : la longue histoire, depuis trois mille ans avant Jésus-Christ, liée au Nil et à la fertilité des terres, les territoires égyptiens – la Haute et Basse Égypte, avec la Nubie –, les rapports avec les royaumes assyrien, hittite, puis grec et romain, le rôle politique et religieux du pharaon, intermédiaire entre les Dieux et les hommes, et qui, à sa mort, devenait lui-même le dieu Osiris, le rôle des prêtres, les symboles du pouvoir dans la représentation (statuaire, fresques, objets, bijoux), les rites mortuaires...
On se promène dans cette culture antique et exotique avec un sentiment de familiarité superficielle qu’on doit souvent aux films à gros budgets – ceux de Cecil B. De Mille, Les Dix Commandements avec Charlton Heston ou Cléopâtre, avec Claudette Colbert, ou encore la version de Mankievicz avec Liz Taylor –, et, en Europe, pour ma génération, aux bandes dessinées (Tintin, Astérix, Blake et Mortimer, Alix, Papyrus)...
Il y a aussi, pourtant, ces rites si anciens et si primitifs autour de la mort.
C’est un peu comme les cultures Maya ou Aztèque : une esthétique séduisante que l’homme moderne reconnait, et qui lui parle par ses formes géométriques sans qu’on sache bien pourquoi, toute une iconographie par laquelle s’exprime aussi une civilisation plus sommaire, plus cruelle.
Mais, après tout, nos impressionnants gratte-ciel à nous et leur belle élégance rectangulaire d’obélisques financiers à la gloire du Capital, cachent aussi de nombreux massacres...
©Sergio Belluz, 2019, le journal vagabond (2018)
L'Opéra en taxi
Assez fatigué, hier : une longue journée.
Le temps de prendre le train Lausanne-Genève vers 22.20 (un omnibus...), je suis arrivé vers 23.30, plus tôt que prévu, dans ma lointaine banlieue, parce que je me suis offert le luxe d'un taxi .
L’idée de devoir attendre encore un bus et de devoir en plus marcher depuis l'arrêt jusqu’à la maison me décourageait d’avance.
Je suis tombé sur un chauffeur de taxi noir (Éthiopien ? Érythréen ?) qui écoutait de l’opéra, un duo magnifique soprano-mezzo d’un opéra allemand que je n’ai pas reconnu, et qui doit être du début du XXe siècle, peut-être du Richard Strauss ? Absolument extraordinaire de beauté, et surréaliste à ces heures-là, en taxi.
Ce n’est pas tant le conducteur noir qui rend la chose surprenante – en discutant, il me dit : « Je n’écoute que du jazz et du classique » –, mais le fait qu’on puisse écouter de l’opéra en taxi.
D’ordinaire, on se tape les infos en continu, ou alors la soupe habituelle techno-pop-rock.
Là, on a fait le trajet sur un air d’opéra sublime, aux harmonies qui me faisaient penser au duo de Lakmé de Delibes.
Et le fait que je n’arrive pas à replacer cet air, à trouver le compositeur – allemand? autrichien? –, le fait que ces deux voix chaudes, celle de la soprano et celle de la mezzo, s’appariaient, se mêlaient en un duo triste et passionné, et ma fatigue accumulée ont rendu magique et hors du temps ce trajet lyrique d’une demi-heure.
Nous avons fait un beau voyage.
©Sergio Belluz, 2019, le journal vagabond (2018)
P. S.
Un de mes lecteurs a pu me donner les références de ce magnifique duo: il s'agit de celui d'Arabella et de Zdenka, dans Arabella de Richard Strauss.
Impossible de résister à la tentation de mettre un lien à un extraordinaire enregistrement de ce duo par les sopranos Barbara Bonney et Karita Mattila:
* * *
Giuditta Pasta par Karl Bryullov
L’émotion, valeur marchande
Je me rends compte que si d’aventure quelqu’un lit mon journal vagabond dans un siècle, ce quelqu’un sera en droit de se demander pourquoi les grands événements, et en particulier les grandes catastrophes, y apparaissent aussi peu, et plutôt en filigrane.
Je pense, par exemple à ce pont d’autoroute qui s’est écroulé à Gênes et qui a fait une vingtaine de morts ou à l’incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris.
C’est que si je lis quotidiennement de multiples médias écrits, version papier ou en ligne, j’évite l’information mise en scène par les médias audiovisuels, la télévision, en particulier, qui, dans son ambivalence de média de divertissement et d’information tout à la fois, trie dans les infos ce qu’elle considère de plus vendeur et donc de plus payant.
Je trouve qu’à chaque grand événement c’est le même cirque, je ne trouve pas d’autre mot.
Côté public (et audience), on sent un besoin frénétique d’émotion et d’émotionnel pour se rattacher à quelque chose, pour partager une indignation, une tristesse ou une joie.
La patrie ou les héros n’existent plus, alors le moindre événement suscite des bougies sur le lieu concerné, des rassemblements, des déclarations à la radio ou à la télévision, et les politiciens ne sont pas en reste, toujours à la recherche d’opportunités pour se profiler.
Les médias, tous les médias, réseaux sociaux compris – « i social » comme on dit en Italie – s’emparent de tout ça, dramatisent tout ça, utilisent tout ça pour de l’audience.
C’est le fonctionnement des médias, de toute façon, mais je trouve que c’est exacerbé, aujourd’hui, et je n’ai aucun besoin de ça.
Ce battage ne me touche pas.
Des catastrophes humaines ou naturelles, il y en a toujours eu, mais aujourd’hui, tout est prétexte à émotion, et, forcément, à publicité et à fric, et c’est trop.
Mon émotion est aussi forte et aussi réelle que celle de tout le monde. Mais mon émotion m’appartient et je n’ai aucune envie de l’étaler ou de m’en servir.
Et cette émotion n’est d’aucune utilité pratique pour ceux qui sont vraiment utiles, les secouristes ou les pompiers.
©Sergio Belluz, 2019, le journal vagabond (2018)
Le mieux (ou pas), bis: 'Words, words, words' écrivait Shakespeare
Les traducteurs et tous ceux qui travaillent avec plusieurs langues le savent : utiliser Microsoft Office, et Word en particulier, avec ses corrections automatiques configurées et liées à un dictionnaire dans une langue par défaut est une vraie gageure quand on passe d’une langue à l’autre ou quand on rédige un texte contenant des extraits d’autres langues.
C’est d’ailleurs le même casse-tête depuis un smartphone, lorsqu’on communique avec différents interlocuteurs dans différentes langues, car le correcteur par défaut récrit ce que vous venez de rédiger selon la langue présélectionnée, et on se retrouve à envoyer, au final, des SMS ou des messages whatsapp bourrés de fautes qui ne sont pas toutes à mettre sur le compte d’un gros doigt maladroit appuyant sur la mauvaise lettre (il y aurait aussi beaucoup à dire au sujet de ces claviers où c’est toujours la lettre d’à côté qui sort quand on en vise une autre).
Ces difficultés sont liées, pour une bonne part, aux conventions typographiques de chaque langue.
Par exemple, en français, en allemand, en italien ou en anglais, l’usage et la façon de présenter les guillemets varie complètement d’une langue à l’autre : le français utilise les « doubles chevrons », l’allemand met une double virgule en bas avant et conclut ensuite par une autre double virgule en haut, l’italien utilise les chevrons à la française pour les citations mais les doubles apostrophes à l’américaine pour mettre un mot en exergue et l’anglo-américain oscille selon les contextes entre les deux virgules en haut, simples ou doublées, encadrant la phrase ou le mot.
De même, il y a des variations irrationnelles liées aux ponctuations et aux espaces qui suivent les ponctuations : virgule ou pas après une incise encadrée par des tirets dans une phrase – le français met la virgule après, pas l’anglais (comme vous pourrez le constater à la fin de cette incise) –, simple ou double espace avant ou après les points-virgules ou les deux points.
Concrètement, en temps que professionnel de l’écriture et des langues, et que ce soit sur smartphone ou sur ordinateur, on passe son temps à chercher dans les différents menus – les dictionnaires par défaut et les corrections automatiques sont éparpillées sans cohérence dans de multiples menus et sous-menus aux logiques et aux titres mystérieux –, pour « décocher » toutes les fonctions par défaut et, en tant que spécialiste avec réputation, s’éviter des résultats catastrophiques et humiliants dans des textes professionnels ou publics.
La difficulté se corse encore après chaque nouvelle version des applications, qui, il faut aussi le dire, ne sont pas nécessairement des améliorations de la précédente, malgré tout le boniment dont sont capables les services marketing des grandes entreprises informatiques.
Prenons la nouvelle version de Word, et notamment la fonction « Tableau » : vous voulez faire un tableau avec des lignes et des colonnes. Dans l’ancienne version de Word, il y avait un menu « Tableau/Insérer », on choisissait ensuite le tableau, pour moi, le « classique », transparent – les lignes et colonnes apparaissent à l’écriture mais pas à l’impression –, et le tour était joué.
Maintenant, le menu « Tableau » n’existe plus, on doit aller sur un menu « Mise en page », puis on doit choisir « Tableau » (il y a toute une liste dans laquelle on ne trouve plus le « classique »), et il faut ensuite aller sur une autre icone/fonction et choisir une option « effacer les bordures ».
De même, sur l’ancienne version de Word, il y avait une fonction symbolisée par une loupe qui permettait de visualiser la page sur laquelle on était en train de travailler juste avant l’impression, et de corriger l’original au fur et à mesure. Maintenant, il faut aller d’abord dans le volet « Imprimer » pour que le texte se visualise avant impression, puis revenir à la page de départ pour faire les éventuelles corrections.
On nous fait toujours croire, pour nous vendre à chaque fois un nouveau produit, qu’il y a des améliorations, comptant sur le fait, avéré, qu’une fois qu’on a une nouvelle version, on ne se souvient plus de l’ancienne.
Et bien ce n’est pas vrai en tout. Moi qui travaille, par économie, sur des fichiers .doc (Word 2003) à la maison, et sur Word 2007 dans d’autres contextes, je vois très bien ce qui change, et ce n’est pas forcément mieux.
Il y a même des bugs idiots qui se rajoutent, du genre : dans les dernières versions de Word, quand on met trois astérisques qui se suivent sur une ligne et qu’on fait un retour de ligne, les trois astérisques se changent automatiquement en une ligne de points intempestive. Pour s’en débarrasser, il faut supprimer cette fonction par défaut dans le menu « option de style automatique ».
En somme, si le mieux est l’ami (très rentable) de l’entreprise informatique, il reste souvent l’ennemi du bien du consommateur pris en otage et qui peut choisir de s’accrocher à des anciennes versions, dont il sait, malheureusement, qu’à partir d'une certaine date elles ne seront plus compatibles avec les nouvelles, ce qui va le forcer, à plus ou moins court terme, à se mettre à jour.
Business is business.
©Sergio Belluz, 2019, le journal vagabond (2018).
Le mieux (ou pas)
J’ai eu l’occasion, en Espagne, de tester un nouveau modèle de Ford, avec plein de gadgets et je me suis fait un remake de ‘Mon Oncle’ de Jacques Tati à moi tout seul.
Les clés de voiture ne sont plus des clés mais un bout de plastique plein de boutons qui servent à ouvrir et fermer les portes, celle du coffre compris.
Une fois la voiture débloquée, les rétroviseurs se déploient vers l’extérieur.
Pour démarrer la voiture, il suffit de presser d’un doigt décidé le bouton d’embrayage.
Les phares s’allument alors, et se règlent automatiquement, s’adaptant à la luminosité ambiante.
Le GPS se met aussi à fonctionner automatiquement, une carte locale apparaît sur un petit écran entre les deux sièges avant (bonjour le mal de mer pour ceux qui ont une bonne vision latérale).
Sur le levier de vitesse, la marche arrière se trouve tout à gauche en haut au lieu de tout à droite en bas, il y a six vitesses au lieu de cinq, mais en réalité la cinquième vitesse a été subdivisée.
Dès qu’on est en marche arrière, une petite caméra s’allume et on peut suivre la progression de sa manœuvre sur le petit écran, avec des sortes de rails virtuels.
Si le mur ou une voiture se rapproche trop, un signal d’alarme s’enclenche.
On peut aussi brancher une voix de synthèse à qui on donne des ordres en espagnol, ce qui cause des situations cocasses : le GPS fonctionne avec l’espagnol castillan alors que j’ai un accent espagnol de Colombie et prononce comme un ‘s’ les phonèmes ‘z’, ‘ce’ ou ‘ci’.
Selon les mots utilisés, l’ordinateur ne comprend pas ce que je lui demande, d’où l’obligation pour moi, suivant ce que je dis, de contrefaire un accent espagnol qui ne m’est pas naturel.
C’est comme si, en étant suisse, belge, québécois, camerounais, ch’ti ou marseillais, on devait s’efforcer de prononcer les choses à la parisienne pour que l’ordinateur comprenne.
On n’arrête pas le progrès, c’est sûr. Le GPS est bien pratique, l’aide au parcage en marche arrière est utile.
Quand même, me demandé-je, dubitatif : est-ce qu’on ne perd pas quelque chose à avoir une confiance absolue dans des gadgets, dans des robots ?
Que se passe-t-il quand l’ordinateur de bord est en panne ou que les senseurs ne fonctionnent plus ?
Est-ce qu’on sait évaluer les distances et la taille de son véhicule au moment du parcage ? Est-ce qu’on est encore capable de se situer dans l’espace et de trouver son chemin tout seul en regardant autour de soi, en lisant une carte ou en suivant la signalétique ?
Ces nouvelles voitures, on ne les sent plus. C’est confortable, automatisé, insonorisé, à tel point qu’on ne se rend même pas compte qu’on roule en première à soixante kilomètre-heure.
Plus rien ne vibre là-dedans.
Moi non plus, d’ailleurs.
La voiture est devenue une sorte de smartphone qui roule au doigt et toujours pas à l’œil, vu les prix.
©Sergio Belluz, 2019, le journal vagabond (2018).
À l’amour, avec tendresse
Il y a des fois où on aurait envie de prendre tout ça à la rigolade.
De dire, comme Sarah Bernhard: « L’amour, c’est un coup d’œil, un coup de rein et un coup d’éponge ».
Ou encore, comme Mme Aubernon, dame du monde qui avait un célèbre salon autour de 1900 et qui aurait inspiré Proust pour Mme Verdurin : « De grand mots avant. De petits mots pendant. De gros mots après ».
Beaumarchais dans une lettre à sa maîtresse (Lettres à une amoureuse, Paris : Seuil, 1996) fait une différence très précise entre la sexualité, qu'il appelle l'amour, et les sentiments réciproques, qu'il appelle amitié, c'est assez étonnant.
Concrètement, sa maîtresse lui dit qu'elle aimerait plus de sentiment de sa part, il lui répond qu'il ne faut pas confondre amour (sexualité) et amitié (les sentiments), qui sont deux choses totalement séparées.
Aujourd'hui on aurait plutôt tendance à différencier l'amour et l'amitié par le fait que tous deux sont sentimentaux, mais que dans l'un on couche et dans l'autre pas.
Personnellement, je suis toujours très mal à l'aise avec ce mot d'amour, qui va de Dieu, qui est Amour avec majuscule, au particulier qui "aime" sa copine, à l'amant qui "aime" sa maîtresse ou à la mère qui "aime" son fils ou sa fille.
Quand on dit aimer, je me demande toujours ce qu’on veut dire par là.
Qu'est-ce qu'on aime? Un reflet de soi-même? Un désir d'être autre? Un envie de retrouver quelque chose de perdu qu'on croyait avoir? L'amour? C'est une fuite en avant? Une échappatoire? Une illusion?
Je préfère les mots « tendresse partagée ».
Celle des deux pigeons qui s’aimaient d’amour tendre de La Fontaine ou celle du petit poisson et du petit oiseau qui s’aimaient d’amour tendre de Juliette Greco.
C'est plus juste, plus concret.
C'est spontané.
Il y a une sensualité.
Il y a des caresses.
Il y a une écoute.
Il y a des rires, des sourires ou des larmes.
Une émotion du moment.
Un vrai partage.
Pas d'exigence, pas de conditions, pas de rapport de force, pas de stress.
Ça peut inclure le sexe ou pas.
Ça peut inclure un sexe ou l’autre ou les deux.
Ça comprend ce qu'on pourrait appeller amour ou ce qu'on pourrait appeler amitié ou les deux à la fois, sans concept, sans dogme, et uniquement dans le présent.
Il y a une bienveillance dans ces mots et un don de soi et une générosité.
Si je pouvais, j'échangerais toutes mes douloureuses passions amoureuses pour un maximum de tendresse partagée et rieuse.
©Sergio Belluz, 2018, le journal vagabond (2018).
Illustration: Franz Marc, Deux chats
Le hasard et la nécessité (et l’envie, surtout)
Je pensais aux enchaînements, aux hasards, qui, à chaque fois, apportent leur lot de nouveautés, comme les modifications génétiques créent de nouvelles espèces.
Par exemple, cet Arkas, le grand caricaturiste grec, je n’aurais pas découvert ses dessins si je n’avais pas eu envie d’explorer un nouveau quartier de Nicosie avant de rentrer à pied jusque chez moi.
J’étais tombé sur cette librairie très agréable, le « Centre Solomeiou du livre » où, en furetant dans les rayonnages, j’avais trouvé les albums d’Arkas en version anglaise.
Il me semble que ce que ça montre, c’est qu’il faut suivre ses envies, ou se laisser porter par elles, rester ouverts à tout ce quelles amènent de lieux, de rencontres, de possibilités, car ce qui découle de ça, ce sont des développements organiques, des continuations logiques, un élargissement de ce qu’il y avait au départ, un accroissement des possibles.
Une chose en amène une autre, qui en amène une autre, qui en amène une autre, mais ce n’est pas disparate, c’est lié par l’envie de départ qui est elle-même liée à ce qu’on est profondément.
Il faut oser suivre ses envies.
©Sergio Belluz, 2018, le journal vagabond (2017).