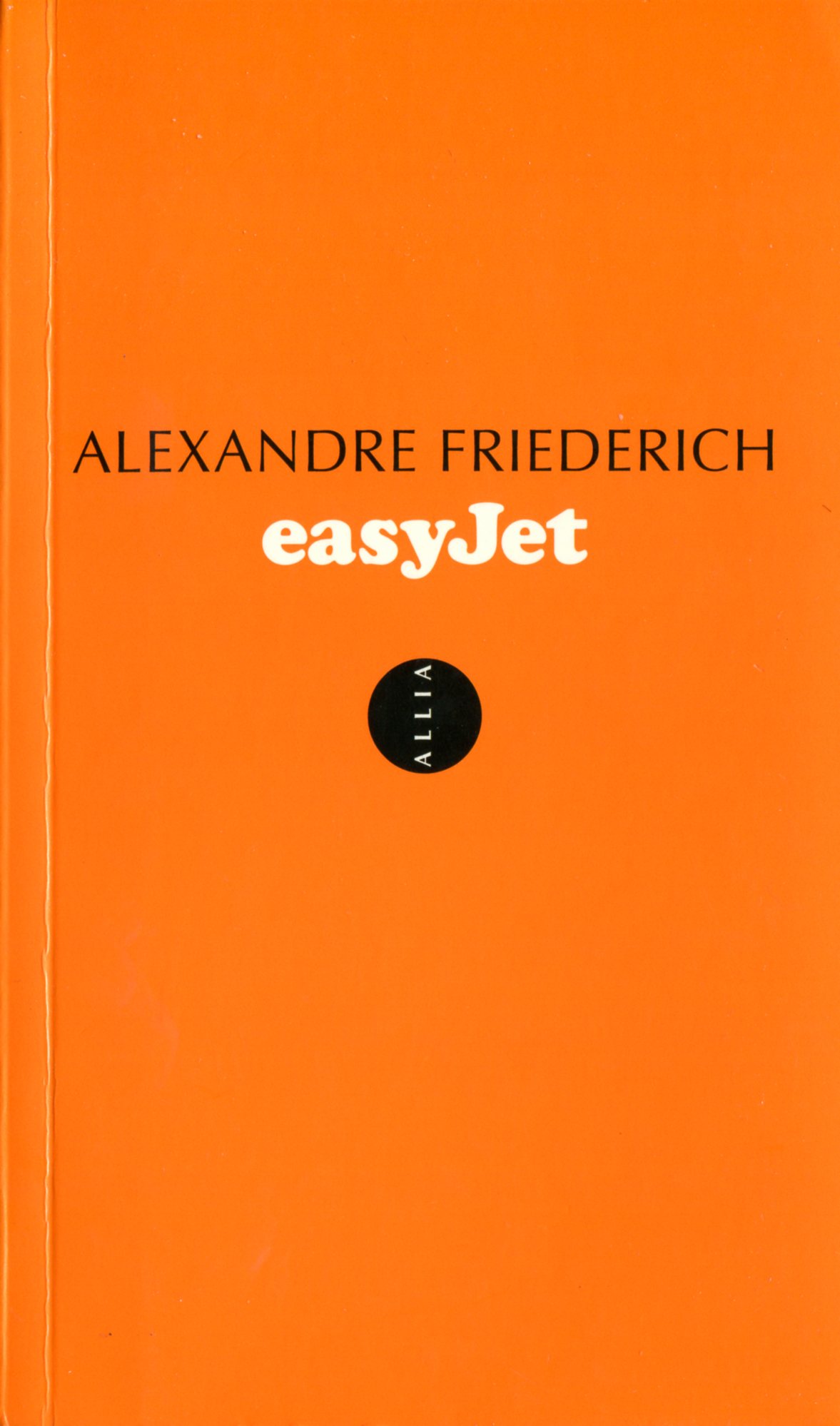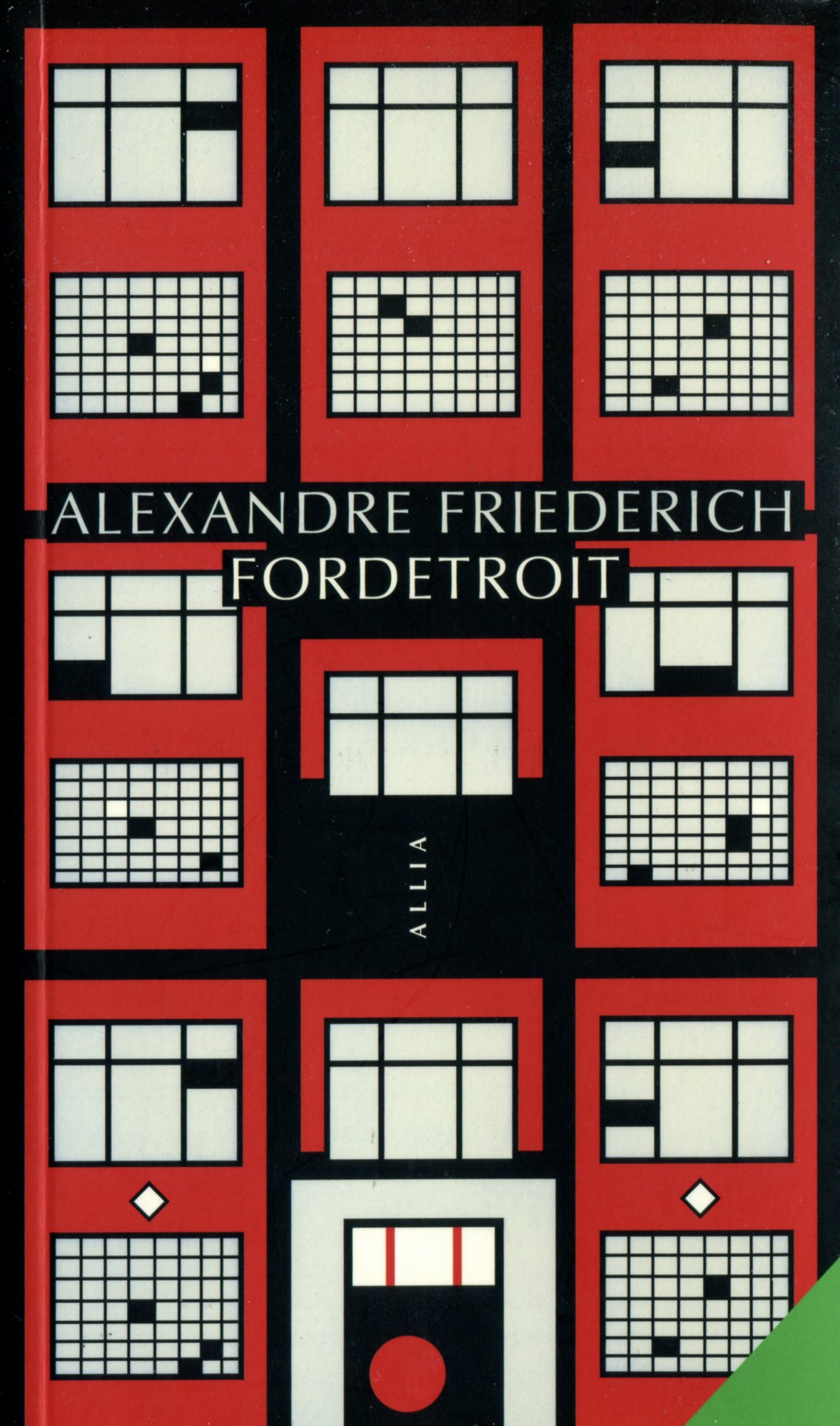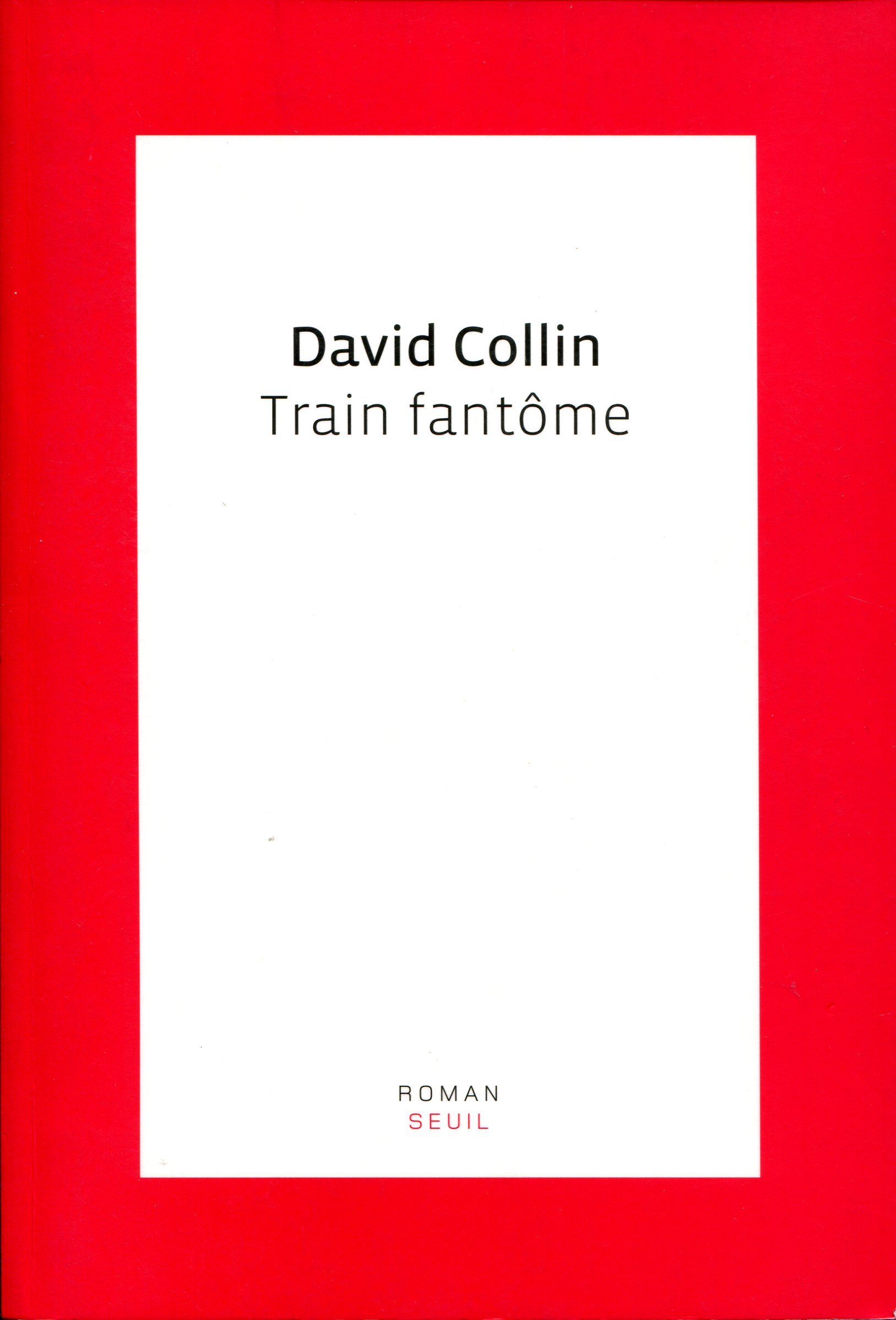* littérature suisse de langue française *
À la Radio Télévision Suisse, Alice s'émerveille quand Manuella Maury m'a fait le coup du lapin...
On se plaint, et avec raison, de la disparition des programmes littéraires à la Radio Télévision Suisse.
Raison de plus pour signaler la naissance, à la radio suisse, sur La Première, d'une toute nouvelle émission radiophonique intitulée Alice s’émerveille, où, plus que l'invité et sa promotion du jour, ce sont ses lectures et ses intérêts qui sont mis en exergue.
C'est joyeusement présenté par la facétieuse Manuella Maury et c’est magnifiquement réalisé par Christian Morerod, dont la fantaisie sonore égale la fantaisie visuelle du Jean-Christophe Averty de l’âge d’or de la télévision française.
En bonus, on a droit, en lien avec l’invité, à d’extraordinaires documents tirés des richissimes archives de la radio suisse. On retrouve ensuite, sur la page internet d'Alice s’émerveille de la Radio Télévision Suisse, les livres cités, chaque lecture en appelant une autre.
Dans le présent épisode vous écouterez, entre autres, Ernest Ansermet parler de Charles Ferdinand Ramuz, Joachim du Bellay vanter les beautés de Rome, vous vous laisserez bercer par la douce mélancolie de La Grenouillère de Guillaume Apollinaire, mis en musique par Francis Poulenc, vous goûterez à de multiples versions de Que reste-t-il de nos amours ? du grand Charles Trenet, vous voyagerez dans les Venises au pluriel de Paul Morand, vous y entendrez s’exprimer Raymond Queneau à propos des manuscrits qu'il recevait, vous serez charmé par les Autres poèmes de Stéphane Blok, vous entendrez l'écrivain Yves Laplace dans une de ses premières interventions médiatiques, et apprendrez à connaître l’opinion sur le mariage et la vie de couple de ce pessimiste joyeux et très grand écrivain suisse que fut Henri Roorda, dont je recommande un texte génial qui devrait rassurer tout écrivain inquiet face à la postérité, et que vous trouverez ici.
Alice n’aime pas les livres qui n’ont pas d’images, mais elle adore les livres qui sont pleins d’images sonores.
Alice s’émerveille, La Première, RTS, dimanche 20 septembre 2020 :
©Sergio Belluz, 2020
Alexandre Friedrich ('easyJet' et 'Fordetroit'): quand le postcapitalisme se fait littérature
Très original, l’éditeur parisien Allia, des textes courts, des formats de poche aux couvertures design pour une collection éclectique où se côtoient l’Arétin, Sainte Thérèse d’Avila, Al-Fârâbi, Custine, Leopardi, De Quincey, Enzensperger, Lorca, Papaioannou ou Nietzsche. Tout est créatif, élégant et donne envie de lire.
À la librairie de la gare de Genève, j’ai trouvé deux livres, deux courts essais, d’Alexandre Friedrich (prix Dentan 2011 pour 'Ogrorog'), un des rares écrivains suisses qui, de manière méthodique, parle très précisément du monde dans lequel nous vivons, les deux livres publiés chez cet éditeur, les deux sur des réalités contemporaines que Friedrich teste et dont il étudie chaque aspect.
Dans easyJet (Paris : Allia, 2014), Alexandre Friedrich décortique le mythe et l’aspect marketing et se livre en passant à l’analyse complète – économique, sociologique, psychologique, historique – de toute une génération, qui, depuis 1995, date de la création de la compagnie et de ses nouvelles techniques de vente, prend l’avion comme le bus, sans se préoccuper des tenants et des aboutissants économiques ou environnementaux :
« Si easyJet possède aujourd’hui une flotte de 210 avions, elle n’était, au moment de sa création, qu’une compagnie virtuelle qui exploitait deux Boeing 737 en leasing et sous-traitait la totalité de ses opérations, des pilots aux préposés à l’enregistrement.
Le premier vol avec avion propriétaire a eu lieu en 1995. Il était à destination d’Amsterdam. à partir de 1998, easyJet procédera à des acquisitions-fusions qui expliquent le maillage actuel du territoire européen à partir de l’Angleterre et de la Suisse (55 destinations au départ de Genève). La négociation de ces plates-formes est un enjeu politique majeur pour la compagnie, car l’approche low cost consiste aussi à obtenir des avantages auprès des autorités aéroportuaires, à commencer par des tarifs préférentiels sur les services au sol (équipes de manutention, passerelles, salles d’attente), cela sans trop lâcher sur les fondamentaux : situations des pistes d’envol et d’atterrissage, créneaux de vols, taxes. Le passager a une valeur évidente dans cette guerre commerciale. Plus il y a de passagers statistiques, plus la compagnie a les moyens de faire pression sur l’aéroport. Et si ce n’est sur l’aéroport, sur la ville qui, à sont tour, fera pressions sur l’aéroport. Chaque touriste représente de fait un apport financier pour les municipalités. »
Dans Fordetroit (Paris : Allia, 2015), c’est la ville qui fut un temps la capitale automobile et le symbole absolu du capitalisme américain qu’Alexandre Friedrich visite en tant que phénomène sociologique :
« Puissante, fière, populeuse, toute en perspectives, portant sur le corps cette étrange patine que donne l’argent, elle était dans les années trente la ville nouvelle qui incarnait les promesses du capitalisme de masse. Chaque jour cinq mille immigrants foulaient les quais de sa gare centrale, monument implanté sur Michigan avenue. Derrière les marques universelles que sont General Motors, Chrysler et Ford, plus de cent fabricants construisaient des automobiles. Les ouvriers se bousculaient, l’investissement explosait : apparaissaient les premiers gratte-ciel, monstres rectilignes aux parures art-déco, et un modèle de logement empilé qui ferai recette : les appartements. Les vedettes fréquentaient théâtres et dancings, les trottoirs menaient aux boutiques et au premier grand magasin au monde, le J.I. Hudson’s Department Store, édifice de trente-trois étages bâti sur Woodrow avenue. Une ruée : en trois décennies la population a sextuplé. À la veille de la Deuxième Guerre, elle atteignait lemillion et demi. La ville était un phare. Ford, un prophète. La classe moyenne, à l’aise dans son toc, ses lumières, ses lois : l’ouvrier à la chaîne avait un salaire enviable, un habit sain, une éducation et une automobile. »
Pas de grandes phrases, pas de chichis, c’est précis, documenté, méthodique : un portrait chinois, une psychanalyse fouillée et une déconstruction passionnante de notre réalité, celle du citoyen-consommateur contemporain manipulé par le Big Brother du marketing.
©Sergio Belluz, 2018, le journal vagabond (2016).
La vie ou le 'Train fantôme' de David Collin
Très émouvant, très touchant, très subtil dans son écriture, le Train fantôme, de David Collin (Paris: Seuil, 2007)
Une proverbe africain mis en exergue dans la quatrième partie, en résume bien la raison sous-jacente : “Quand on ne sait pas qui l’on est on ne sait pas où l’on va.”
On comprend que cet homme devenu père à son tour, a cherché son propre père, disparu très tôt de sa vie, et que cette recherche et ces retrouvailles insespérées et délicates se passent à un tournant de sa vie et qu'il s'agit surtout d'une recherche d'identité et de racine, une manière de s’inscrire officiellement dans les enchainements dont on est le résultat: “J’étais un homme que rien ne précédait, qui ignorait tout de l’histoire de son père, qui désespérait de connaître de quelle tribu il venait, à quelle lignée il appartenait.”
C'est délicatement écrit, fin, pudique, on y relève aussi les ambiguïtés, la recherche et en même temps l'inquiétude liées à cette recherche, une certaine peur d’être rejeté, peut-être, qui fait qu’on ne cherche pas aussi bien qu’on dit le faire, et c’est sans doute une peur métaphysique :
“Le manque de preuve autour de ma naissance, le mystère d’une origine vaguement orientale, en somme le flou de mes racines, me donnaient l’illusion d’être immortel: pas né, pas mort.”
J'ai trouvé aussi magnifique que cette quête s’inscrive dans des déplacements, des trajets, des voyages, qui sont à la fois des métaphores de la vie et des fuites de ce qu'on est et une concentration sur ce qu'on est:
“Sans père, sans patrie, sans toit (“tu n’es pas chez toi”), sans lien, je me suis longtemps senti exilé en paternité ou en manque de paternité; manquait un regard. (...) Conséquence de ce détachement, de cette non-adhérence à un lieu, à une patrie, je ne suis bien qu’en parcourant le monde.”
Ces retrouvailles miraculeuses se déroulent comme une idylle, on se trouve, on se retrouve, on s’appelle, il y a le premier rendez-vous où on arrive le cœur battant... Tout se passe bien, ce qui n’empêche pas une grande lucidité:
“Pourtant je ne sais rien de sa vie, ni lui de la mienne, Nous ne savons rien de ce que Nous n’avons pas vécu ensemble (…) Guettant une infinité de petits souvenirs, souvenirs anodins, Nous ne sommes pas fâchés d’en réinventer quelques-uns, de fabriquer ceux que nous n’avons pas vécus.”
Un très beau roman.
©Sergio Belluz, 2017, le journal vagabond (2017).
Henri Roorda: conseil aux écrivains inquiets
« Mon vieil ami Balthasar est venu me voir hier matin. A peine assis, il m’a dit :
- Je viens te demander conseil au sujet d’un livre que je vais peut-être publier. C’est un recueil d’articles qui ont déjà paru ici et là. Ernest m’a dit très franchement son opinion : il prétend que le public pourrait fort bien se passer de ce volume nouveau.
Moi. – Je suis absolument de son avis.
B. – Tu me conseilles donc de ne pas publier mon ouvrage ?
Moi. – Mais non. Je ne dis pas ça. Ils sont extrêmement rares, les livres dont le public n’aurait pas pu se passer. Y en a-t-il jamais eu un seul ?
B. – Oh !
Moi. – Ne sois pas scandalisé. Avant que telle de ces œuvres indispensables eût vu le jour, l’humanité vaquait à ses besognes ordinaires, comme aujourd’hui. Si l’auteur avait jeté son manuscrit au feu, on n’en aurait rien su et personne n’en aurait souffert. Ernest a raison. Mais si l’on ne voulait publier que des ouvrages ayant une réelle importance, on finirait par ne plus rien imprimer du tout. Et, bientôt, diverses industries péricliteraient.
B. – Je te comprends. Mais j’ai encore quelques scrupules. Il y aura dans mon livre beaucoup de passages bien quelconques, bien médiocres. Ne devrais-je pas, d’abord, les améliorer ?
Moi. – Non. Cela exigerait beaucoup de temps. Et puis, si tu commençais à corriger tes phrases, tu ne t’arrêterais jamais. Il faut d’ailleurs, qu’il y ait dans un livre des longueurs et du remplissage. Cela permet au lecteur de souffler.
B. – Je continue à hésiter. Il y a dans mon recueil quelques plaisanteries un peu grosses.
Moi. – Si elles étaient trop fines, elles passeraient inaperçues.
B. – Et puis, je songe à M. A., moraliste garanti par le gouvernement. Il a, plus d’une fois, porté sur mes articles un jugement sévère. Il dit que je parle avec une coupable légèreté de choses très sérieuses. En publiant mon livre, j’assumerai, paraît-il, une grande responsabilité !
Moi. – Mon pauvre Balthasar, rassure-toi. Ne t’es-tu jamais arrêté devant la vitrine d’un libraire ? L’ensemble des ouvrages qu’on a imprimés durant ces cent dernières années constitue un immense et lamentable chaos. Le monde de la littérature ne sera pas plus chaotique et pas moins pur quand tu auras jeté ton nouveau volume dans le tas.
En rendant l’instruction obligatoire et en enseignant la lecture à des millions d’êtres très peu intelligents, on a assumé une responsabilité devant laquelle la tienne est négligeable. M. A. qui, s’il en avait le pouvoir, s’opposerait vertueusement à la publication de ton ouvrage, ne craint pas de publier les siens. Car il est bien sûr d’être un auteur moral. Mais moi, je ne veux pas croire en l’action moralisante d’un livre écrit par un homme bête. Il faut se défier de ces gens qui voudraient que la loi protégeât leurs idées saines contre l’irrespect des sceptiques. S’ils étaient sincères, ils ne craindraient pas la sincérité des autres.
Sois-en sûr : quelques-uns de tes lecteurs te jugeront dédaigneusement, ou sévèrement. Mais si tu savais de quels écrivains ils disent du bien, tu serais consolé, et flatté.
Ecoute, mon vieux Balthasar : en publiant un livre, on ne peut être sûr, ni de son succès, ni de son utilité, ni de sa valeur littéraire. Tu ne sais même pas si le tien est sérieux ou non. Une telle question est insoluble. Que faut-il pour qu’un livre nouveau puisse être mis en vente ? Cela suppose deux choses, deux conditions nécessaires et suffisantes : un auteur naïf, vaniteux ou cupide, et un éditeur confiant.
B. – Dans mon cas, les deux conditions sont réalisées. J’ai trouvé un éditeur très aimable. Je te remercie pour tes encouragements.
Moi. – Il n’y a pas de quoi. »
Préface à « À prendre ou à laisser » (1919), réédition 2012 chez mille-et-une-nuits