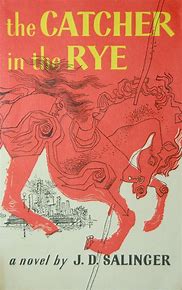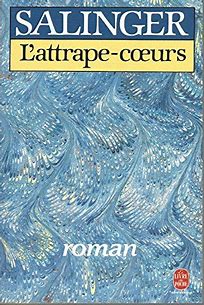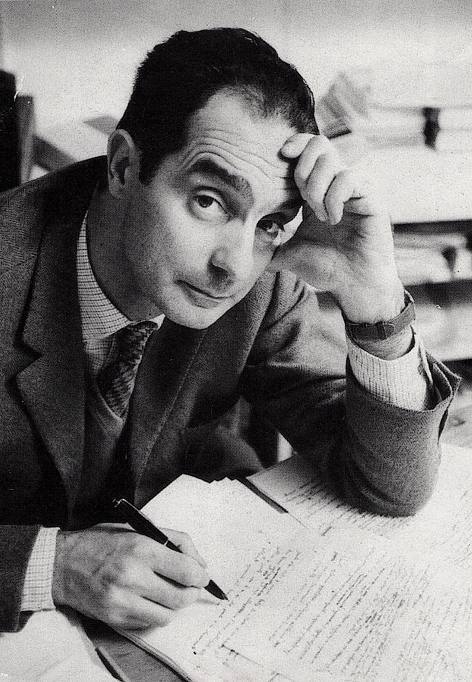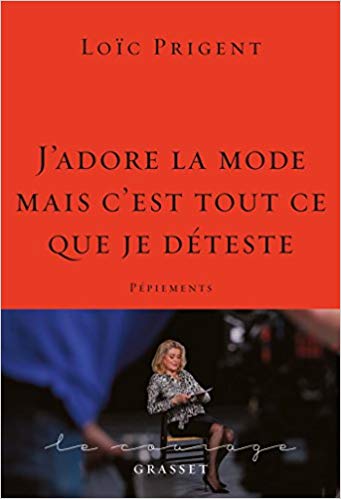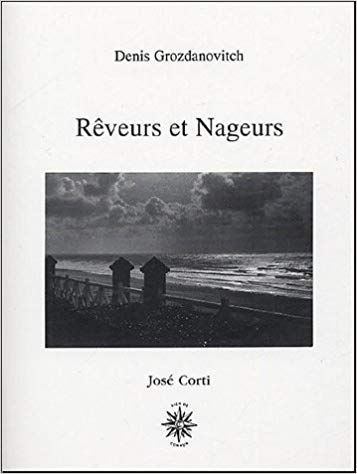* lectures et relectures *
Les livres cultes ne sont plus ce qu’ils étaient
Cherchant quoi lire avant de m’endormir, je tombe sur une édition de poche de The Catcher in the Rye de Salinger, en version originale (L’Attrape-cœurs en français), que j’avais lu il y a très longtemps et qui, apparemment, ne m’avait pas autant frappé que les millions de lecteurs (et de lectrices ?) qui en ont fait un best-seller mondial dans la catégorie « Roman jeunesse », un livre culte pour plusieurs générations, au même titre que Le Grand Meaulnes (1913) d’Alain-Fournier avant lui et la saga Harry Potter de Rowling plus près de nous.
J’ai vérifié : The Catcher in the Rye est paru en 1951.
Je comprends mieux la fascination qu’a exercé longtemps ce petit roman : la narration est faite par un adolescent, et ce point de vue a dû toucher directement tous les adolescents américains de cette époque et au-delà.
Il faut dire qu’aux États-Unis, le teenager est devenu, dans les années cinquante, une donnée sociologique, c’est à dire un nouveau consommateur, un nouveau segment de marché, un nouveau public-cible pour un capitalisme toujours en expansion.
C’est ce qui explique l’apparition de l’adolescence au cinéma, par exemple, avec des films destinés à ce public spécifique, entre les multiples comédies musicales avec Judy Garland et Mickey Rooney, les nanars sur la vie aventureuse de groupes d’ados ou encore Giant (1956) de George Stevens avec James Dean, l’archétype du teenager qui se cherche. Une sorte d’âge d’or ado qu’on peut parfaitement percevoir dans la reconstitution de ces années 50-60 par la comédie musicale Grease (1971) devenue film à succès en 1978, par American Graffiti (1973) de George Lucas tout comme par la célébrissime sitcom Happy Days (1974).
C’est aussi ce nouveau public-cible qui, plus tard, sera à l’origine de tas de comédies du réalisateur John Hughes avec la jeune rouquine Molly Ringwald, ainsi que de toute une série de films plus ou moins trashs autour du pucelage/dépucelage de quantités de jeunes héros et héroïnes, sans omettre le succès de films comme Carrie (1976) de Brian De Palma, qui se passe dans une High School, l’équivalent américain du lycée.
On n’oubliera pas non plus les productions Disney, avec sa fabrique de sitcoms doucereuses et artificielles ciblées sur les adolescents – le rire en boîte y est permanent et le jeu des acteurs caricatural pour ne pas dire factice – qui sont à l’origine de grandes vedettes mondiales qui, une fois finie l’adolescence et les séries nunuches, s’émancipent dans tous les sens du terme pour garder leur segment de marché : afin de casser leur image d’enfants sages et toucher un nouveau public-cible, on les sexualise à outrance dans des clips extrêmement racoleurs, et ce ne sont pas Britney Spears, Justin Timberlake ou Miley Cyrus, anciennes stars de l’Usine Disney, qui me contrediront.
UN TEEN NARRATEUR
Pour en revenir à The Catcher In The Rye, c’était un ton neuf à l’époque, avec quelque chose d’insolent qui a tout de suite plu dans ce narrateur adolescent dont l’écriture, dans sa fausse informalité, créée par des sortes de balises lexicales placées ça et là dans la phrase – je les mets en gras - , retranscrit littérairement, en jouant sur les registres, la langue informelle, très datée, dont les collégiens américains se servaient alors pour se différencier des parents qui, de toute façon, ne les comprenaient pas.
Le Mystère Salinger – pas d’interviews, pas de photos, et on ne sait pas grand chose de lui – a fait le reste.
En anglais, le roman commence par:
If you really want to hear about it, the first thing you’ll probably want to know is where I was born, and what my lousy childhood was like, and how my parents were occupied and all before they had me, and all that David Copperfield kind of crap, but I don’t feel like going into it. In the first place, that stuff bores me, and in the second place, my parents would have about two hemorrhages apiece if I told anything pretty personal about them. They’re quite touchy about anything like that, especially my father. They’re nice and all – I’m not saying that – but they’re also touchy as hell.
Ma traduction :
« Si ça vous intéresse vraiment, la première chose que vous vous demanderez c’est où je suis né et quel type de foutue enfance j’ai eue, et comment s’occupaient mes parents et tout ça avant de m’avoir, et tout ce genre de connerie à la David Copperfield, mais j’ai pas envie de me lancer là-dedans. Primo, ce genre de trucs ça m’ennuie, et secondo mes parents auraient deux hémorragies chacun si je racontais quoi que ce soit de vachement personnel sur eux. Ils sont plutôt soupe au lait sur un truc comme ça, surtout mon père. Ils sont gentils et tout ça – je dis pas – mais ils sont aussi sacrément soupe au lait. »
Plus loin, le narrateur parle de son école privée:
Anyway, it was the Saturday of the football game with Saxon Hall. The game with Saxon Hall was supposed to be a very big deal around Pencey. It was the last game of the year, and you were supposed to commit suicide or something if old Pencey didn’t win. I remember around three o’clock that afternoon I was standing way the hell up on top of Thomsen Hill, right next to this crazy cannon that was in the Revolutionary war and all.
Ma traduction :
« Bref, c’était le samedi du match de football avec Saxon Hall. Le match avec Saxon Hall était censé être un truc super important à Pencey. C’était le dernier match de l’année, et on était censé genre se suicider si le bon vieux Pencey ne gagnait pas. Je me rappelle que vers trois heures cet après-midi-là j’étais sur le foutu sommet de Thomsen Hill, juste à côté de ce canon débile utilisé dans la guerre de la Révolution et tout ça. »
LE CHAMP DE SEIGLE ET TOUT ÇA
Le titre original, The Catcher in the Rye vient d’une chanson mentionnée dans le livre.
C’est dans le chapitre seize, où le héros, Holden Caulfield, a abandonné sa Prep School – une école privée pour gosses de riches, l’équivalent américain d’une boîte à bachot – autour de Noël.
En fait, il en a été viré et se retrouve seul à New York, parce qu’il ne veut pas tout de suite rentrer chez lui. On suit ses errances et ses rencontres dans son long monologue adressé au lecteur :
It wasn’t as cold as it was the day before, but the sun still wasn’t out, and it wasn’t too nice for walking. But there was one nice thing. This family that you could tell just came out of some church were walking right in front of me – a father, a mother, and a little kid about six years old. They looked sort of poor. The father had on one of these pearl-grey hats that poor guys wear a lot when they want to look sharp. He and his wife were just walking along, talking, not paying attention to their kid. The kid was swell. He was walking in the street instead of on the sidewalk but right next to the kerb. He was making out like he was walking a very straight line, the way kids do, and the whole time he kept singing and humming. I got up closer so I could hear what he was singing. He was singing that song, ‘If a body catch a body coming through the rye’. He had a pretty little voice. He was just singing for the hell of it, you could tell. The cars zoomed by, brakes screeched all over the place, his parents paid no attention to him, and he kept on walking next to the kerb and singing ‘If a body catch a body coming through the rye’. It made me feel better. It made me feel not so depressed anymore.
Ma traduction :
« Il ne faisait pas si froid que le jour avant, mais le soleil n’était toujours pas apparu, et ce n’était pas très sympa pour se promener. Mais il y a eu un truc sympa. Cette famille qu’on pouvait voir qu’elle venait de sortir de l’église et qui marchait juste devant moi – un père, une mère, et un petit gosse d’environ six ans. Ils avaient l’air plutôt pauvres. Le père portait un de ces chapeaux gris perle que portent beaucoup les gars pauvres quand ils veulent avoir l’air bien mis. Lui et sa femme étaient juste en train de marcher, ils causaient, ils surveillaient pas leur gosse. Le gosse était super. Il marchait sur la route et pas sur le trottoir mais juste à côté de la marche. Il faisait comme si il était en train de marcher sur une corde raide, comme font les gosses, et il arrêtait pas de chanter et de fredonner. Je me suis rapproché pour entendre ce qu’il chantait. Il chantait cette chanson, ‘Si un corps arrête un corps qui sort d’un champ de seigle’. Il avait une jolie petite voix. Il chantait ça juste comme ça, on voyait bien. Les voitures passaient à ras, les freins crissaient dans tous les sens, ses parents ne s’occupaient absolument pas de lui, et il continuait à marcher le long du trottoir et à chanter ‘Si un corps arrête un corps qui sort d’un champ d’seigle’. Ça m’a fait me sentir moins déprimé du coup. »
LE TITRE? TOUT UN POÈME
Dans mon édition Penguin, c’est aux pages 179-180 qu’on apprend la vraie raison du titre The Catcher In the Rye, dans un passage où le narrateur, Holden Caulfield, s’adresse à sa soeur Phoebe :
You know that song “If a body catch a body comin’ through the rye” ? I’d like –
‘ It’s “If a body meet a body coming through the rye”! old Phoebe said. It’s a poem. By Robert Burns.’
She was right, though. It is ‘If a body meet a body coming through the rye’. I didn’t know it then, though.
‘I thought it was “If a body catch a body”, I said. ‘Anyway, I keep picturing all these little kids playing some game in this big field of rye and all. Thousands of little kids, and nobody’s around – nobody big, I mean – except me. And I’m standing on the edge of some crazy cliff. What I have to do, I have to catch everybody if they start to go over the cliff – I mean if they’re running and they don’t look where they’re going I have to come out from somewhere and catch them. That’s all I’d do all day. I’d just be the catcher in the rye and all. I know it’s crazy, but that’s the only thing I’d really like to be. I know it’s crazy.’
Old Phoebe didn’t say anything for a long time. Then, when she said something all she said was, ‘Daddy’s going to kill you.’”
Ma traduction :
« Tu sais, cette chanson ‘Si un corps attrape un corps qui sort d’un champ de seigle’ ? J’aimerais –
« C’est ‘Si un corps rencontre un corps qui sort d’un champ de seigle’ ! me dit ma vieille Phoebe. C’est un poème. De Robert Burns. »
Elle avait raison, donc. C’est bien ‘Si un corps rencontre un corps qui sort d’un champ de seigle’. Mais je ne le savais pas alors, donc.
« J’ai cru que c’était ‘Si un corps attrape un corps’, j’ai dit. « De toute façon, je continue à voir tous ces petits gosses en train de jouer une partie de quelque chose dans ce grand champ de seigle et tout ça. Des milliers de petits gosses, et il n’y a personne – pas de grands, je veux dire – sauf moi. Et je suis juste sur le bord d’une falaise débile. Ce que je dois faire, c’est que je dois attraper tout le monde s’ils commencent à s’approcher du bord de la falaise – je veux dire que s’ils sont en train de courir et qu’ils ne regardent pas où ils vont je dois surgir de quelque part et les attraper. C’est ce que je ferais toute la journée. Je serais juste l’attrapeur du champ de seigle et tout ça. Je sais que c’est dingue, mais c’est la seule chose que j’aimerais être. Je sais que c’est dingue. »
Ma vieille Phoebe n’a rien dit pendant un bon moment. Et puis, quand elle a dit quelque chose, elle a dit : « Papa va te tuer. »
L'ATTRAPE-COEURS, UN ATTRAPE-NIGAUD?
À la relecture, j’ai de la peine à comprendre comment ce roman a pu être classé dans les cent meilleurs du XXe siècle. Je le trouve assez fabriqué, truqué même: si la chanson du gosse déjà évoquée dans le chapitre seize est reprise dans cette scène entre Holden Caulfield et sa sœur, c’est qu’il faut bien conclure et caser une explication pour qu’on puisse comprendre le sens du roman et faire le rapprochement entre la chanson et les rêvasseries du collégien, sa peur de grandir, son immense ennui, sa recherche de sens, son désespoir, peut-être, son vague à l’âme en tout cas, son blues, allons-y carrément.
Or justement, cette chanson, l’élément-clé du roman – ce qu’on appellerait un révélateur en photographie – est introduite de manière artificielle : si la sœur du héros est une surdouée apparemment capable de corriger une citation d’un poète écossais du XVIIIe, on se demande bien comment un gosse de six ans d’une famille modeste de New York peut connaître et chantonner ces mêmes vers, ou alors le niveau scolaire newyorkais des années 50 était assez exceptionnel.
De même, dans la construction de l’histoire, les seules vraies péripéties sont uniquement dues aux diverse rencontres de cet ado le long de son périple – comme une Odyssée aux petits pieds, au final, Holden revient au luxueux duplex parental – qui permettent à Salinger de faire un portrait sarcastique (et vide, de mon point de vue) de camarades de classe, de professeurs, de chanteuses de cabaret, de prostituée, des personnages qui n’apportent strictement rien à l’histoire de cet adolescent.
Une autre possibilité, qui expliquerait avantageusement les incohérences du récit, serait de partir du postulat qu’on est dans un delirium tremens de l’adolescent narrateur. Il y a des points de ressemblance avec le côté errance-alcoolisée-en-quête-du-sens-de-la-vie-avec-tentation-suicidaire d’Under The Volcano (1947) de Malcolm Lowry, un roman tout aussi culte, mais parfaitement cohérent celui-là, et d’une construction extrêmement complexe, sans parler de sa narration, d’une richesse et d’une écriture autrement plus subtile.
On se dit surtout que The Catcher in the Rye, porté aux nues par plusieurs générations d’adolescents américains d’après-guerre qui se sont identifiés au rebelle Holden Caulfield, fils d’avocat, étudiant de boite à bachot de luxe et habitant un duplex dans le New York chic – on est loin de West Side Story – est d’abord et surtout un roman-culte pour plusieurs générations d’adolescents américains blancs de classe aisée, les mêmes qui, dans leurs quartiers ou leurs banlieues chics, et pour emmerder leurs parents tout en recevant un max d’argent de poche, font du rock, se biturent et fument de l’herbe avant de poursuivre leur existence en tant qu’adultes privilégiés...
D’où, pour moi, ce sentiment d’agacement pour ce récit un peu artificiel, cette histoire de fils à papa gâté qui peut se permettre de rater ses études et de faire passer ça pour une quête métaphysique.
©Sergio Belluz, 2021, le journal vagabond (2019).
Cet article est aussi paru dans le magazine en ligne LE PASSE-MURAILLE à l'adresse directe:
https://www.revuelepassemuraille.ch/les-livres-cultes-ne-sont-plus-ce-quils-etaient/
Chez Balzac, sans endettement pas de Comédie Humaine
C’est dans Le Père Goriot, roman central à toute La Comédie Humaine, que Balzac, à propos de Rastignac, évoque ces futilités, ces luxes indispensables à la jeunesse ambitieuse.
Il en connaissait quelque chose : en consommateur compulsif, Balzac s'est endetté à vie pour avoir tous ces attributs et ces babioles qu'il jugeait indispensables à l'image d'un écrivain.
C'est d'ailleurs à ça qu'on doit La Comédie Humaine, car pour obtenir toujours plus d'argent et rembourser ses dettes, il signait avec plusieurs éditeurs et devaient ensuite écrire en trois mois des énormes pavés comme Illusions perdues ou Splendeurs et Misères des Courtisanes publiés d’abord en feuilleton dans des revues, puis republiés (et à chaque fois remaniés) en livre.
C’est passionnant de visiter la maison-musée de Balzac, Rue Raynouard, dans le seizième arrondissement de Paris.
C'est le premier musée que je suis allé visiter à Paris la première fois que j'y suis allé, après avoir lu toute La Comédie Humaine avec passion, avec folie – quelques 120 romans et nouvelles –, sans compter les Lettres à l’Étrangère, la correspondance de Balzac avec Mme Hanska, son admiratrice et le grand amour de sa vie, une noble polonaise qui, une fois son mari mort, l'épousera, trois mois avant que Balzac meure d'épuisement.
Cette maison, avec sa double entrée - ou plutôt sa double sortie, il y en avait une qui lui permettait de fuir les créanciers (à cette époque, on finissait en prison pour dettes) –, m'avait profondément ému.
On y voyait quelques-unes des extravagances de ce formidable tempérament, ses gants jaunes d'écrivain mondain, sa canne avec pommeau d'émeraude...
Extravagances qui avaient aussi leur logique publicitaire : il s’agissait à la fois d’avoir l’allure du grand écrivain à succès, et de le faire croire aux éditeurs.
Un gros bluff, un coup de poker pour négocier de meilleurs contrats et, ainsi, rembourser plus vite des dettes qui ne cessaient de croître.
À quoi tiennent les choses.
©Sergio Belluz, 2019, le journal vagabond (2003).
Amuser a une fonction sociale (Italo Calvino)
Italo Calvino est un auteur que j’aime beaucoup, proche, dans sa démarche, d’un Raymond Queneau, à la fois technique et s’amusant de la technique dans des œuvres littéraires et métalittéraires à la fois.
J’ai recopié plusieurs textes d’introduction au Visconte dimezzato (Le Vicomte pourfendu) d’Italo Calvino, dont une fabuleuse introduction, très documentée.
TRÈS PARTAGÉ, L’INTELLECTUEL CONTEMPORAIN
Dans une lettre à C. Salinari, du 7 août 1952, Calvino écrit ceci (ma traduction) :
« Ce qui était important pour moi, c’était le problème de l’homme contemporain (de l’intellectuel, pour être plus précis) partagé, c’est à dire incomplet, ‘aliéné’.
Si j’ai choisi de partager mon personnage en suivant la ligne de fracture « bien-mal », c’est parce que ça me permettait un maximum d’images contrastées, et ça se rattachait à une tradition littéraire déjà classique (par exemple Stevenson) ce qui fait que je pouvais en jouer sans m’inquiéter.
Et mes allusions moralistes, appelons-les comme ça, ne ciblaient pas tant le Vicomte que les personnages qui l’entourent, qui sont des simplifications de mon propos : les lépreux (c’est à dire les artistes décadents), le docteur et le charpentier (la science et la technique détachées de l’humanité), ces huguenots, vus de manière sympathique mais aussi ironique (et qui sont un peu une allégorie autobiografico-familiale, une espèce d’épopée généalogique imaginaire de ma famille) et aussi une image de toute la pensée moraliste bourgeoise. »
(L’original : « A me importava il problema dell’uomo contemporaneo (dell’intellettuale, per esser più precisi) dimezzato, cioè incompleto, “alienato”.
Se ho scelto di dimezzare il mio personaggio secondo la linea di frattura “bene-male”, l’ho fatto perchè ciò mi permetteva una maggiore evidenza d’immagini contrapposte, e si legava a una tradizione letteraria già classica (p. es. Stevenson) cosicchè potevo giocarci senza preoccupazioni.
Mentre i miei ammicchi moralistici, chiamiamoli così, erano indirizzati non tanto al visconte quanto ai personaggi di cornice, che sono le vere semplificazioni del mio assunto: i lebbrosi (cioè gli artristi decadenti), il dottore e il carpentiere (la scienza et la tecnica staccate dall’umanità), quegli ugonotti, visti un po’ con simpatia e un po’ con ironia (che sono un po’ una mia allegoria autobiografico-familiare, una specie di epopea genealogica immaginaria della mia famiglia) e anche un’immagine di tutta la linea del moralismo idealista della borghesia. »
Lettre à C. Salinari del 7 agosto 1952, parue dans I. Calvino, I libri degli altri. Lettere 1947-81, Turin: Einaudi, 1991, p.67.)
S’AMUSER À DIVERTIR, S’AMUSER À ÉCRIRE
Pour Italo Calvino, le fait que les gens s’amusent à le lire est tout aussi important que le fait qu’il s’amuse lui-même au moment de l’écriture. Dans une lettre à Emilio Cecchi, du 3 novembre 1961, il écrit ceci (ma traduction) :
« Quand j’ai commencé à écrire Le Vicomte, je voulais surtout écrire une histoire amusante pour m’amuser moi-même et, si possible, pour amuser les autres ; j’avais cette image d’un homme coupé en deux et j’ai pensé que ce thème de l’homme coupé en deux, partagé en deux, était un thème intéressant, qu’il avait une résonance contemporaine : on se sent tous plus ou moins incomplets, on développe tous une partie de soi et pas l’autre.
Pour ça, j’ai cherché à concevoir une histoire qui tienne debout, qui ait une symétrie, un rythme à la fois de récit d’aventure mais aussi de ballet. Il m’a semblé que pour différencier les deux moitiés il fallait créer un côté méchant et un côté gentil pour un maximum de contrastes. C’est une construction narrative basée sur les contrastes.
Du coup, l’histoire est construite sur une série d’effets de surprise : à la place du Vicomte entier, c’est le Vicomte à moitié qui revient au pays, et il est très cruel, il me semblait que ça créait un effet maximal de surprise ; ensuite, à un certain moment, le fait qu’on découvre un Vicomte absolument bon à la place du méchant créait un autre effet de surprise ; et que ces deux moitiés soient toutes deux insupportables, tant la gentille que la méchante, créait un effet comique et, en même temps, donnait du sens, parce que des fois, les gentils, les gens trop systématiquement gentils et pleins de bonnes intentions, sont d’insupportables casse-pieds.
Ce qui est important, dans un truc de ce style c’est de créer une histoire qui fonctionne d’un point de vue narratif, et qui capte le lecteur. En même temps, je suis toujours attentif au sens : je suis attentif à ce que l’histoire ne soit pas interprétée dans un sens contraire à celui que je veux ; du coup, toutes les significations sont importantes, et dans un conte comme celui-ci, le rôle de la narration, et, disons, celui de l’amusement, est très important.
Je trouve que le fait d’amuser a une fonction sociale, ça correspond à ma morale ; je pense toujours au lecteur qui doit se taper toutes ces pages, il faut qu’il s’amuse, il faut qu’il ait une récompense ; c’est ma morale personnelle : quelqu’un a acheté le livre, l’a payé avec ses sous, y a investi du temps, il doit s’amuser. Je ne suis pas le seul à le penser, un écrivain aussi attentif au contenu que Bertold Brecht, par exemple, disait que la première fonction sociale d’une oeuvre de théâtre est de distraire. Je trouve que le divertissement est une chose sérieuse. »
(L’original: « Quando ho cominciato a scrivere ‘Il visconte dimezzato’, volevo sopratutto scrivere una storia divertente per divertire me stesso, e possibilmente per divertire gli altri; avevo questa immagine di un uomo tagliato in due ed ho pensato che questo tema dell’uomo tagliato in due, dell’uomo dimezzato fosse un un tema significativo, avesse un significato contemporaneo: tutti ci sentiamo in qualche modo incompleti, tutti realizziamo una parte di noi stessi et non l’altra.
Per fare questo ho cercato di mettere su una storia che stesse in piedi, che avesse una simmetria, un ritmo nello stesso tempo da racconto di avventura ma anche quasi da balletto. Il modo per differenziare le due metà mi è sembrato che quelle di farne una cattiva e l’altra buona fosse quella che creasse il massimo contrasto. Era una costruzione narrativa basata sui contrasti.
Quindi la storia si basa su una serie di effetti di sorpresa: che, al posto del visconte intero, ritorni al paese un visconte a metà che è molto crudele, mi è parso che creasse il massimo di effetto di sorpresa; che poi, ad un certo punto, si scoprisse invece un visconte assolutamente buono al posto di quello cattivo creava un altro effetto di sopresa; che queste due metà fossero egualmente insopportabili, la buona e la cattiva, era un effetto comico e nello stesso tempo anche significativo, perchè alle volte i buoni, le persone troppo programmaticamente buone e piene di buone intenzioni sono dei terribili scocciatori.
L’importante in una cosa del genere è fare una storia che funzioni proprio come tecnica narrativa, come presa sul lettore. Nello stessotempo, io sono anche sempre molto attento ai significati: bado a che una storia non finisca per essere interpretata in modo contrario a come la penso io; quindi anche i significati sono molto importanti, però in un racconto come questo l’aspetto di funzionalità narrativa e, diciamolo, di divertimento, è molto importante.
Io credo che il divertire sia una funzione sociale, corrisponde alla mia morale; penso sempre al lettore che si deve sorbire tutte queste pagine, bisogna che si diverta, bisogna che abbia anche una gratificazione; questa è la mia morale: uno ha comprato il libro, ha pagato dei soldi, ci investe del suo tempo, si deve divertire. Non sono solo io a pensarla così, ad esempio anche uno scrittore attento ai contenuti come Bertold Brecht diceva che la prima funzione sociale di un’opera teatrale era il divertimento. Io penso che il divertimento sia una cosa seria. »
LES ÉCRITS RESTENT... MAIS LESQUELS ?
Dans sa pratique de l’écriture sous toutes ses formes, Calvino s’interroge continuellement sur l’importance, l’opportunité, et même l’utilité de ce qu’il écrit, que ce soit pour le public ou que ce soit en rapport avec le processus, le développement général de son oeuvre (ma traduction) :
« Depuis quelques temps, je reçois des demandes de collaboration d’un peu partout – quotidiens, hebdomadaires, cinéma, théâtre, radio, télévision –, des demandes plus alléchantes les unes que les autres, tant d’un point de vue financier que d’un point de vue médiatique, et il y en a tant que – partagé entre la peur de me disperser dans des choses éphémères, l’exemple d’autres écrivains plus versatiles et plus féconds qui parfois me donnent envie de les imiter mais qui, en fin de compte, me poussent à m’octroyer le plaisir de ne rien dire pour ne pas leur ressembler, le désir de me recueillir pour penser au « livre », et en même temps le soupçon que ce n’est qu’en se mettant à écrire n’importe quoi, même « au jour le jour », qu’on finit par écrire quelque chose qui reste –, du coup, je finis par n’écrire ni pour les journaux, ni pour sur demande ni pour moi-même. »
L’original: « Da un po’ di tempo, le richieste di collaborazioni da tutte le parti – quotidiani, settimanali, cinema, teatro, radio, televisione –, richieste una più allettante dell’altra come compenso e risonanza, sono tante e così presssanti, che io – combattuto fra il timore di disperdermi in cose efimere, l’esempio di altri scrittori più versatili e fecondi che a momenti mi dà il desiderio d’imitarli ma poi invece finisce per ridarmi il piacere di star zitto pur di non assomigliare a loro, il desiderio di raccogliermi per pensare al “libro” e nello stesso tempo il sospetto che solo mettendosi a scrivere qualunque cosa anche “alla giornata” si finisce per scrivere ciò che rimane – insomma, succede che non scrivo né per i giornali, né per le occasioni esterne né per me stesso. »
Conférence devant les étudiants de Pesaro, 11 mai 1983, transcrite et publiée dans ‘Il gusto dei contemporanei’, Quaderno no.3, Italo Calvino, Pesaro: 1987, p.9.
On ne sait jamais. Tout comme Léautaud ne pensait pas que son Journal serait son œuvre principale et qu’il serait lu encore plus de soixante ans après sa mort, Voltaire tablait sur ses tragédies pour passer à la postérité et n’aurait jamais imaginé que ses contes, et Candide en particulier, seraient ce qu’on retiendrait de lui.
Moralité : il ne faut pas trop penser à la notoriété ou à la postérité, et, la vie étant trop courte pour s’emmerder, privilégier ce qu’on a plaisir à écrire, ce qui nous vient naturellement, et laisser tomber ce que nous n’aimons pas écrire, ce qui ne nous convient pas, ce qui est trop artificiel ou fabriqué.
©Sergio Belluz, 2019, le journal vagabond (2018)
Loïc Prigent: « Tu dis pas une robe banale tu dis un vestiaire fonctionnaliste. »
Ce Loïc Prigent est quelqu’un d’une extraordinaire intelligence linguistique : il avait une chronique, dans un programme d’Europe1 (« Bonjour la France », je crois que ça s’appellait, c’est Daphné Burki qui animait l’émission) où il décortiquait les jargons des professions branchées, notamment celles de la mode.
Sa traduction en français standard du jargon anglo-euphémistique-politiquement correct-branché est à pleurer de rire – et de vérité.
Je me suis beaucoup amusé à lire son recueil J’adore la mode mais c’est tout ce que je déteste (Paris : Grasset, 2016) dans lequel on trouve des perles d’humour totalement ‘camp’ comme :
« Là elle a son corps de novembre mais dès qu’elle arrête les 130 cookies par jour elle revient à son corps de juillet en une semaine »
« J’ai fait le casting de cul pour la pub. Le cul fossette musclé cardio c’est introuvable, elles ont toutes des culs Kardashian maintenant. »
« Ma mère était une cinglée du shopping, je pense que j’ai été conçue dans une cabine d’essayage Paco Rabanne. »
« J’ai fait un dîner à la maison avec six influenceuses, on avait 14 millions de followers dans la salle à manger. »
« Je sais qu’il y a des gens qui meurent dans le monde, mais réglons un problème à la fois et commençons par tes cheveux. »
« Il a écrit Cartier ‘Quartier’ dans un mail. Il dit que c’est le correcteur d’orthographe, mais je répands la rumeur quand même. »
« 9% de mon cerveau est occupé par l’angoisse batterie téléphone. Où en suis-je ? Faut-il baisser la luminosité de l’écran ? Quand le rebrancher ? »
« J’ai relu ‘Le Diable s’habille en Prada’, ça a vieilli. Aujourd’hui les jeunes sont pires. Le Diable s’habille en Mango. »
« C’est une vraie Parisienne. Elle met du Chanel comme si c’était du Monoprix et du Monoprix comme si c’était du Chanel. »
« Il est beau ? – Il a 7000 abonnés sur Instagram avec vingt photos. – Ah ok il est beau. »
« Je suis outdoor designer. – Jardinier de jardin ? – Oui voilà. »
« Tu dis pas blogueuse tu dis créatrice de contenu ».
« Tu dis pas rose tu dis grenadine claire. »
« Sa biographie tient en 4 emoticônes »
« Gisèle Bündchen a sauté sur Zaha Hadid pour papoter mais 220 Coréennes en Chanel hurlaient autour, c’était la selfiecalypse. »
« Tu dis pas méchante tu dis vice president of global communications and marketing. »
« Tu dis pas une robe banale tu dis un vestiaire fonctionnaliste. »
C’est tout un monde médiatique qui est ainsi décrypté, sa frivolité, sa superficialité, sa créativité aussi, et notamment dans sa manière de créer de nouveaux mots, ou d’accoler deux mots surprenants pour créer un autre sens.
Hilarant.
©Sergio Belluz, 2019, le journal vagabond (2018).
Denis Grozdanovitch, rêveur subtil
Un ancien champion de tennis qui se met à écrire, qu’est-ce que ça donne ? Une sorte de philosophe épicurien et souriant qui sait renvoyer la balle et monter au filet.
« Rêveurs et Nageurs ou Du plaisir parmi les difficultés » de Denis Grozdanovitch (Paris : José Corti, 2005), c’est drôle, subtil, léger tout en étant profond et magnifiquement écrit.
Sur Cioran
« En fait, à bien y regarder, c'est à une variante balkanique du calvinisme que nous avons vraisemblablement affaire ici, laquelle mène une guerre larvée contre toute vision païenne, multiple, baroque et éventuellement joyeuse de l'existence.
Pour des puritains de cette eau, l'existence telle qu'elle se présente, dans un simple jardin laissé à l'abandon, par exemple, est insupportable défi, insulte à cette rationalité intangible qui est leur credo dogmatique inconscient.
Ces hygiénistes latents, fatalement répugnés par le désordre anarchique qui leur paraît régner dans le monde, et devant l'impossibilité de le planifier efficacement, prônent, sous le thème de l'absurdité et de l'inconvénient d'exister, une sorte de rigueur morale déguisée. »
Sur les cuistres
« En bref, aucun des orateurs ne manifestait la moindre tendance à la causticité.
Je croyais reconnaître là, assez nettement, les propensions avérées de notre syncrétisme pagano-chrétien à l'idolâtrie pour une part et à l'hagiographie pour l'autre, lesquelles, à travers différents avatars, ont résisté à tous les assauts de l'esprit réaliste.
(...) On sentait qu'il ne pouvait être en rien question, concernant l'un des leurs, de tenter d'apercevoir un individu d'essence simplement humaine - toujours un peu dérisoire - sous les habits sacerdotaux du Grand Philosophe.
Comme si tout Grand Philosophe qu'il ait été, celui-ci n'avait pu non seulement - dans un moment d'égarement - prendre des vessies pour des lanternes et ensuite s'obstiner par vanité et par orgueil (ainsi qu'on le voit faire tous les jours à tout un chacun), mais encore être jamais rejoint par la fourberie, l'inconséquence ou bien même (Ô horreur!) le spectre abhorré de la simple bêtise?
(...) On subodorait que ces esprits dogmatiques, ultra-rationnels, étaient pétris d'angoisse devant le foisonnement du réel et que l'esprit de système leur était, en fait, un refuge bien bétonné, pour ne pas dire un solide blockhaus à l'épreuve de la moindre surprise. »
Sur les illusions de la liberté individuelle
« Chercher à se rendre libre - dans la faible mesure où la chose nous est permise - consisterait peut-être alors à tenter, d'une manière ou d'une autre, de négocier astucieusement en soi-même avec les morts? »
Sur la relativité des convictions et des points de vue
« (...) Je devais me rendre à l'évidence que les us et les coutumes d'une époque prévalaient grandement sur l'éventuelle puissance d'une pensée quelconque, que la sagesse et l'humour dans la vie immédiate n'entretenaient que peu de rapports, au bout du compte, avec la pertinence intellectuelle, que les mœurs en vigueur l'emportaient donc, la plupart du temps, sur les idées, aussi brillantes puissent-elles être. »
Sur comment naviguer dans sa propre vie
« S'en remettre au hasard dans les décisions, c'est être à la hauteur des vicissitudes de l'existence, car l'habileté suprême consiste à se maintenir en équilibre au milieu du changement des événements. »
Sur la création
« (...) Laisser la forme poétique s'imposer à nous de façon toute organique, c'est-à-dire insensible, fluide, comme allant de soi; celle-ci ne pouvant s'imposer ainsi, avec bonheur et facilité, que dans la mesure où nous l'aurions sollicitée, au long des heures et des jours, par la pratique d'une certaine ascèse.
Ascèse non douloureuse ni pénible, seulement une belle et opiniâtre constance, une longue et douce habitude: celle de se mettre en état de réceptivité. Habitude qui, presque sûrement, s'apparentait à la pratique ancienne de la prière et de la méditation. »
Hommage aux libraires subjectifs
Adrienne Monnier et Sylvia Beach tenaient chacune une librairie-bibliothèque-maison d'édition autour de 1920 et jusque dans les années 50.
Les deux librairies se faisaient face, rue de l'Odéon à Paris.
À La Maison des Amis des Livres, chez Adrienne Monnier, on s'occupait de la littérature française et en langue française, qu'on prêtait, qu'on vendait et qu'on éditait.
Par exemple. comme elle aimait bien Jacques Prévert, elle se chargeait de vendre ses livres et de les promouvoir auprès des membres qui les lui empruntaient
En face, chez Shakespeare & Company, la librairie de Sylvia Beach, on faisait de même pour la littérature en anglais.
Ce sont ces deux dames qui ont osé éditer en premier le 'Ulysses' de James Joyce qui avait été refusé par tous les éditeurs.
Adrienne Monnier tenait des fiches sur ceux qui empruntaient les livres, avec des descriptifs très précis:
- « Dame revêche »
- « Monsieur distingué »
- « Jeune fille bien nourrie »
- « Gentil couillon »
- « Jeune homme un brin con »
©Sergio Belluz, 2018, le journal vagabond (2018)
Scarron: le roman français, autrement
Le Roman Comique (1651) de Scarron, quelle merveille ! quelle verve ! quelle fantaisie !
Une structure de roman très libre, un ton facétieux, un canevas souple, inspiré du roman picaresque et des nouvelles espagnoles, que Scarron lisait dans le texte (au XVIIe la littérature espagnole était très appréciée en France).
Un Capitaine Fracasse avant la lettre, puisqu’il s’agit d’une troupe de théâtre et de ses aventures lors de ses tournées en province.
Le livre commence par :
« AU LECTEUR SCANDALISÉ DES FAUTES D’IMPRESSION QUI SONT DANS MON LIVRE
Je ne te donne point d’autre Errata de mon livre que mon livre même, qui est tout plein de fautes. L’Imprimeur y a moins failli que moi, qui ai la mauvaise coutume de ne faire bien souvent ce que je donne à imprimer que la veille du jour que l’on imprime. Tellement qu’ayant encore dans la tête ce qu’il y a si peu de temps que j’ai composé, je relis les feuilles que l’on m’apporte à corriger à peu près de la même façon que je récitais au collège la leçon que je n’avais pas eu le temps d’apprendre (...) »
UN ROMAN EN TITRE(S)
Les titres sont drôles à souhait, le chapitre cinq, par exemple...
« CHAPITRE V
QUI NE CONTIENT PAS GRAND-CHOSE »
... ou le chapitre onze...
« CHAPITRE XI
QUI CONTIENT CE QUE VOUS VERREZ
SI VOUS PRENEZ LA PEINE DE LE LIRE »
Le narrateur n’hésite jamais à intervenir en disant des choses du style :
« L’auteur se reposa quelque temps et se mit à songer à ce qu’il dirait dans le second chapitre. »
Ou encore :
« Je ne dirai point si les comédiens plurent autant aux dames du Mans que les comédiennes avaient fait aux hommes ; quand j’en saurais quelque chose, je n’en dirais rien ; mais parce que l’homme le plus sage n’est pas quelquefois maître de sa langue, je finirai le présent chapitre, pour m’ôter tout sujet de tentation. »
C’est délicieux comme une soirée entre amis où celui qui a la parole raconte une anecdote plaisante, en rajoute dans les détails, fait des apartés et des digressions pour tenir en haleine et amuser son public.
ÇA BRILLE SANS FROTTER
Une manière d’écrire très libre, aussi, très personnelle et totalement adaptée au sujet, adéquate, logique, pour transmettre cette imprévisibilité et cette verve du roman picaresque - je pense au Lazarillo de Tormes, mais aussi à Cervantès, tant celui des Novelas Ejemplares que celui du Quichotte – qui nécessite une écriture ouverte permettant l’expression de péripéties successives à partir d’un fil conducteur simple.
J’aime beaucoup cette construction, que Scarron a sut parfaitement acclimater à la langue française, loin de tout académisme, une écriture facétieuse, légère, désinvolte, très française dans ce que la langue française a de plus beau et de plus spécifique, ce qui distingue sa littérature des autres : le second degré, la profondeur teintée de légèreté, un certain art de la conversation mêlant virtuosité verbale et pensée libertaire – tout le contraire de Flaubert, dont Paul Léautaud disait : « Cet ébéniste littéraire frottait jusqu’à ce que cela brillât bien partout. »
Chez Scarron, pas besoin de frotter : ça brille tout seul.
©Sergio Belluz, 2018, le journal vagabond (2016).