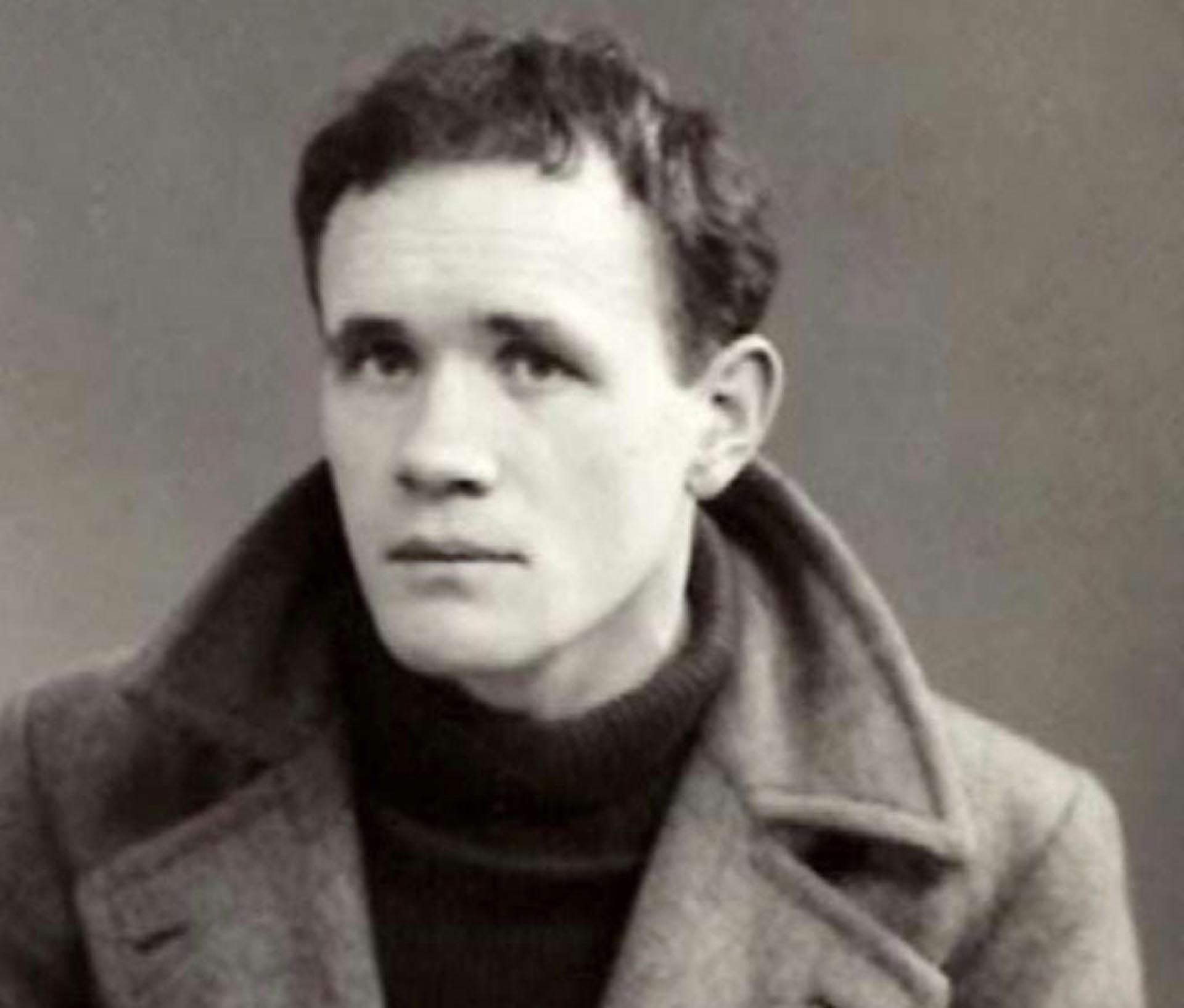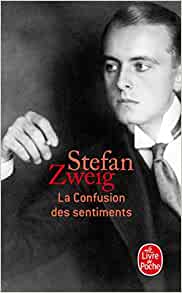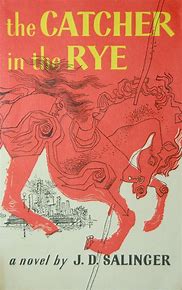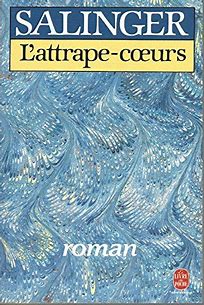NOTES DE LECTURE
Jean Genet et la censure
J’ai écouté avec beaucoup d’intérêt le troisième volet d’une série radiophonique sur Jean Genet.
Il s’agissait, cette fois-ci, d’une nouvelle biographie de Genet par un historien qui, en travaillant sur Genet enfant, abandonné à l’assistance publique, a eu accès au dossier du futur écrivain.
Il a constaté que Genet a bien été sans famille : il n’a pas connu son père, et sa mère, qui l’a placé à l’assistance, est morte deux ans après, je crois. Genet n’a jamais su qu’il avait un frère, lui aussi placé à l’assistance.
Mais l’historien insistait aussi sur le fait que Genet n’aurait pas eu l’enfance maltraitée qu’on lui a ensuite collé sur le dos.
Il a été recueilli dans une bonne famille, a été brillant à l’école primaire et à obtenu son Certificat d’étude.
Cet historien a aussi relevé les « sympathies nazies » de Genet, et c’était assez étonnant d’entendre le présentateur – très compétent, fin lecteur, bon critique – exprimer ses fortes réticences quant à la pertinence de relever des allusions à une possible « sympathie nazie » dans des romans qui, par définition, ne sont que des fictions, et à l’opportunité de faire de ces allusions des convictions personnelles de l’auteur.
Un autre intervenant sur ce sujet n’était pas d’accord non plus, et, dans un sens plus large, s’inquiétait – à juste titre, hélas – de ce qu’aujourd’hui on juge de la littérature sur un plan moral plutôt qu’esthétique.
Cette émission rediffusée était de 2006, je crois, et depuis cette tendance s’est confirmée, malheureusement.
On en arrive presque à cette forme absolue de censure stalinienne qui obligeait à faire de toute expression artistique un véhicule moral pour un communisme censé représenter le bonheur du citoyen soviétique...
©Sergio Belluz, 2022, le journal vagabond (2020)
Stefan Zweig et l’insomniaque
Ma nuit de sommeil, commencée vers 22.00, a été interrompue vers 3 heures du matin, impossible de me rendormir avant 4 heures.
J’en ai profité pour terminer La Confusion des sentiments de Stefan Zweig, sur ce jeune homme qui, sans le savoir, s’enamourache de son professeur spécialiste de Shakespeare – ce n’est pas anodin, il y a un lien avec le côté brut, sauvage, profondément humain du théâtre élisabéthain – ledit professeur étant en apparence lunatique et changeant, faisant alterner chez son élève moments d’angoisses et de dépressions avec moments de joie totale.
Le professeur finira par dire sa vérité : qu’il est tombé amoureux de ce jeune homme, qu’il est homosexuel, qu’il a eu beau se marier, ça n’a rien changé à sa condition, dont il a souffert depuis son enfance au collège jusqu’à cette rencontre, une condition qu’il avoue pour la première fois à ce jeune homme qui ne sait pas quoi faire de cet aveu et ne réagit pas comme il aurait dû le faire, bloqué par les conventions.
Le narrateur de l’histoire, c’est ledit jeune homme, devenu lui-même un homme mûr, qui se remémore cet amour et les étapes de cet amour liées à ses années de jeunesse et de formation.
Comme toujours chez Zweig – j’en ai parlé à propos d’un recueil de ses nouvelles qui réunissait Amok ou le fou de Malaisie, Lettre d’une inconnue et La Ruelle au clair de lune – je trouve qu’il y a cet attrait pour les comportements déviants, pour le voyeurisme, pour les relations perverses et sadomasochistes, et l’impact qu’elles ont sur des personnages très étriqués, très conditionnés, très « Viennois », dans leur peur de la sexualité et du sexe.
On se dit que ce n’est pas pour rien que Freud est précisément apparu dans cette société-là, ce qui fait, par exemple, que le protagoniste est tiraillé par des sortes de crises d’hystérie – qui nous semblent bien vieillottes aujourd’hui... – qui rappellent presque les tourments du « Sturm und Drang » pourtant très antérieurs à Zweig.
À sa parution, le roman a sans doute dû sembler très osé et a le mérite de parler d’homosexualité de manière très objective, presque scientifique, en tout cas sans jugement moral, tout en reprenant le schéma Maître-Disciple qui confine, chez Zweig, au modèle Maître-Esclave des jeux de rôles sadomasos.
Mais pour moi il y a quand même toujours, chez Zweig – et c’est ce qui me rebute chez lui, et que je retrouve aussi dans les nombreuses adaptations cinématographiques de ses œuvres – ce côté voyeur guindé qui ressemble beaucoup à ce que Mauriac disait à propos de Julien Green : « Un jeune homme qui assiste aux orgies avec des gants. »
©Sergio Belluz, 2022, le journal vagabond (2019)
Les livres cultes ne sont plus ce qu’ils étaient
Cherchant quoi lire avant de m’endormir, je tombe sur une édition de poche de The Catcher in the Rye de Salinger, en version originale (L’Attrape-cœurs en français), que j’avais lu il y a très longtemps et qui, apparemment, ne m’avait pas autant frappé que les millions de lecteurs (et de lectrices ?) qui en ont fait un best-seller mondial dans la catégorie « Roman jeunesse », un livre culte pour plusieurs générations, au même titre que Le Grand Meaulnes (1913) d’Alain-Fournier avant lui et la saga Harry Potter de Rowling plus près de nous.
J’ai vérifié : The Catcher in the Rye est paru en 1951.
Je comprends mieux la fascination qu’a exercé longtemps ce petit roman : la narration est faite par un adolescent, et ce point de vue a dû toucher directement tous les adolescents américains de cette époque et au-delà.
Il faut dire qu’aux États-Unis, le teenager est devenu, dans les années cinquante, une donnée sociologique, c’est à dire un nouveau consommateur, un nouveau segment de marché, un nouveau public-cible pour un capitalisme toujours en expansion.
C’est ce qui explique l’apparition de l’adolescence au cinéma, par exemple, avec des films destinés à ce public spécifique, entre les multiples comédies musicales avec Judy Garland et Mickey Rooney, les nanars sur la vie aventureuse de groupes d’ados ou encore Giant (1956) de George Stevens avec James Dean, l’archétype du teenager qui se cherche. Une sorte d’âge d’or ado qu’on peut parfaitement percevoir dans la reconstitution de ces années 50-60 par la comédie musicale Grease (1971) devenue film à succès en 1978, par American Graffiti (1973) de George Lucas tout comme par la célébrissime sitcom Happy Days (1974).
C’est aussi ce nouveau public-cible qui, plus tard, sera à l’origine de tas de comédies du réalisateur John Hughes avec la jeune rouquine Molly Ringwald, ainsi que de toute une série de films plus ou moins trashs autour du pucelage/dépucelage de quantités de jeunes héros et héroïnes, sans omettre le succès de films comme Carrie (1976) de Brian De Palma, qui se passe dans une High School, l’équivalent américain du lycée.
On n’oubliera pas non plus les productions Disney, avec sa fabrique de sitcoms doucereuses et artificielles ciblées sur les adolescents – le rire en boîte y est permanent et le jeu des acteurs caricatural pour ne pas dire factice – qui sont à l’origine de grandes vedettes mondiales qui, une fois finie l’adolescence et les séries nunuches, s’émancipent dans tous les sens du terme pour garder leur segment de marché : afin de casser leur image d’enfants sages et toucher un nouveau public-cible, on les sexualise à outrance dans des clips extrêmement racoleurs, et ce ne sont pas Britney Spears, Justin Timberlake ou Miley Cyrus, anciennes stars de l’Usine Disney, qui me contrediront.
UN TEEN NARRATEUR
Pour en revenir à The Catcher In The Rye, c’était un ton neuf à l’époque, avec quelque chose d’insolent qui a tout de suite plu dans ce narrateur adolescent dont l’écriture, dans sa fausse informalité, créée par des sortes de balises lexicales placées ça et là dans la phrase – je les mets en gras - , retranscrit littérairement, en jouant sur les registres, la langue informelle, très datée, dont les collégiens américains se servaient alors pour se différencier des parents qui, de toute façon, ne les comprenaient pas.
Le Mystère Salinger – pas d’interviews, pas de photos, et on ne sait pas grand chose de lui – a fait le reste.
En anglais, le roman commence par:
If you really want to hear about it, the first thing you’ll probably want to know is where I was born, and what my lousy childhood was like, and how my parents were occupied and all before they had me, and all that David Copperfield kind of crap, but I don’t feel like going into it. In the first place, that stuff bores me, and in the second place, my parents would have about two hemorrhages apiece if I told anything pretty personal about them. They’re quite touchy about anything like that, especially my father. They’re nice and all – I’m not saying that – but they’re also touchy as hell.
Ma traduction :
« Si ça vous intéresse vraiment, la première chose que vous vous demanderez c’est où je suis né et quel type de foutue enfance j’ai eue, et comment s’occupaient mes parents et tout ça avant de m’avoir, et tout ce genre de connerie à la David Copperfield, mais j’ai pas envie de me lancer là-dedans. Primo, ce genre de trucs ça m’ennuie, et secondo mes parents auraient deux hémorragies chacun si je racontais quoi que ce soit de vachement personnel sur eux. Ils sont plutôt soupe au lait sur un truc comme ça, surtout mon père. Ils sont gentils et tout ça – je dis pas – mais ils sont aussi sacrément soupe au lait. »
Plus loin, le narrateur parle de son école privée:
Anyway, it was the Saturday of the football game with Saxon Hall. The game with Saxon Hall was supposed to be a very big deal around Pencey. It was the last game of the year, and you were supposed to commit suicide or something if old Pencey didn’t win. I remember around three o’clock that afternoon I was standing way the hell up on top of Thomsen Hill, right next to this crazy cannon that was in the Revolutionary war and all.
Ma traduction :
« Bref, c’était le samedi du match de football avec Saxon Hall. Le match avec Saxon Hall était censé être un truc super important à Pencey. C’était le dernier match de l’année, et on était censé genre se suicider si le bon vieux Pencey ne gagnait pas. Je me rappelle que vers trois heures cet après-midi-là j’étais sur le foutu sommet de Thomsen Hill, juste à côté de ce canon débile utilisé dans la guerre de la Révolution et tout ça. »
LE CHAMP DE SEIGLE ET TOUT ÇA
Le titre original, The Catcher in the Rye vient d’une chanson mentionnée dans le livre.
C’est dans le chapitre seize, où le héros, Holden Caulfield, a abandonné sa Prep School – une école privée pour gosses de riches, l’équivalent américain d’une boîte à bachot – autour de Noël.
En fait, il en a été viré et se retrouve seul à New York, parce qu’il ne veut pas tout de suite rentrer chez lui. On suit ses errances et ses rencontres dans son long monologue adressé au lecteur :
It wasn’t as cold as it was the day before, but the sun still wasn’t out, and it wasn’t too nice for walking. But there was one nice thing. This family that you could tell just came out of some church were walking right in front of me – a father, a mother, and a little kid about six years old. They looked sort of poor. The father had on one of these pearl-grey hats that poor guys wear a lot when they want to look sharp. He and his wife were just walking along, talking, not paying attention to their kid. The kid was swell. He was walking in the street instead of on the sidewalk but right next to the kerb. He was making out like he was walking a very straight line, the way kids do, and the whole time he kept singing and humming. I got up closer so I could hear what he was singing. He was singing that song, ‘If a body catch a body coming through the rye’. He had a pretty little voice. He was just singing for the hell of it, you could tell. The cars zoomed by, brakes screeched all over the place, his parents paid no attention to him, and he kept on walking next to the kerb and singing ‘If a body catch a body coming through the rye’. It made me feel better. It made me feel not so depressed anymore.
Ma traduction :
« Il ne faisait pas si froid que le jour avant, mais le soleil n’était toujours pas apparu, et ce n’était pas très sympa pour se promener. Mais il y a eu un truc sympa. Cette famille qu’on pouvait voir qu’elle venait de sortir de l’église et qui marchait juste devant moi – un père, une mère, et un petit gosse d’environ six ans. Ils avaient l’air plutôt pauvres. Le père portait un de ces chapeaux gris perle que portent beaucoup les gars pauvres quand ils veulent avoir l’air bien mis. Lui et sa femme étaient juste en train de marcher, ils causaient, ils surveillaient pas leur gosse. Le gosse était super. Il marchait sur la route et pas sur le trottoir mais juste à côté de la marche. Il faisait comme si il était en train de marcher sur une corde raide, comme font les gosses, et il arrêtait pas de chanter et de fredonner. Je me suis rapproché pour entendre ce qu’il chantait. Il chantait cette chanson, ‘Si un corps arrête un corps qui sort d’un champ de seigle’. Il avait une jolie petite voix. Il chantait ça juste comme ça, on voyait bien. Les voitures passaient à ras, les freins crissaient dans tous les sens, ses parents ne s’occupaient absolument pas de lui, et il continuait à marcher le long du trottoir et à chanter ‘Si un corps arrête un corps qui sort d’un champ d’seigle’. Ça m’a fait me sentir moins déprimé du coup. »
LE TITRE? TOUT UN POÈME
Dans mon édition Penguin, c’est aux pages 179-180 qu’on apprend la vraie raison du titre The Catcher In the Rye, dans un passage où le narrateur, Holden Caulfield, s’adresse à sa soeur Phoebe :
You know that song “If a body catch a body comin’ through the rye” ? I’d like –
‘ It’s “If a body meet a body coming through the rye”! old Phoebe said. It’s a poem. By Robert Burns.’
She was right, though. It is ‘If a body meet a body coming through the rye’. I didn’t know it then, though.
‘I thought it was “If a body catch a body”, I said. ‘Anyway, I keep picturing all these little kids playing some game in this big field of rye and all. Thousands of little kids, and nobody’s around – nobody big, I mean – except me. And I’m standing on the edge of some crazy cliff. What I have to do, I have to catch everybody if they start to go over the cliff – I mean if they’re running and they don’t look where they’re going I have to come out from somewhere and catch them. That’s all I’d do all day. I’d just be the catcher in the rye and all. I know it’s crazy, but that’s the only thing I’d really like to be. I know it’s crazy.’
Old Phoebe didn’t say anything for a long time. Then, when she said something all she said was, ‘Daddy’s going to kill you.’”
Ma traduction :
« Tu sais, cette chanson ‘Si un corps attrape un corps qui sort d’un champ de seigle’ ? J’aimerais –
« C’est ‘Si un corps rencontre un corps qui sort d’un champ de seigle’ ! me dit ma vieille Phoebe. C’est un poème. De Robert Burns. »
Elle avait raison, donc. C’est bien ‘Si un corps rencontre un corps qui sort d’un champ de seigle’. Mais je ne le savais pas alors, donc.
« J’ai cru que c’était ‘Si un corps attrape un corps’, j’ai dit. « De toute façon, je continue à voir tous ces petits gosses en train de jouer une partie de quelque chose dans ce grand champ de seigle et tout ça. Des milliers de petits gosses, et il n’y a personne – pas de grands, je veux dire – sauf moi. Et je suis juste sur le bord d’une falaise débile. Ce que je dois faire, c’est que je dois attraper tout le monde s’ils commencent à s’approcher du bord de la falaise – je veux dire que s’ils sont en train de courir et qu’ils ne regardent pas où ils vont je dois surgir de quelque part et les attraper. C’est ce que je ferais toute la journée. Je serais juste l’attrapeur du champ de seigle et tout ça. Je sais que c’est dingue, mais c’est la seule chose que j’aimerais être. Je sais que c’est dingue. »
Ma vieille Phoebe n’a rien dit pendant un bon moment. Et puis, quand elle a dit quelque chose, elle a dit : « Papa va te tuer. »
L'ATTRAPE-COEURS, UN ATTRAPE-NIGAUD?
À la relecture, j’ai de la peine à comprendre comment ce roman a pu être classé dans les cent meilleurs du XXe siècle. Je le trouve assez fabriqué, truqué même: si la chanson du gosse déjà évoquée dans le chapitre seize est reprise dans cette scène entre Holden Caulfield et sa sœur, c’est qu’il faut bien conclure et caser une explication pour qu’on puisse comprendre le sens du roman et faire le rapprochement entre la chanson et les rêvasseries du collégien, sa peur de grandir, son immense ennui, sa recherche de sens, son désespoir, peut-être, son vague à l’âme en tout cas, son blues, allons-y carrément.
Or justement, cette chanson, l’élément-clé du roman – ce qu’on appellerait un révélateur en photographie – est introduite de manière artificielle : si la sœur du héros est une surdouée apparemment capable de corriger une citation d’un poète écossais du XVIIIe, on se demande bien comment un gosse de six ans d’une famille modeste de New York peut connaître et chantonner ces mêmes vers, ou alors le niveau scolaire newyorkais des années 50 était assez exceptionnel.
De même, dans la construction de l’histoire, les seules vraies péripéties sont uniquement dues aux diverse rencontres de cet ado le long de son périple – comme une Odyssée aux petits pieds, au final, Holden revient au luxueux duplex parental – qui permettent à Salinger de faire un portrait sarcastique (et vide, de mon point de vue) de camarades de classe, de professeurs, de chanteuses de cabaret, de prostituée, des personnages qui n’apportent strictement rien à l’histoire de cet adolescent.
Une autre possibilité, qui expliquerait avantageusement les incohérences du récit, serait de partir du postulat qu’on est dans un delirium tremens de l’adolescent narrateur. Il y a des points de ressemblance avec le côté errance-alcoolisée-en-quête-du-sens-de-la-vie-avec-tentation-suicidaire d’Under The Volcano (1947) de Malcolm Lowry, un roman tout aussi culte, mais parfaitement cohérent celui-là, et d’une construction extrêmement complexe, sans parler de sa narration, d’une richesse et d’une écriture autrement plus subtile.
On se dit surtout que The Catcher in the Rye, porté aux nues par plusieurs générations d’adolescents américains d’après-guerre qui se sont identifiés au rebelle Holden Caulfield, fils d’avocat, étudiant de boite à bachot de luxe et habitant un duplex dans le New York chic – on est loin de West Side Story – est d’abord et surtout un roman-culte pour plusieurs générations d’adolescents américains blancs de classe aisée, les mêmes qui, dans leurs quartiers ou leurs banlieues chics, et pour emmerder leurs parents tout en recevant un max d’argent de poche, font du rock, se biturent et fument de l’herbe avant de poursuivre leur existence en tant qu’adultes privilégiés...
D’où, pour moi, ce sentiment d’agacement pour ce récit un peu artificiel, cette histoire de fils à papa gâté qui peut se permettre de rater ses études et de faire passer ça pour une quête métaphysique.
©Sergio Belluz, 2021, le journal vagabond (2019).
Cet article est aussi paru dans le magazine en ligne LE PASSE-MURAILLE à l'adresse directe:
https://www.revuelepassemuraille.ch/les-livres-cultes-ne-sont-plus-ce-quils-etaient/
Casanova en Suisse : demain, j’arrête les filles. Ou pas.
On ne le répétera jamais assez : par la grâce d’un style qui doit son charme à une personnalité, une éducation, une intelligence, une fantaisie, un goût, une sensualité et une gourmandise tout italiennes, et par ses étonnantes capacités d’adaptation et d’observations, le Vénitien Casanova est un des plus grands écrivains d’expression française.
Dans sa célèbre Histoire de ma vie, écrite directement en français – et que je recommande de lire dans l’excellente édition parue en trois volumes dans la collection Bouquins Laffont –, c’est toute une Europe libre et libertine qui est décrite par ce voyageur et séducteur incorrigible, et cet observateur hors pair.
Giacomo Casanova par son frère Francesco
Évidemment, en chemin pour l’Italie ou l’Autriche, il est passé plusieurs fois par la Suisse, notamment en 1760 où – un moment de blues vite passé, heureusement, sinon nous n’aurions pas ses Mémoires – il a eu la tentation de rentrer dans les ordres…
CASANOVA ENTRE DEUX BAISES
« Une heure après être sorti de la ville [Zurich], je me trouve entre plusieurs montagnes ; je me serais cru égaré, si je n'avais pas vu toujours des ornières, qui m'assuraient que ce chemin-là devait me conduire dans quelque endroit hospitalier. Je rencontrais à chaque quart d'heure des paysans ; mais je me faisais un plaisir de ne prendre d'eux aucune information.
Après avoir marché six heures à pas lents, je me suis vu tout d'un coup dans une grande plaine entre quatre montagnes. J'aperçois à ma gauche en belle perspective une grande église attenante à un grand bâtiment d'architecture régulière, qui invite les passants à y adresser leur pas. Je vois, m'y approchant, que ce ne pouvait être qu'un couvent, et je me réjouis d'être dans un canton catholique [Schwytz]. J'entre dans l'église ; je la vois superbe par les marbres et par les ornements des autels, et après avoir entendu la dernière messe, je vais dans la sacristie où je vois des moines bénédictins.
Un d'entre eux qu'à la croix qu'il portait sur la poitrine je prends pour l'abbé, me demande si je désire voir tout ce qu'il y avait de digne d'être vu dans le sanctuaire sans sortir de la balustrade ; je lui réponds qu'il me fera honneur et plaisir, et il vient lui-même accompagné de deux autres me faire voir des parements fort riches, des chasubles couvertes de grosses perles et des vases sacrés couverts de diamants et d'autres pierreries.
EINSIEDEDELN, UNE ÉGLISE SACRÉE PAR JÉSUS LUI-MÊME
Comprenant fort peu l'allemand et point du tout le patois suisse qui est à l'allemand comme le gênois à l'italien, je demande en latin à l'abbé si l'église était bâtie depuis longtemps, et il me narre en détail l'histoire, finissant par me dire que c'était la seule église qui avait été sacrée par J.-C. même en personne.
Il observe mon étonnement, et pour me convaincre qu'il ne me disait que la pure et simple vérité, il me conduit dans l'église, et il me montre sur la surface du marbre cinq marques concaves que les cinq doigts de J.-C. y avaient laissées lorsqu'il avait sacré l'église en personne. Il avait laissé ces marques pour que les mécréants ne pussent pas douter du miracle, et pour débarrasser le supérieur du soin qu'il devait avoir de faire venir l'évêque diocésain pour la sacrer.
Le même supérieur avait appris cette vérité par une divine révélation en songe qui lui disait en termes clairs de n'y plus penser, car l'église était divinitus consecrata et que c'était si vrai qu'il verrait dans le tel endroit de l'église les cinq concavités. Le supérieur y alla, les vit, et remercia le Seigneur. »
LA VIE DE MOINE EN SUISSE
Casanova poursuit, dans le chapitre suivant, intitulé, dans ce merveilleux style des titres de chapitre à rallonge :
Je prends la résolution de me faire moine. Je me confesse. Délai de quinze jours. Giustiniani capucin apostat. Je change d'idée ; ce qui m'y engage. Fredaine à l'auberge. Dîner avec l'abbé
« Cet abbé, enchanté de la docile attention avec laquelle j'avais écouté son fagot, me demanda où j'étais logé, et je lui ai répondu nulle part, car en arrivant de Zurick [sic] à pied j'étais entré dans l'église. Il joint alors ses mains et les élève en regardant en haut, comme pour remercier Dieu de m'avoir touché le cœur pour aller en pèlerinage porter là mes scélératesses, car à dire vrai, j'ai toujours eu l'air d'un grand pécheur. Il me dit qu'étant midi, je lui ferais honneur en allant manger la soupe avec lui, et j'ai accepté.
Je ne savais pas encore où j'étais, et je ne voulais pas le demander, bien aise de laisser croire que j'étais allé là en pèlerinage exprès pour expier mes crimes. Il me dit chemin faisant que ses religieux faisaient maigre, mais que je pourrais manger gras avec lui, puisqu'il avait obtenu un bref de Benoît XIV qui lui permettait de manger gras tous les jours avec trois convives. Je lui ai répondu que je participerai volontiers de son privilège.
L’ÂME ET L’ESTOMAC (ET INVERSEMENT)
D'abord entré dans son appartement il me montra le bref en cadre couvert d'une glace, qui était au-dessus de la tapisserie, vis-à-vis de la table, exposé à la lecture des curieux et des scrupuleux. N'y ayant que deux couverts, un domestique à livrée en mit vite un autre. - "Je dois avoir, me dit-il d'un air modeste, une chancellerie parce que, en qualité d'abbé de Notre-Dame d'Einsiedel [sic], je suis aussi prince du Saint-Empire romain." J'ai respiré. Je savais à la fin où je me trouvais, et j'en étais enchanté car j'avais lu et entendu parler de Notre-Dame des Ermites. C'était le Loretto d'en deçà des monts.
À table, l'abbé prince crut de pouvoir me demander de quel pays j'étais, si j'étais marié, et si je comptais de faire le tour de la Suisse, en m'offrant des lettres partout où je voudrais aller. Je lui ai répondu que j'étais vénitien et garçon, et que j'accepterais les lettres dont il voulait m'honorer après que je lui aurais dit qui j'étais dans une conférence que j'espérais d'avoir avec lui, où je lui communiquerais toutes les affaires qui regardaient ma conscience.
Voilà comme je me suis engagé à me confesser à lui sans en avoir eu la pensée avant l'instant. C'était ma marotte. Il me paraissait de ne faire que ce que Dieu voulait, lorsque j'exécutais une idée non préméditée tombée des nues. Après lui avoir ainsi dit assez clairement qu'il allait être mon confesseur, il me fit des discours pleins d'onction, qui ne m'ennuyaient pas pendant un dîner très délicat où entre autres il y avait des bécasses et des bécassines. »
ET PUIS NON, FINALEMENT
Heureusement pour nous, un peu après, Casanova se trouve à Soleure où il a un énième coup de foudre et où il remarque, tout émoustillé et lucide sur lui-même :
"Cet échantillon de ma bonne fortune me détermina à passer à Soleure tout le temps qui pourra m'être nécessaire à me rendre parfaitement heureux. Je me suis sur-le-champ décidé à louer une maison de campagne. Tout homme dans ma situation, né avec du coeur, aurait pris la même résolution.
Je voyais devant moi une beauté achevée que j'adorais, dont j'étais sûr de posséder le coeur, et que je n'avais qu'effleurée; j'avais de l'argent, et j'étais mon maître. Je trouvais cela beaucoup mieux raisonné que le projet de me faire moine à Einsidel [sic]."
On respire. Mais quel suspense !
©Sergio Belluz, 2020, le journal vagabond (2020).
Giacomo Casanova par Anton Raphael Mengs
Louise de Vilmorin à l’œuvre
Délicieux moments passés, hors du temps, à retrouver et à écouter Louise de Vilmorin dans des portraits et des interviews radio : quelle voix, quelle diction, quel phrasé, quelle passion, quelle tristesse, quelle fantaisie, quel charme !
Ses inflexions, ses phrases châtiées, parsemées de mots plus populaires, son ton (qui m’a rappelé Sylvie Joly dans certains de ses personnages snobs), sa vivacité, ont quelque chose de terriblement séducteur.
Louise de Vilmorin - Une vie, une oeuvre: 1902 - 1969 (France Culture, 1994)
Une élégance du désespoir, une tristesse souriante, une manière d’écarter les nuages d’une boutade tout en ayant les yeux embués.
Ça m’a donné envie de la lire, et de relire ses Carnets, que j’avais lus il y a un moment, et que j’avais beaucoup aimés, déjà.
Dans les interviews sur elle, Jean Chalon, un des biographes de Louise de Vilmorin, parlait de sa correspondance, qui était comme une sorte de journal intime.
Est-ce qu’elle existe, cette correspondance ? Est-ce qu’elle a été publiée ? Les extraits qui étaient lus étaient des merveilles d’écriture, de vie, d’observation, de formules très compactes et très drôles.
C’est quand même quelqu’un qui a correspondu avec Cocteau, Saint-Exupéry, Malraux et toute la crème d’une certaine intelligentsia joyeuse (rien à voir avec Breton ou Sartre).
QU'EST-CE QU'UNE OEUVRE?
Louise de Vilmorin, c’est comme un Jean Cocteau au féminin, sans une œuvre aussi conséquente...
...ou peut-être que si, mais sous d’autres formes, ses quelques romans, ses carnets, sa correspondance.
C’est toujours la même chose : le marché littéraire subdivise la production éditoriale en genres rentables (roman, roman jeunesse, « self-help ») et passe à côté de chefs-d’œuvre de langue et de littérature qui n’entrent dans aucune catégorie.
Il y a une virtuosité littéraire et linguistique chez Louise de Vilmorin, une maîtrise de la langue, une originalité, une inventivité incomparable.
Et quel charme !
©Sergio Belluz, 2019, le journal vagabond (2018)
Chez Balzac, sans endettement pas de Comédie Humaine
C’est dans Le Père Goriot, roman central à toute La Comédie Humaine, que Balzac, à propos de Rastignac, évoque ces futilités, ces luxes indispensables à la jeunesse ambitieuse.
Il en connaissait quelque chose : en consommateur compulsif, Balzac s'est endetté à vie pour avoir tous ces attributs et ces babioles qu'il jugeait indispensables à l'image d'un écrivain.
C'est d'ailleurs à ça qu'on doit La Comédie Humaine, car pour obtenir toujours plus d'argent et rembourser ses dettes, il signait avec plusieurs éditeurs et devaient ensuite écrire en trois mois des énormes pavés comme Illusions perdues ou Splendeurs et Misères des Courtisanes publiés d’abord en feuilleton dans des revues, puis republiés (et à chaque fois remaniés) en livre.
C’est passionnant de visiter la maison-musée de Balzac, Rue Raynouard, dans le seizième arrondissement de Paris.
C'est le premier musée que je suis allé visiter à Paris la première fois que j'y suis allé, après avoir lu toute La Comédie Humaine avec passion, avec folie – quelques 120 romans et nouvelles –, sans compter les Lettres à l’Étrangère, la correspondance de Balzac avec Mme Hanska, son admiratrice et le grand amour de sa vie, une noble polonaise qui, une fois son mari mort, l'épousera, trois mois avant que Balzac meure d'épuisement.
Cette maison, avec sa double entrée - ou plutôt sa double sortie, il y en avait une qui lui permettait de fuir les créanciers (à cette époque, on finissait en prison pour dettes) –, m'avait profondément ému.
On y voyait quelques-unes des extravagances de ce formidable tempérament, ses gants jaunes d'écrivain mondain, sa canne avec pommeau d'émeraude...
Extravagances qui avaient aussi leur logique publicitaire : il s’agissait à la fois d’avoir l’allure du grand écrivain à succès, et de le faire croire aux éditeurs.
Un gros bluff, un coup de poker pour négocier de meilleurs contrats et, ainsi, rembourser plus vite des dettes qui ne cessaient de croître.
À quoi tiennent les choses.
©Sergio Belluz, 2019, le journal vagabond (2003).
Paul Morand - Coco Chanel: même combat (et même verve)
Magnifique et virtuose, L’Allure de Chanel, ce récit que Paul Morand consacre à Coco Chanel et qui est comme un long monologue de la créatrice de mode, dont il rend parfaitement la manière de parler, les tournures – dans tous les sens du terme – le ton sec et péremptoire, et l’intelligence désabusée:
« Si j'ai su rendre autour de moi les gens heureux, je n'ai pas pour moi-même le sens du bonheur.
Le scandale me dérange.
J'ai diverses sortes de pruderies.
De même que je n'arrive pas à sortir de chez moi, je n'aime pas qu'on dérange mon monologue, je n'aime pas sortir de mes idées.
J'ai détesté qu'on mette de l'ordre dans mon désordre, ou dans mon esprit.
L'ordre est un phénomène subjectif.
Je déteste aussi les conseils, non parce que je suis têtue, mais au contraire parce que je suis influençable.
D'ailleurs les gens ne vous donnent que des jouets, des médecines ou des conseils qui sont bons pour eux.
Je n'aime pas non plus m'attacher, car dès que je tiens à quelqu'un, je suis lâche; or la lâcheté me déplaît.
Comme dit Colette, en citant Sido: « L'amour n'est pas un sentiment honorable. »
J'adore critiquer; le jour où je ne critiquerai plus, la vie pour moi sera finie. »
©Sergio Belluz, 2019, le journal vagabond (2006).