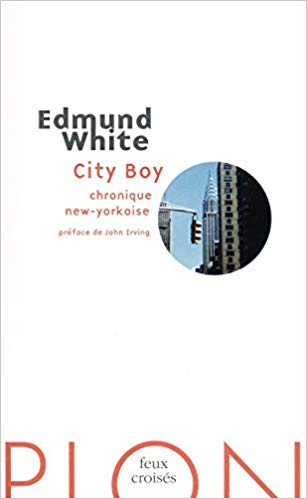Hommage à Edmund White, mémorialiste queer (4): ‘City Boy ’ (2009)
Pour qui veut connaître de l’intérieur le New York des années 60 et 70, le New York de la bohème littéraire et artistique gay mais pas toujours gaie, le New York du sexe, de l’alcool, des drogues de toutes sortes, de la débauche créative tous azimuts, le New York effervescent de Warhol, de Basquiat, de Susan Sontag, de Mapplethorpe, de Stonewall, de Greenwich Village et du début du disco, le New York de toute une génération de gens brillants décimés par le SIDA, impossible de ne pas lire avec délice, nostalgie et tristesse à la fois le City Boy : My Life in New York During the 1960’s and 1970’s (London : Bloomsbury, 2009, en français City Boy, Paris : Plon, 2010), les extraordinaires mémoires d’Edmund White à ce sujet.
On y retrouve tout son talent d’écrivain mémorialiste-chroniqueur-concierge et son écriture aux descriptions fidèles et cancanières à la fois, qu’il résume très bien en décrivant d’une phrase le style de toute une génération de poètes newyorkais (John Ashbery, Kenneth Koch, James Schuyler...) qui « louaient leur ville avec désinvolture, en haussant les épaules, mais en termes mystérieusement précis » (« hymning the city in the same casual, shrugging, but secretly precise terms. »).
Plus loin, il évoque avec émotion et drôlerie le style de son ami David Kalstone, universitaire, biographe et essayiste littéraire, spécialiste entre autres de la poétesse Elizabeth Bishop – « David had found a compelling middle path between gossipy narrative and academic close reading. » (« David avait trouvé un moyen terme irrésistible entre le commérage et l’étude académique poussée ») – qui s’applique parfaitement à la méthode White.
HUMOUR PROUSTIEN
Pleine d’un humour désinvolte toujours teinté d’une légère tristesse, la prose de White, son style, subtil et proustien dans ses circonvolutions, englobe parfaitement tous les détails d’une comédie humaine passée et brillante – et même clinquante sous bien des aspects – avec une causticité, voire une vacherie qui a l’art de remettre tout ce beau monde à sa juste place :
« It is difficult to convey the intensity and confusion in our minds back then in the sixties and early seventies as we tried to reconcile two incompatible tendencies – a dandified belief in the avant-garde with a utopian New Left dedication to social justice (...) What was shared by these two doctrines – the continuing (and endless) avant-garde and radical politics – was an opposition to the society around us, which we judged to be both philistine and selfish. »
(Ma traduction): « Il est difficile de transmettre toute l’intensité et toute la confusion des esprits de ces années soixante, début des années soixante-dix, où l’on essayait de réconcilier deux tendances incompatibles – une foi snobinarde dans l’avant-garde et un engagement utopique Nouvelle Gauche pour la justice sociale (...) Ce que ces deux doctrines exprimaient – la continuelle (et incessante) avant-garde et la radicalité –, c’était une prise de position contre la société dans laquelle nous vivions, que nous jugions à la fois béotienne et égoïste. »
RASTIGNAC À NEW YORK
White, à travers sa propre expérience, transcrit bien, avec sévérité et bienveillance, toutes les aspirations, naïves quelquefois, du jeune homme ambitieux et lettré qu’il était alors, sorte de Rastignac se faisant son chemin à New York, gravissant les échelons culturels, entrant dans les cercles littéraires dans l’espoir, un jour, d’en faire partie :
« As in so many situations in those days, I was the youngest and least well-known person at the the table, not silent but certainly mostly a listener. I longed for literary celebrity even as I saw with my own eyes how little happiness it brought. For me, I suppose, fame was a club one yearned to join, obsessing over it night and day until the moment one was admitted, and after that never thought about again. But with one difference: literary fame, unlike club membership, was something you could lose as quickly as you gained. Now, in my nearly half century of being “on the scene”, I’ve witnesssed so many reputation come and go. Who remembers William Goyen (though his House of Breath is still popular in
(Ma traduction) « Comme souvent à cette époque, j’étais le plus jeune et le moins connu à la table, pas silencieux mais plutôt auditeur. Je rêvais d’une gloire littéraire alors même que je pouvais observer avec mes propres yeux le peu de bonheur que ça procurait. Pour moi, j’imagine que la célébrité était comme un club dans lequel il fallait absolument entrer, une obsession de chaque instant jusqu’à ce qu’on y soit admis, qu’on oubliait une fois qu’on en faisait partie. Avec une différence, toutefois : la gloire littéraire, au contraire d’une carte de membre d’un club, pouvait se perdre aussi rapidement qu’on l’avait obtenue. Aujourd’hui, à près de cinquante ans de présence « dans le milieu », j’ai vu tant de réputations naître et disparaître. Qui se rappelle de William Goyen (même si son House of Breath [La Maison d'haleine, Paris: Gallimard, 1982] est encore très connu en France) ? Ou de By Love Possessed, le « bestseller littéraire » de James Gould Cozzens ? De Don Marquis et son adulé Archy and Mehitabel ? »
JAMES MERRILL, LE DANTE DE NEW YORK
Du monde littéraire de cette époque, j’ai beaucoup aimé son portrait du célèbre poète James Merrill, auteur de The Changing Light at Sandover, qui se voulait rien de moins qu’une réponse à la Divine comédie de Dante :
« Whereas Dante wrote mostly about historical figures, Merrill lent a mythical dimension to his own friends, many of them otherwise unknown. This strategy of elevating one’s own experience had become more and more common since the collapse of a widely shared general culture (Proust is the star example of this new manner). Whereas Dante claimed he’s actually travelled into the afterlife and observed everything firsthand, Merrill communicated with his dead through the Ouija board, which all felt to me amateurish and “fun”, the Delphic oracle reduced to a parlor game. »
(Ma traduction: « Alors que Dante a surtout écrit sur des personnages historiques, Merrill a donné une dimension mythique à ses propres amis, la plupart inconnus par ailleurs. Cette stratégie de mettre en avant sa propre expérience était devenue de plus en plus commune depuis la disparition d’une culture générale partagée de tous (Proust en est l’exemple le plus célèbre). Là où Dante affirme qu’il a vraiment voyagé dans l’au-delà et qu’il a tout observé par lui-même, Merrill communiquait avec ses morts à travers une planche de Ouija, ce qui me semblait terriblement amateur et « sympa », l’oracle de Delphe devenant un jeu de société. »)
VLADIMIR NABOKOV : PEUT MIEUX FAIRE !
Impossible non plus, de ne pas s’amuser à son évocation de Vladimir Nabokov, avec qui White, qui travaillait alors à la Saturday Review de San Francisco, a eu l’occasion de collaborer sur un projet :
« He was my favourite living writer along with Christopher Isherwood. Different as Nabokov and Isherwood were from each other, both inspired me with a respect bordering on reverence and an excited anticipation for each new title. Nabokov was funny and wicked, baroque and heterosexual; Isherwood was sober and good and classical and gay.»
(Ma traduction) : « C’était mon écrivain vivant préféré avec Christopher Isherwood. Bien que différents l’un de l’autre, les deux m’inspiraient un respect à la limite de l’idolâtrie et une attente fébrile pour chaque nouvelle parution. Nabokov était drôle et méchant, baroque et hétérosexuel ; Isherwood était sobre et gentil et classique et gay. »
On apprend non seulement que Nabokov parlait l’anglais avec un accent pour le moins mélangé – « His a’s were long and English, his r’s rolled and Russian, his accent more French than anything else, at least to my untrained ears », « ses a étaient longs et anglais, ses r étaient roulés et russes, son accent plutôt français, du moins pour mes oreilles profanes » – mais qu’en plus son anglais écrit n’était pas parfait non plus, au grand embarras de White, forcé de réviser le texte :
« Nabokov’s mini-essay had minor mistakes in punctuation and even in diction. How did one edit Nabokov? My solution was to have the essay set exactly as he’d written it, mistakes and all, then to reset it in my corrected version. I messengered both versions to him with a short but polite letter explaining what I’d done. He wired back YOUR VERSION PERFECT. »
(Ma traduction) : « Le court texte de Nabokov contenait quelques petites fautes de ponctuation et même de diction. Comment est-ce qu’on corrige Nabokov ? Ma solution a été de garder le texte exactement comme il l’avait écrit, fautes comprises et de le reprendre dans une version corrigée par ma main. Je lui fis parvenir les deux versions accompagnée d’une courte note d’explication. VOTRE VERSION PARFAITE me télégraphia-t-il en retour. »
BORGES ET SES CALEÇONS
Enfin, comment ne pas s’amuser à l’évocation de Borges, invité à New York pour donner une conférence :
« He and his companion Maria Kodama (later his wife), had to fly first-class, of course, from Buenos Aires, and we arranged for them to stay in a beautiful NYU apartment looking down on
« Lui et sa compagne Maria Kodama (sa future épouse), devaient voyager depuis Buenos Aires en première classe, naturellement, et on s’était arrangé pour qu’ils séjournent dans un magnifique appartement de l’Université de New York avec vue sur Washington Square. Le seul problème, c’était l’absence de service de maison. Maria Kodama m’appela un dimanche après-midi pour me demander « qui allait laver les sous-vêtements de Borges ? » Je me serais volontiers porter volontaire mais craignait d’embarrasser tout le monde. Au final, je dus engager une femme de ménage à cent dollars l’heure pour qu’elle aille chez eux le dimanche soir pour laver les distinguées culottes. »
La littérature, c’est aussi une question de linge sale.
©Sergio Belluz, 2019, le journal vagabond (2019)
A découvrir aussi
- Hommage à Edmund White, mémorialiste queer (1) : ‘Skinned Alive’ ('Écorché Vif', 1997)
- Hommage à Edmund White, mémorialiste queer (2) : ‘States of Desire’ ('Les États du Désir')
- Hommage à Edmund White, mémorialiste queer (3): ‘The Farewell Symphony’ (La Symphonie des Adieux)
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 113 autres membres