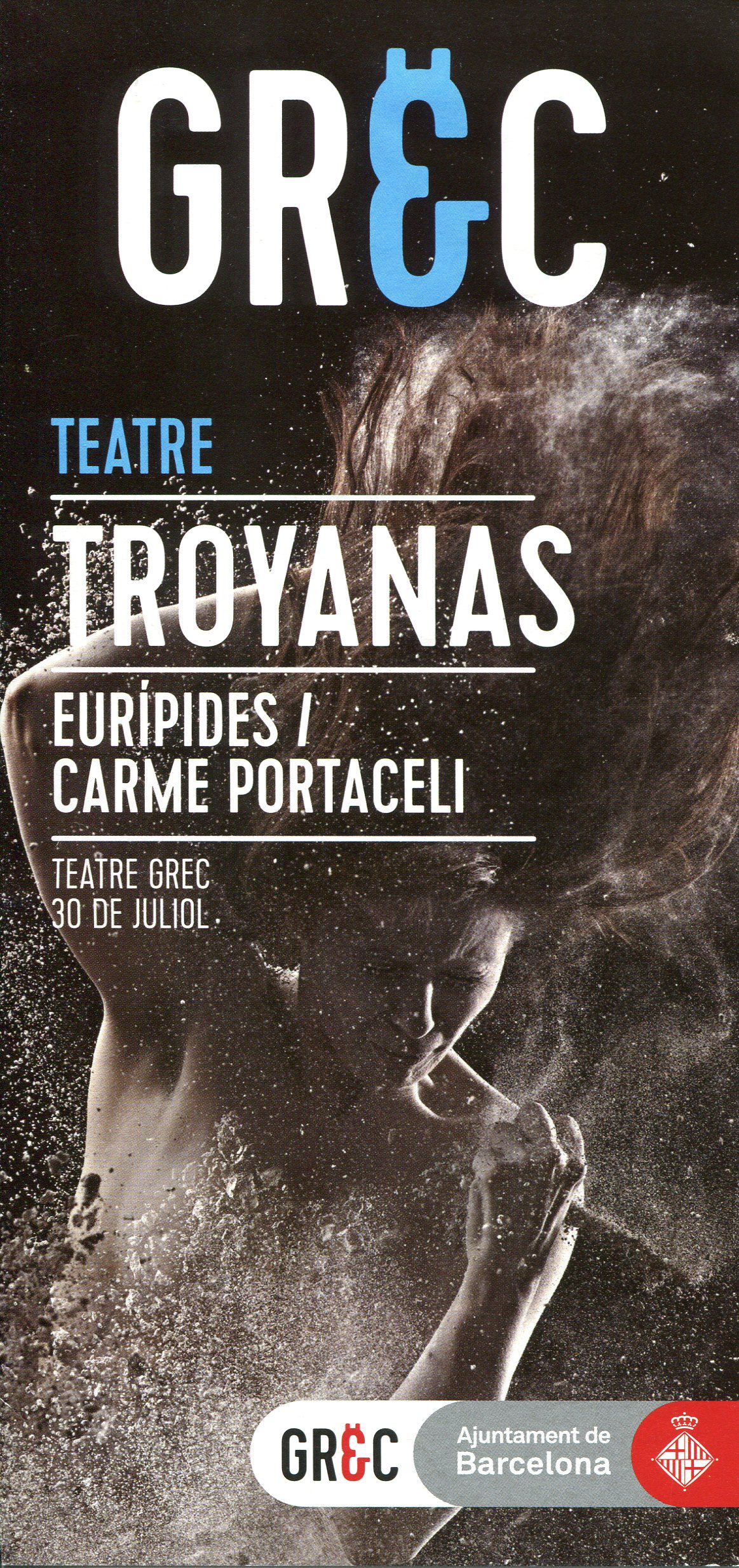La puissance et la magie du texte au théâtre (‘Les Troyennes’ d’Euripide)
LA FORCE DU VERBE
Je suis convaincu qu’un des critères majeurs pour juger de la valeur d’un texte de théâtre – je ne parle pas de création scénique, mais bien de texte, et de texte écrit spécifiquement pour la scène – est le fait que les grands textes théâtraux se suffisent à eux-mêmes, qu’ils restent toujours actuels, qu’ils détiennent une parcelle des constantes humaines, qu’ils n’ont pas besoin de grands décors, de costumes spectaculaires, de mise en scène élaborée, qu’on peut même les lire simplement chez soi, parce que la seule force du verbe crée immédiatement tout un univers qui bouleverse ou fait rire le spectateur comme le lecteur.
J’aime beaucoup le théâtre. J’en lis régulièrement et suis touché en profondeur par de grands textes que je n’ai pas nécessairement besoin de voir sur scène : à la lecture, je les entends, je les vois dans mon théâtre intérieur aussi clairement que si je les voyais interprétés, souvent plus clairement, d’ailleurs, vu les massacres perpétrés réguliérement sur des textes extraordinaires à cause de l’omnipotence actuelle du Metteur en Scène avec majuscules qui, par ignorance crasse, narcissisme ou esprit de carrière, tire la couverture à lui, ne comprend pas le texte ou ne l’écoute pas, lui cherche des subtilités qui n’y sont pas et, quand il le faut, les y rajoute lui-même.
C’est une chose de rattacher un texte, une pièce, à la réalité que nous vivons, le théâtre étant, par définition, un miroir qui reflète chaque société qui le fait revivre. C’en est une autre d’y projeter des obsessions ou des fantasmes personnels au mépris du sens de la pièce...
Les grands dramaturges grecs et romains, ou Shakespeare, ou Racine, ou Molière, ou Marivaux, ou Schiller, ou Labiche, ou Feydeau, ou Wilde, ou Tchekhov, ou Pirandello, ou Guitry, ou Cocteau, ou Obaldia, ou De Filippo, ou Anouilh, ou Frisch, ou Dürrenmatt, ou Beckett ou Orton, ou Dubillard, ou Reza, ou Mouawad n’ont pas besoin d’artifices, leur langue, telle une musique, s’impose d’elle-même, comme la poésie.
‘LES TROYENNES’ D’EURIPIDE : ACTUELLES, HÉLAS...
Ça ne m’empêche pas d’être toujours intéressé par une mise en scène honnête ou irrespectueuse, classique ou contemporaine, modeste ou luxueuse, pourvu qu’elle soit cohérente dans son point de vue, et que sa scénographie et sa mise en scène ne couvrent pas, n’étouffent pas ou ne tronquent pas le texte qu’elles sont censées mettre en valeur et qu’on est censé entendre.
C’est à quoi je pensais en assistant, dans le cadre du GREC, le Festival de Théâtre de Barcelone et sur la gigantesque scène du magnifique amphithéâtre à la grecque situé sur la colline du Montjuïc, à une nouvelle version, espagnole cette fois – une langue qui va bien à la tragédie grecque, âpre, sauvage, passionnelle, lyrique, comme un chant flamenco – des ‘Troyennes’ d’Euripide (jouée pour la première fois en 415 avant Jésus-Christ...) dans une coproduction du Festival International du Théâtre Classique de Mérida 2017/Teatro Español de Madrid, et dans une traduction d’Alberto Conejero, une mise en scène de Carme Portaceli, une brillante distribution (Ernesto Alterio, Gabriela Flores, Maggie Civantos, Magda Flores, Míriam Iscla), et surtout une Hécube extraordinaire d'intensité, de beauté et de désespoir interprétée par la très grande Aitana Sánchez-Gijón.
Portaceli écrit dans sa présentation : « Les tragédies montrent un ordre et la relation entre l’individu et la collectivité. Elles montrent le péché que commet l’individu contre le bien-être social quand il se laisse emporter par ses sentiments les plus brutaux, la peur, l’arrogance, la jalousie... Aujourd’hui nous voyons comment les femmes sont des êtres de seconde classe dont le sort importe peu : après chaque guerre, et surtout pendant la guerre et sans la guerre, on viole les femmes, on leur manque de respect, on les maltraite sans craindre les lois qui interdisent la violence... Peu importe, leurs problèmes, leurs souffrances viennent toujours en dernier, il y a toujours des problèmes plus importants : les enfants, la faim, les réfugiés... »
LA GUERRE DE TROIE A TOUJOURS LIEU
Le décor ? Un grand ‘T’ (pour Troie) renversé sur la scène, qui synthétise clairement la chute de Troie. Sur ce ‘T’ sont projetés à certains passages, des images de femmes. Au dos du ‘T’, un échafaudage, sur lequel à certains moments une ou plusieurs protagonistes montent. Le sol est jonché des cadavres dans des sacs.
Survient d’abord, depuis la salle, un homme, le coryphée, qui s’adresse à nous tous en disant : « Je suis comme vous, je suis normal, je mène une vie normale, on ne tue pas ma famille, on ne viole pas ma fille ou ma femme, et si ma vie contient une certaine violence, au travail, ou dans le métro, je me défends par la parole... Mais si j’étais dans d’autres circonstances quels crimes serais-je capable de commettre, par peur, par haine, par désir de vengeance ? »
Puis le coryphée devient Thaltybios, le porte-parole d’Agamemnon, venu faire connaître aux Troyennes (Hécube, Cassandre, Polyxène, Andromaque, Hélène...), le sort que les Grecs réservent aux survivants des héros troyens vaincus et tués dans la guerre de Troie, épouses, soeurs, enfants.
Les Troyennes entrent, alors, marchant entre les cadavres de ces hommes qu’elles ont aimés ou portés en elles. Et elles parlent. Et c’est toute la terreur, tout le désespoir de ces femmes vaincues, de toutes les femmes vaincues de tous les pays en guerre, passés et actuels, qui sont exprimés dans ce texte extraordinaire, dans cette langue âpre et pure.
EROS ET THANATOS – L’AMOUR ET LA GUERRE
On est immédiatement happés par les délires visionnaires de Cassandre, qui dévoile avec une joie cruelle et sans qu’on la croie, le destin de ces vainqueurs Grecs qui vont payer cher leur victoire et leur arrogance.
Et comme on comprend aussi le personnage ambigu d’Hélène, cette belle Hélène qui affronte Hécube en lui disant qu’elle n’est pour rien dans ce qui arrive, qu’elle est aussi une Troyenne, que Pâris est tout aussi coupable qu’elle.
Après tout, n’est-ce pas Hécube elle-même qui a donné naissance à Pâris, alors qu’un oracle lui avait prédit qu’il causerait la destruction de Troie ? (« Quoi, tu aurais voulu que sur la foi d’un charlatan je tue mon propre enfant ? », lui rétorque Hécube).
Hélène rappelle aussi à Hécube que Pâris, ayant à choisir la plus belle des trois déesses, Héra, qui lui promettait l’Europe et l’Asie, Athéna, qui lui offrait la victoire des Troyens sur les Grecs et Aphrodite, qui lui proposait la plus belle femme du monde, avait choisi la femme.
Enfin, elle jette à Hécube : « Et tu crois que c’est à cause de moi que les Grecs sont venus détruire Troie ? Ce sont les richesses de Troie qui ont été la cause de cette guerre, pas moi. Moi, j’ai fui mon mari Ménélas et mon royaume de Sparte. J’ai aimé ton fils et il m’a aimée. »
CATHARSIS : COMPASSION ET TERREUR PARTAGÉES
Racine, parlant d’Euripide dans sa préface à sa propre pièce ‘Iphigénie’, voit en Euripide un poète « extrêmement tragique, c’est-à-dire sachant merveilleusement exciter la compassion et la terreur, qui sont les véritables effets de la tragédie. »
Cette compassion, et cette terreur, après avoir ému les publics de plus de deux mille cinq cents ans (25 siècles!) de représentations successives, n’a rien perdu de sa violence, de sa force, de sa beauté, de son efficacité.
On est toujours horrifié par la douleur d’Andromaque, femme d’Hector, et belle-fille d’Hécube, lorsqu’elle doit se séparer pour toujours de son fils Astyanax, condamné à être précipité du haut des murs de la ville :
Tu pleures, mon tout petit ? Cesse, je t’en prie.
Tu ne peux savoir ce qui t’attend.
- Que sera-ce ? Une longue, longue chute – ton corps brisé
Et personne pour te prendre en pitié.
Embrasse.moi. Jamais plus. Viens plus près, plus près encore.
Ta mère qui t’a porté... entoure mon cou de tes bras,
Embrasse-moi, lèvres contre lèvres.
Et on est toujours bouleversé par le désespoir d’Hécube, femme de Priam, quand elle apprend qu’elle sera l’esclave d’Ulysse, comme on comprend sa rage lorsqu’elle apprend que Cassandre, encore vierge, deviendra l’esclave d’Agamemnon, comme on comprend sa douleur et son désespoir lorsque Thaltybios lui dit que sa fille Polyxène a été immolée sur la tombe d’Achille et que sa belle-fille Andromaque deviendra l’esclave de Néoptolème, le fils d’Achille, et comme on comprend son hébétude lorsqu’elle assiste à la destruction totale par le feu de cette ville dont elle a été la reine :
Troie a péri, la grande cité.
Seule y vit encore la longue flamme rouge.
La poussière s’élève, elle s’étale comme une immense aile de fumée
Et tout en est recouvert.
Nous aussi nous partons, l’une ici, l’autre là
Et Troie a disparu à jamais.
Adieu, chère cité.
Adieu, ma patrie, où mes enfants ont vécu.
Là-bas, les vaisseaux grecs attendent.
C’est ça, un grand texte de théâtre: un monde, une force, une musique.
©Sergio Belluz, 2017, le journal vagabond (2017)
A découvrir aussi
- À propos de 'Providence' d’Olivier Cadiot au Théâtre de Vidy à Lausanne.
- Arts de la scène : le Festival de Barcelone (GREC), c’est Avignon à la plage et en moins cher!
- Pasolini, le personnage
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 113 autres membres