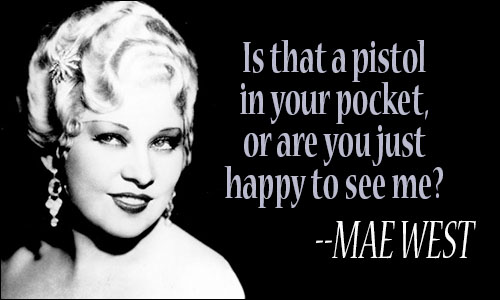L’Amérique, son capitalisme, sa culture et Lucille Ball
On lit et on entend souvent aujourd’hui, dans les portraits et les interviews d’actrices comiques ou de comédiennes de stand-up, que, pour faire rire, elles auraient dû braver de terribles préjugés masculins, de contraignant stéréotypes esthétiques féminins qui auraient jusqu’ici empêché les comédiennes de faire rire sous peine de déplaire, de s’enlaidir, de paraître vulgaire ou trop masculine.
C’est évidemment complètement faux : tant dans l’histoire du théâtre que du cinéma, les actrices comiques ont toujours existés et ont toujours été adorées, hors de tout stéréotype, juste pour leur talent, leur manière de faire rire et le charme qui en découle.
Rien qu’en France on peut remonter à Marie-Anne Dangeville chez Destouches, Armande Béjart et la Dugazon chez Molière, par exemple. Au XIXe, Virginie Déjazet séduit tout Paris dans ses vaudevilles, tout comme Alice Ozy, au Théâtre des Variétés, Jenny Colon (le grand amour de Nerval) à l’Opéra-Comique, Armande Cassive (la première Môme Crevette chez Feydeau), la drôlissime Madame Sans-Gêne de Réjane pour Victorien Sardou, et le charme comique d’Ève Lavallière dans les comédies et les opérettes fin de siècle, tout comme, au cabaret, la séduisante verve musicale, textuelle et sexuelle d’Yvette Guilbert, que Toulouse-Lautrec a si bien peinte.
Quant au XXe siècle, Pauline Carton, tout comme Marguerite Moreno, la muse de Marcel Schwob, égaient de leur fantaisie les comédies de Sacha Guitry, et n’oublions pas Arletty et son port de reine, le charme raffiné et la diction châtiée de Sophie Desmarets, l’insolence sensuelle et hilarante de Sophie Daumier, et toute la génération de comiques qui vont d’Anne-Marie Carrière à Florence Foresti, en passant par Jacqueline Maillan, Zouc, Muriel Robin ou Shirley, avec ou sans Dino.
Je mentionne aussi, en passant, les stars comiques et sex-symbols américaines, tant à Broadway qu’à Hollywood ou à la télévision, Fanny Brice, Jean Harlow, May West, Claudette Colbert, Marilyn Monroe, Jane Mansfield, Betty White, Elaine May, Barbra Streisand, Goldie Hawn, Carol Burnett ou Tina Fey pour la plus récente. Et, last but not least, Lucille Ball qui, par sa virtuosité, sa diction, son charme et son sens du comique, est devenue un cas presque à part, à la fois star absolue et phénomène sociologique.
LUCILLE BALL (1911-1989), STAR COMIQUE ABSOLUE
Aux États-Unis, depuis les années 50 et jusqu’à nos jours, la comédienne rousse flamboyante Lucille Ball, peu connue de ce côté-ci de l’Atlantique, a été et reste, dans l’imaginaire collectif américain, une icône télévisée incontournable, une institution médiatique sacrée dans laquelle se reconnaissent près de quatre générations.
Une drôle de féministe, dans tous les sens du terme, puisque sans l’avoir jamais revendiqué mais avec un flair et un sens des affaires très sûrs, cette comedienne – en anglais dans le texte, avec le sens précis d’actrice comique –, est devenue, dès les années 50, la première femme productrice de télévision avec sa compagnie Desilu, dont le nom est composé des lettres de son prénom et de celui de son mari, le musicien cubain Desi Arnaz, avec qui elle formera un célébrissime couple télévisé pendant plus de dix ans.
Desilu a été à l’origine d’innombrables sitcoms, et a aussi mis au point des procédures techniques économiques et efficaces qu’on applique encore aujourd’hui : enregistrements en studio devant un vrai public, utilisation simultanée de plusieurs caméras filmant sous divers angles qu’on travaille ensuite au montage, série de décors alignés (la chambre à coucher, le salon, etc.) qui permettent de tout tourner d’une traite.
LUCILLE BALL OU LA PETITE HISTOIRE DU SITCOM AMÉRICAIN
Pour ma part, j’écoute et réécoute avec grand plaisir My Favorite Husband (Mon mari préféré, 1948-1949) la première sitcom, radiophonique celle-là, où est apparue Lucille Ball en compagnie du comédien Richard Dennings.
C’est très drôle, très bien écrit, et Lucille Ball y est, comme toujours, une comédienne enjouée, avec ce quelque chose d’absolument charmant, enfantin, second degré et faussement naïf dans la voix.
Dans les premiers épisodes, les personnages de George et Liz Cougat, étaient encore un couple de la bonne société. Plus tard, et pour tenir compte d’un public composé de la petite classe moyenne américaine d’après-guerre, qui était en train de s’enrichir, le sitcom radiophonique a été adapté et les Cougats sont devenu les Coopers, un couple sociologiquement plus adéquat, vu le succès de la série. De surcroit, ça permettait une plus grande fantaisie d’écriture autour des lubies récurrentes et irrésistibles de la « zany » (fantasque) Mme Cooper.
LA CRÉATIVITÉ AMÉRICAINE PASSE PAR LA PUB
Très intéressante aussi, la structure de ce sitcom dans la manière de créer un produit à la fois publicitaire et culturel de qualité : c’est sur la chaine radio CBS – pas une chaîne de radio locale mais un network couvrant tout le territoire américain –, et c’est grassement financé par la gelée multicolore Jello.
Chaque épisode dure environ trente minutes. Chaque début d’épisode, un jingle chanté vante en l’épelant le nom du produit et son slogan, et à chaque moitié d’épisode, on propose une recette facile avec la gelée. Au final, on touche parfaitement un vaste public-cible familial de la lower middle class, la petite classe moyenne américaine d’après-guerre, en train de s’enrichir et de consommer à crédit.
Lucille Ball salue les auditeurs d’un jeu de mot sonore et publicitaire, « Jello, everybody ! » juste après avoir été mentionnée en tant que star du show, puis Bob LeMond, le speaker, lance la série par le slogan « George and Liz Cooper, two people who live together – and like it. » (George et Liz Cooper, deux personnes qui vivent ensemble – et aiment ça)
Il y a quelquefois une petite didascalie : «We find George and Liz at the breakfast table, Liz is trying to catch George’s attention, but he is reading the paper » (On retrouve George et Liz à la table du petit-déjeuner, Liz essaie de capter l’attention de George, qui est en train de lire le journal), et après on commence l’épisode.
LE SITCOM RADIOPHONIQUE ? UN AVATAR DU BON VIEUX VAUDEVILLE
Chaque épisode traite d’un aspect de la vie de couple, c’est à dire le reflet sociologique idéalisé et amusant d’un couple de classe moyenne américaine de cette époque-là. Il est banquier, elle est femme au foyer.
Les répliques et les chutes – les punchlines – sont très drôles, les situations aussi, et certains personnages sont absolument hilarants
Il y a une bonne, Katy, qu’on suppose dans la soixantaine et un peu délurée : c’est la complice de Liz dans ses rapports avec son mari, la bonne reprenant le rôle traditionnel de la confidente du théâtre classique.
Le petit ami de la bonne Katy est un stéréotype du nerd, du dadais timide (c’est le postier dans la série).
Le patron de George Cooper, Monsieur Rudolph Atterbury – voix de stentor grave et hautaine qui convient bien à son prétentieux prénom – et sa femme, Iris – diction ampoulée censée être snob et chic – les saluent toujours d’un condescendant « Good Morning, George boy, Good Morning, Liz girl », qu’on pourrait traduire par un amusant et paternaliste « Bonjour, mon petit George, Bonjour, ma petite Liz ».
Au fil des épisodes apparaissent ponctuellement toute une série de personnages farfelus et archétypaux, souvent interprétés par un même acteur ou une même actrice :
– le brocanteur hollandais qui prononce tout avec son gros accent batave, et notamment les « s » qui deviennent de « ch », ce qui fait qu’il parle de son « chleï » pour son traineau (« sleigh »)
– une standardiste ou une vendeuse nunuche avec l’accent de Brooklyn
– des fonctionnaires ou des policiers méticuleux
– des personnalités pontifiantes (écrivains, professeurs, metteurs en scène)
– un psychanalyste freudien forcément allemand
NAISSANCE DU SITCOM TÉLÉVISÉ
La télévision prenant son essor dans les années 50, c’est toute une production radiophonique qui passe au format visuel et s’adapte au nouveau medium.
CBS, pour sa branche télévision, décide de reprendre les scénarios radiophoniques de My Favorite Husband et de les adapter pour le petit écran, dans ce qui allait devenir le célébrissime sitcom I Love Lucy (j’ai les deux premières saisons et je reconnais les trames).
À la radio, le mari était le comédien Richard Dennings. Lucille Ball, forte de son succès radiophonique, met le pied au mur pour l’adaptation télévisée, et exige de CBS que ce soit Desi Arnaz, son mari dans la vie, qui reprenne le rôle du mari, officiellement pour qu’ils puissent être plus souvent ensemble, officieusement parce que ce musicien et percussionniste cubain était toujours en tournée avec son orchestre, avec toutes les tentations que ça suppose...
Les producteurs de CBS ne sont pas chauds au sujet d’un mari cubain pour une série si américaine, mais cèdent devant la détermination de leur star et bien leur en prend : le show devient culte dès le début, et fait école dans sa manière de filmer rapidement les épisodes avec trois sets – le salon, la chambre à coucher et la cuisine – chacun avec leur caméra respective, une idée géniale de Desi Arnaz.
LES RERUNS,
Cette série, dont les droits ont été rachetés par Desilu, la société de production créée par Desi Arnaz et Lucille Ball, fait la fortune des deux, à cause de la syndication, c’est à dire de la vente des droits à un niveau national pour tout le territoire américain : le sitcom a été constamment projeté dans les grilles de programmes partout aux États-Unis, en prime time d’abord, puis, plus tard et durant de longues années, dans les programmes de « reruns », les rediffusions pendant les heures creuses.
C’est comme ça que j’ai découvert Lucille Ball : quand j’étudiais aux États-Unis, j’adorais ces reruns, que je voyais avec plaisir entre 15.00 et 18.00, quand je rentrais de l’école, et qui m’ont permis de connaître en différé tout un pan du patrimoine télévisé américain et de ses références culturelles et humoristiques.
Pendant cette tranche horaire étaient rediffusées des séries comiques comme Mr Ed (le cheval qui parle), The Mary Tyler Moore Show, The Dick Van Dyke Show, The Carol Burnett Show, Green Acres ou The Brady Bunch Hour, sans compter, Underdog le dessin animé drôlissime et décalé avec pour héros un chien – le titre est un jeu de mot, underdog veut littéralement dire « sous-chien » mais son sens courant signifie « qui n’a pas l’avantage ».
Ce délicieux pastiche de Superman commençait avec un Snoopy à cape en train de survoler la mégalopole. Une voix off de faux commentateur d’actualité scandait : There is no need to fear, Underdog is here.
CULTURE ET FINANCEMENT
Pour en revenir à Lucille Ball, avec I Love Lucy et ses trois autres avatars (The Lucy-Desi Show, The Lucy Show, Here’s Lucy) elle a occupé les écrans et les heures de cerveau américains pendant plus de cinquante ans et ça continue.
Cette série est intéressante aussi en ce qui concerne la manière de faire de la télévision aux États-Unis : à cette époque comme aujourd’hui, on crée une série ou une sitcom pour autant qu’on trouve des sponsors, c’est à dire des financeurs. En retour, ceux-ci ont forcément un impact sur le contenu et sur la forme.
Ceci explique, par exemple, que dans les années 60, une série aussi célèbre que Bewitched (Ma sorcière bien aimée en français) ait ce côté légèrement progressiste – en faveur des Noirs, de l’intégration, des orphelins, etc. –, le show ayant été largement financé par un groupement religieux, probablement l’église presbytérienne (Agnes Moorehead, qui joue la mère sorcière de Samantha, la snobinarde Endora, était d’une famille très praticante et son père était pasteur presbytérien, justement).
C’est aussi ça, le fonctionnement et la logique de la culture américaine, en musique, au théâtre, au cinéma ou dans les médias : la culture ne dépend pas d’une subvention de l’État mais d’un financement qui est d’abord un investissement à des fins de profits de la part de grandes entreprises ou de groupes d’intérêts privés que l’État favorise par de gros avantages fiscaux.
C’est le show business dans le sens fort du terme, un secteur économique comme un autre, avec des produits culturels qui doivent rapporter à leurs sponsors, à qui on doit rendre des comptes. Ce financement, variable, dépend du box-office et des taux d’audience. On renégocie régulièrement par agents et avocats interposés, on adapte, à la hausse ou à la baisse, salaires des comédiens vedettes compris.
L’ARTISTE ET L’ARGENT : UN PACTE FAUSTIEN
Ce n’est pas toujours au détriment de la qualité, malgré les apparences.
Après tout, que le financement culturel provienne de l’entreprise privée, de richissimes mécènes aristocrates et bourgeois – sans qui aucun des grands artistes, de la Renaissance jusqu’au début du 20e siècle, n’aurait rien créé – ou encore, dans de nombreux pays, de l’État et de l’argent des contribuables, selon des critères qui vont de la propagande à la politique de prestige en passant par le copinage, c’est toujours le même pacte faustien entre un créateur dépendant des exigences et des caprices d’un commanditaire.
Le résultat final dépend d’abord et avant tout de la ténacité, de l’intelligence et du talent de chaque artiste, un état de fait que Sarah Bernhardt résumait dans sa devise personnelle : Malgré tout.
©Sergio Belluz, 2019, le journal vagabond (2018)
A découvrir aussi
- L'Amiral Nelson (l'autre).
- Et moi je dis : qu’en dit le Jedi ?
- Le printemps, ma mère et ‘Janique Aimée’
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 113 autres membres