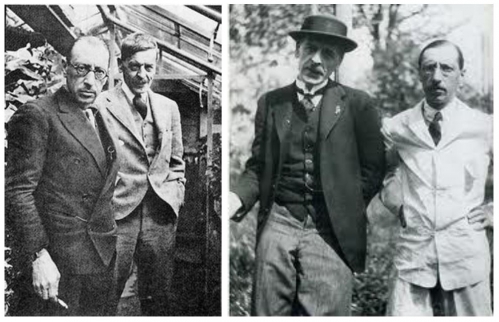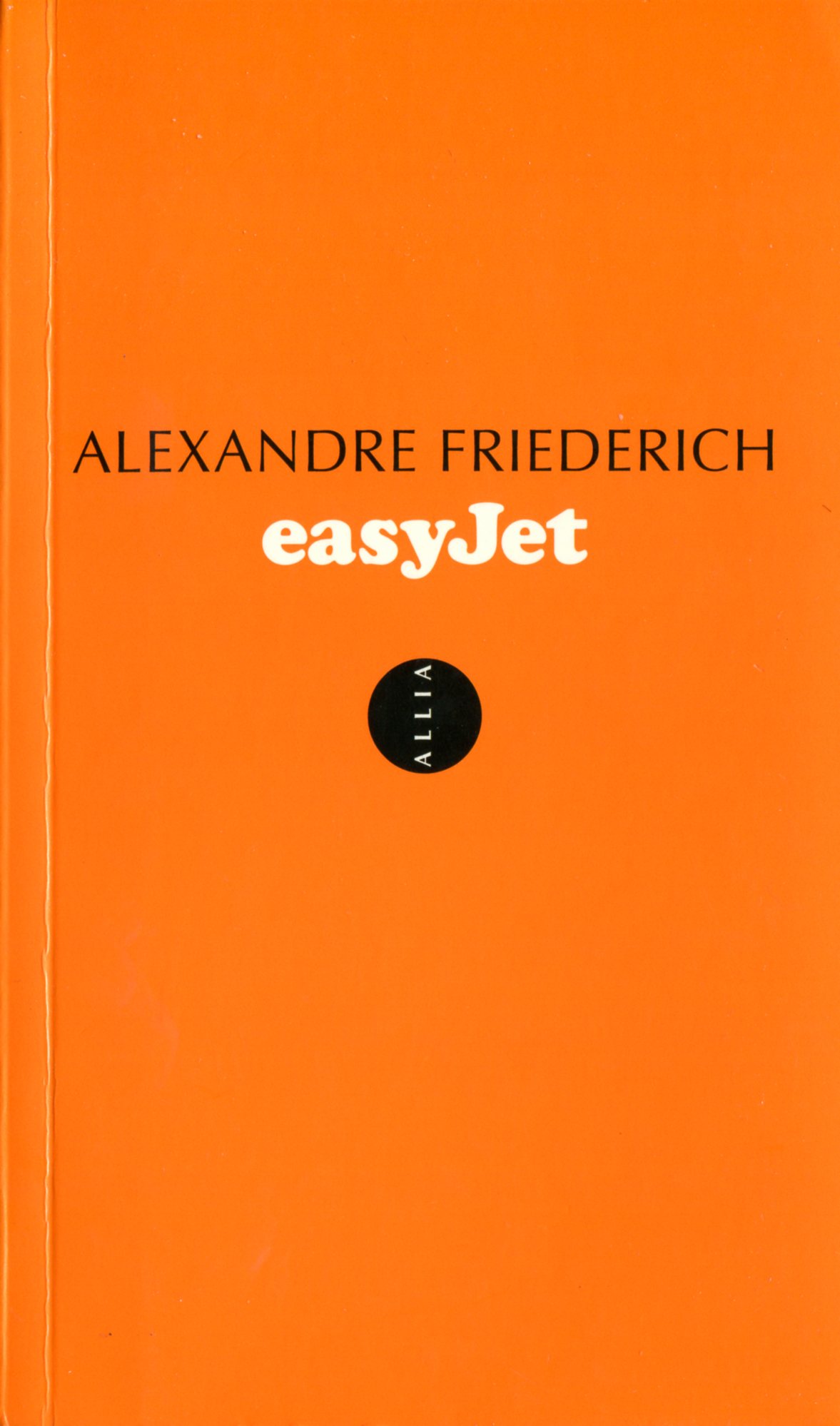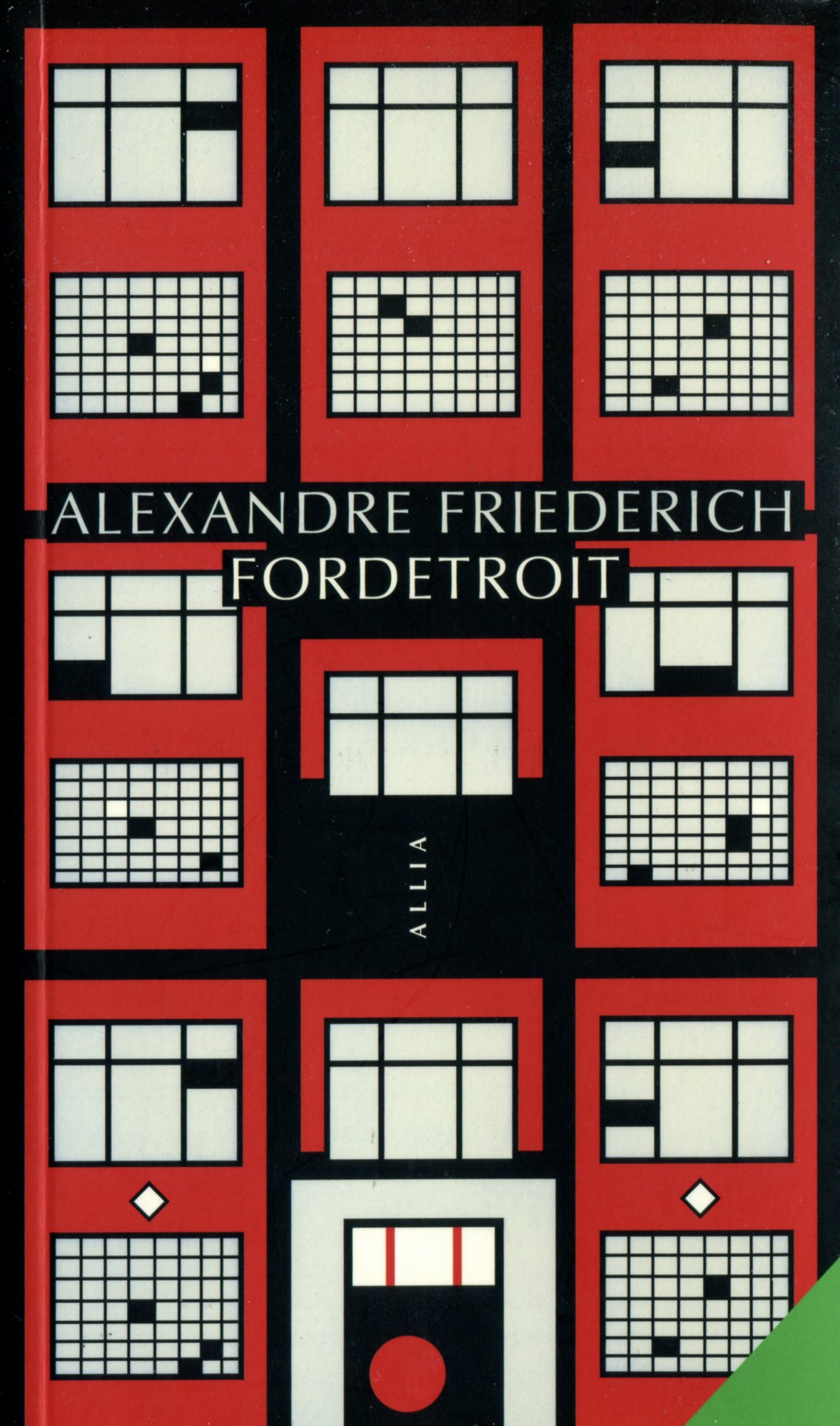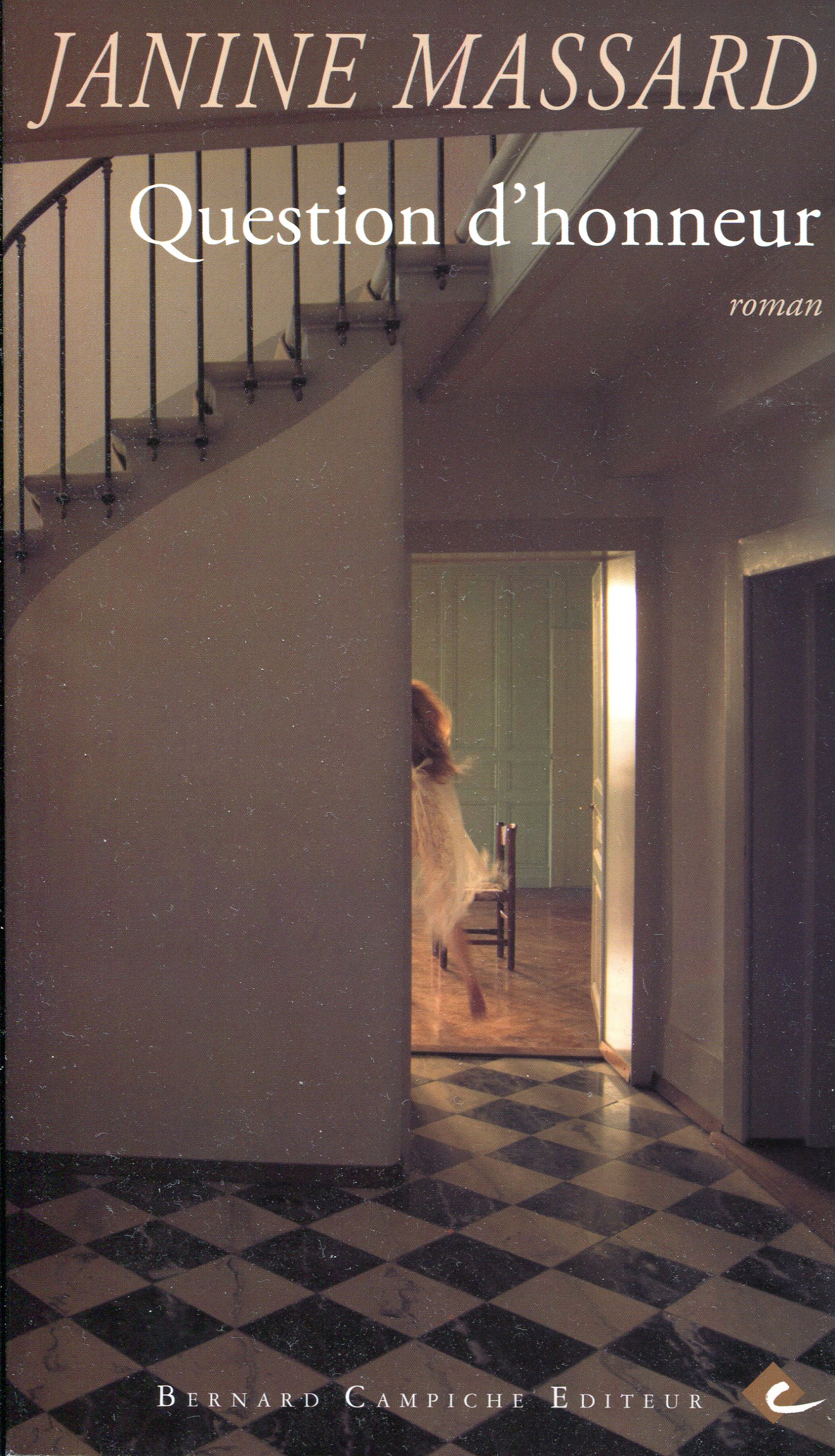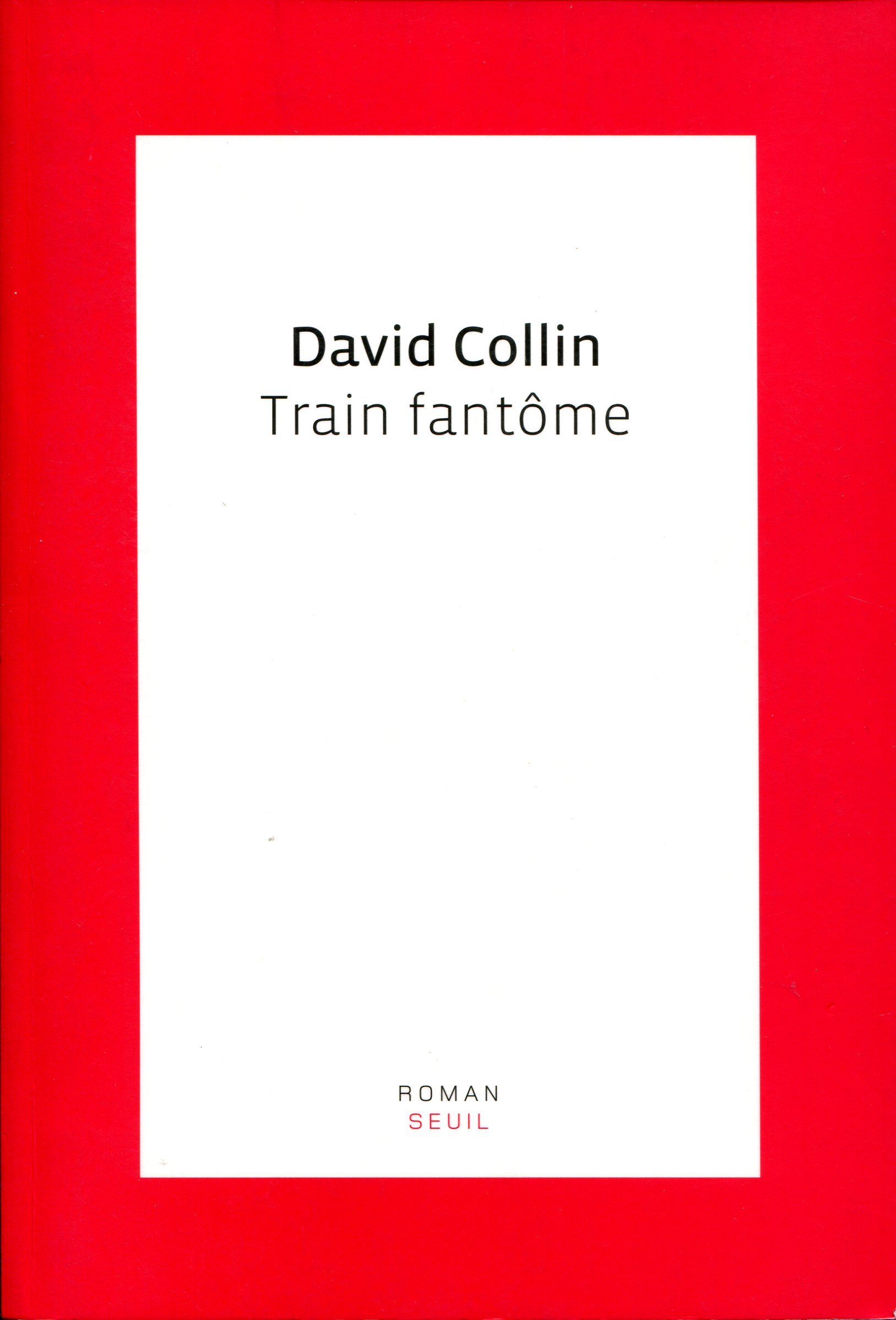LA SUISSE LITTÉRAIRE
Charles Ferdinand Ramuz parolier: 'Polkovnik - Le Colonel'
'POLKOVNIK - LE COLONEL' (1914)
Musique du compositeur russe Igor Stravinsky (1882-1971)
Tiré de Pribaoutki - Chansons plaisantes
Adaptation française de Charles Ferdinand Ramuz
Sergio Belluz (baryton) et Ioana Primus Andrei (piano)
Enregistrement public, Théâtre de l'Octogne, Pully, 1994
Illustrations: oeuvres de Chaïm Soutine
Le colonel part pour la chasse,
Tire sur une bécasse,
Manque sa bécasse,
Tire sur une perdrix,
La perdrix s'enfuit,
Tombe et casse son fusil;
Il appelle son chien,
Son chien n'répond rien;
Sa femme l'a reçu,
Sa femme l'a battu...
Chassera jamais plus.
Stravinsky et Ramuz
Charles Ferdinand Ramuz parolier: 'Tilim Bom'
'TILIM BOM' (1917)
Musique du compositeur russe Igor Stravinsky (1882-1971)
Tiré de Trois histoires pour enfants
Adaptation française de Charles Ferdinand Ramuz
Sergio Belluz (baryton) et Ioana Primus Andrei (piano)
Enregistrement public, Théâtre de l'Octogone, Pully, 1994
Illustrations: Marc Chagall, scènes de vie à Vitebsk
Tilim-Bom,
Tilim-Bom,
C'est la cloche du feu qui sonne.
Chez la chèvre il brûle,
On l'entend qui hurle.
La chèvre a couru dehors
Et la cloche sonne plus fort.
Qui la sonne?
C'est le chat,
Il s'y pend par les deux bras.
Tilim-Bom,
Tilim-Bom,
Faut venir quand on vous sonne.
Vient la poule avec un seau
Et l'a plongé dans l'eau;
Monsieur coq court derrière elle,
Avec une grande échelle;
Et, le bouc,
Il grogne:
"Tout ce bruit m'assomme
Tilim-Bom,
Tilim-Bom,
Moi je n'y suis pour personne."
Chez la chèvre il brûle,
On l'entend qui hurle.
Les gens courent tous dehors
Et la cloche sonne plus fort.
Qui la sonne?
Ce n'est plus le chat,
Les gens la sonnent à tour de bras.
Tilim-Bom,
Tilim-Bom!
"Venez vite,
on vous sonne!"
Monsieur coq avec la poule,
La chèvre et le chat
Se sont assis tous en rond
Et reprennent la chanson.
Tilim-Bom,
Tilim-Bom!
Qu'on éteigne la maison!
Ramuz et Stravinsky
Charles Ferdinand Ramuz parolier: 'L'Ours, petite histoire avec une chanson'
'L'OURS, PETITE HISTOIRE AVEC UNE CHANSON' (1917)
Musique du compositeur russe Igor Stravinsky (1882-1971)
Tiré de Trois histoires pour enfants
Adaptation française de Charles Ferdinand Ramuz
Robert Bouvier (comédien), Sergio Belluz (baryton) et Ioana Primus Andrei (piano)
Enregistrement public, Théâtre de l'Octogone, Pully, 1994
Illustrations: oeuvres de Natalia Nikolaïevna Gontcharova
(texte parlé)
Il y avait dans le temps
Un vieux et une vieille qui n'avaient pas d'enfants.
La vieille a dit au vieux: "Va me chercher du bois."
"On y va" dit le vieux, et le vieux dit qu'il y va.
Et en effet il y va, rencontre l'ours, l'ours: "Tiens, c'est toi!
On te connaît. Veux-tu lutter avec moi?"
Le vieux a pris une hache, lui a coupé la patte.
Voilà que le vieux s'en revient et il tient la patte à la main:
"C'est un bon dîner pour demain."
La vieille râcle, frotte, nettoie.
L'ours n'est pas content,
Il a été se laver dans le ruisseau,
Il s'est fait une patte en bouleau.
Puis il est venu devant chez le vieux,
Et il chante à la vieille, au vieux:
(texte chanté)
Grince,
Grince,
Grince patte en bouleau.
Dedans,
Dehors,
Gens et choses, tout dort.
Gens et choses,
Tout qui repose...
Seule, sans vergogne,
Dort pas, râcle, grogne,
Est à sa besogne,
La vieille charogne.
Grince,
Grince,
Grince patte en bouleau.
(texte parlé)
Sous le pétrin renversé
Le vieux s'est ensauvé;
Sous les chemises sales la vieille a été se cacher;
Dans la maison l'ours est entré.
Sous le pétrin renversé
Les dents du vieux se sont mises à claquer;
Sous les chemises sales
La vieille s'est mise à tousser.
L'ours les a trouvés,
L'ours les a mangés.
Ramuz et Stravinsky
Alexandre Friedrich ('easyJet' et 'Fordetroit'): quand le postcapitalisme se fait littérature
Très original, l’éditeur parisien Allia, des textes courts, des formats de poche aux couvertures design pour une collection éclectique où se côtoient l’Arétin, Sainte Thérèse d’Avila, Al-Fârâbi, Custine, Leopardi, De Quincey, Enzensperger, Lorca, Papaioannou ou Nietzsche. Tout est créatif, élégant et donne envie de lire.
À la librairie de la gare de Genève, j’ai trouvé deux livres, deux courts essais, d’Alexandre Friedrich (prix Dentan 2011 pour 'Ogrorog'), un des rares écrivains suisses qui, de manière méthodique, parle très précisément du monde dans lequel nous vivons, les deux livres publiés chez cet éditeur, les deux sur des réalités contemporaines que Friedrich teste et dont il étudie chaque aspect.
Dans easyJet (Paris : Allia, 2014), Alexandre Friedrich décortique le mythe et l’aspect marketing et se livre en passant à l’analyse complète – économique, sociologique, psychologique, historique – de toute une génération, qui, depuis 1995, date de la création de la compagnie et de ses nouvelles techniques de vente, prend l’avion comme le bus, sans se préoccuper des tenants et des aboutissants économiques ou environnementaux :
« Si easyJet possède aujourd’hui une flotte de 210 avions, elle n’était, au moment de sa création, qu’une compagnie virtuelle qui exploitait deux Boeing 737 en leasing et sous-traitait la totalité de ses opérations, des pilots aux préposés à l’enregistrement.
Le premier vol avec avion propriétaire a eu lieu en 1995. Il était à destination d’Amsterdam. à partir de 1998, easyJet procédera à des acquisitions-fusions qui expliquent le maillage actuel du territoire européen à partir de l’Angleterre et de la Suisse (55 destinations au départ de Genève). La négociation de ces plates-formes est un enjeu politique majeur pour la compagnie, car l’approche low cost consiste aussi à obtenir des avantages auprès des autorités aéroportuaires, à commencer par des tarifs préférentiels sur les services au sol (équipes de manutention, passerelles, salles d’attente), cela sans trop lâcher sur les fondamentaux : situations des pistes d’envol et d’atterrissage, créneaux de vols, taxes. Le passager a une valeur évidente dans cette guerre commerciale. Plus il y a de passagers statistiques, plus la compagnie a les moyens de faire pression sur l’aéroport. Et si ce n’est sur l’aéroport, sur la ville qui, à sont tour, fera pressions sur l’aéroport. Chaque touriste représente de fait un apport financier pour les municipalités. »
Dans Fordetroit (Paris : Allia, 2015), c’est la ville qui fut un temps la capitale automobile et le symbole absolu du capitalisme américain qu’Alexandre Friedrich visite en tant que phénomène sociologique :
« Puissante, fière, populeuse, toute en perspectives, portant sur le corps cette étrange patine que donne l’argent, elle était dans les années trente la ville nouvelle qui incarnait les promesses du capitalisme de masse. Chaque jour cinq mille immigrants foulaient les quais de sa gare centrale, monument implanté sur Michigan avenue. Derrière les marques universelles que sont General Motors, Chrysler et Ford, plus de cent fabricants construisaient des automobiles. Les ouvriers se bousculaient, l’investissement explosait : apparaissaient les premiers gratte-ciel, monstres rectilignes aux parures art-déco, et un modèle de logement empilé qui ferai recette : les appartements. Les vedettes fréquentaient théâtres et dancings, les trottoirs menaient aux boutiques et au premier grand magasin au monde, le J.I. Hudson’s Department Store, édifice de trente-trois étages bâti sur Woodrow avenue. Une ruée : en trois décennies la population a sextuplé. À la veille de la Deuxième Guerre, elle atteignait lemillion et demi. La ville était un phare. Ford, un prophète. La classe moyenne, à l’aise dans son toc, ses lumières, ses lois : l’ouvrier à la chaîne avait un salaire enviable, un habit sain, une éducation et une automobile. »
Pas de grandes phrases, pas de chichis, c’est précis, documenté, méthodique : un portrait chinois, une psychanalyse fouillée et une déconstruction passionnante de notre réalité, celle du citoyen-consommateur contemporain manipulé par le Big Brother du marketing.
©Sergio Belluz, 2018, le journal vagabond (2016).
Janine Massard, une grande auteure suisse de langue française en 13 titres : ‘Question d’honneur’
Avec son magnifique ‘Question d’honneur’ (Campiche, 2016), Janine Massard nous offre une nouvelle saga familiale suisse qui englobe trois générations où le passé enfoui par convention et par contrainte sociale a de terribles conséquences sur le présent d’un des quatre personnages, sur le modèle du biblique « Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. » (Jérémie, 31)
Structuré en quatre douloureuses introspections, le roman se développe comme un opéra, avec des récitatifs qui racontent le déroulement des faits, et de touchants et douloureux arias pleins de remords, de ces monologues intérieurs en discours indirect libre dont l’auteure est la grande spécialiste et qui nous permettent d’entrer dans la logique des protagonistes, Marianne, la mère, de bonne famille bourgeoise, mais d’une génération de femmes qui savaient qu’elles ne pouvaient décider de rien, Louis, le père, qui, par ses études et son mariage, a gravi l’échelle sociale et qui, par peur de déchoir, se trouve alors coincé dans les conventions de son nouveau milieu, Gisèle la fille aînée, qui étudie mais est le jouet de circonstances malheureuses et Floriane, la fille cadette, dont la vie sera détruite à jamais par cette fameuse Question d’honneur.
« Elle pleure, elle hait ce qui pousse en elle, cette chose que personne dans son entourage n’accueillera avec joie. Elle prend les gouttes que Papa lui fait boire, s’exerce à se jeter au bas de l’escalier, mais il est si peu monumental qu’elle retombe sur ses pieds, on ne peut pas rehausser la maison d’un étage pour qu’elle chute efficacement ! Malgré son poids, elle a bon équilibre, elle se sent devenir plus souple, c’est le seul avantage de cet exercice ridicule alors elle persévère, est-ce que c’est par-là que ça commence. Ça quoi ? En elle grandit un sentiment de révolte. Pourquoi est-ce inavouable d’avoir été forcée ? Elle préfère ce mot à violée parce que c’est de cela qu’il s’agit ; et pourquoi, au lieu de la voir en victime, la traite-t-on comme une coupable ? Qui lui rendra justice ? Elle embarrasse père et mère, elle est responsable de la dégradation du climat familial, et c’est vrai qu’il règne dans cette bicoque un silence pesant, tout cela à cause d’elle, elle, elle... »
©Sergio Belluz, 2016.
Janine Massard, une grande auteure suisse de langue française en 13 titres
Question d'honneur (Orbe : Campiche, 2016)
La vie ou le 'Train fantôme' de David Collin
Très émouvant, très touchant, très subtil dans son écriture, le Train fantôme, de David Collin (Paris: Seuil, 2007)
Une proverbe africain mis en exergue dans la quatrième partie, en résume bien la raison sous-jacente : “Quand on ne sait pas qui l’on est on ne sait pas où l’on va.”
On comprend que cet homme devenu père à son tour, a cherché son propre père, disparu très tôt de sa vie, et que cette recherche et ces retrouvailles insespérées et délicates se passent à un tournant de sa vie et qu'il s'agit surtout d'une recherche d'identité et de racine, une manière de s’inscrire officiellement dans les enchainements dont on est le résultat: “J’étais un homme que rien ne précédait, qui ignorait tout de l’histoire de son père, qui désespérait de connaître de quelle tribu il venait, à quelle lignée il appartenait.”
C'est délicatement écrit, fin, pudique, on y relève aussi les ambiguïtés, la recherche et en même temps l'inquiétude liées à cette recherche, une certaine peur d’être rejeté, peut-être, qui fait qu’on ne cherche pas aussi bien qu’on dit le faire, et c’est sans doute une peur métaphysique :
“Le manque de preuve autour de ma naissance, le mystère d’une origine vaguement orientale, en somme le flou de mes racines, me donnaient l’illusion d’être immortel: pas né, pas mort.”
J'ai trouvé aussi magnifique que cette quête s’inscrive dans des déplacements, des trajets, des voyages, qui sont à la fois des métaphores de la vie et des fuites de ce qu'on est et une concentration sur ce qu'on est:
“Sans père, sans patrie, sans toit (“tu n’es pas chez toi”), sans lien, je me suis longtemps senti exilé en paternité ou en manque de paternité; manquait un regard. (...) Conséquence de ce détachement, de cette non-adhérence à un lieu, à une patrie, je ne suis bien qu’en parcourant le monde.”
Ces retrouvailles miraculeuses se déroulent comme une idylle, on se trouve, on se retrouve, on s’appelle, il y a le premier rendez-vous où on arrive le cœur battant... Tout se passe bien, ce qui n’empêche pas une grande lucidité:
“Pourtant je ne sais rien de sa vie, ni lui de la mienne, Nous ne savons rien de ce que Nous n’avons pas vécu ensemble (…) Guettant une infinité de petits souvenirs, souvenirs anodins, Nous ne sommes pas fâchés d’en réinventer quelques-uns, de fabriquer ceux que nous n’avons pas vécus.”
Un très beau roman.
©Sergio Belluz, 2017, le journal vagabond (2017).
Quand Charles Ferdinand Ramuz raconte l’inondation de Paris de 1910
Je relisais le magnifique ‘Journal’ de Ramuz : quelle merveille ! Souvent poignant (jusqu’au bout il aura des doutes sur son travail), mais aussi plein d’observations très justes sur l’écriture et sur sa vie, en une sorte de continuelle recherche. Et puis une écriture qui me touche beaucoup plus que celle de ses romans : il ne cherche qu’à transcrire ses impressions de la manière la plus précise, sans chercher à atteindre un effet quelconque.
Certains textes de ce ‘Journal’ sont des petites merveilles, par exemple la partie intitulée ‘Journal de ces temps difficiles’ sur le début de la guerre de 14-18, mais aussi ce reportage extraordinaire sur la grande inondation de Paris en 1910 :
« 27 janvier 1910. Inondations.
On ne voit pas d’abord que le niveau de l’eau ait monté, tellement on a vite oublié l’ordinaire étroitesse du fleuve et la profondeur de ses quais ; puis, tout à coup, il y a la péniche qu’on aperçoit de loin à la hauteur du mur où sont les boîtes du bouquiniste ; il y a ces bains dont le palmier de tôle découpée dépasse de beaucoup le parapet du pont ; il y a les troncs des gros trembles enfoncés jusqu’aux basses branches dans le courant ; et ces arches des ponts dont on ne voit plus que le haut du cintre, enfin la couleur de cette eau, sa violence et ses remous, plus que sa largeur encore ; et tout à coup la conscience vient, accablante, de la toute-puissance du fléau. L’homme soudain rapetissé ; l’homme pas même gênant tellement il en devient insignifiant ; et qui borde les quais d’une double haie mouvante comme un cortège du mardi gras ; le centre de l’intérêt est transporté, hors de la vie journalière et trompeuse de la ville, vers les grandes forces éternelles cachées qui se découvrent brusquement ainsi, et ont paru un instant écartées, mais se révèlent toujours présentes. Des troncs, des tonneaux, des bouchons, toute sorte de branchages et d’herbages qui se heurtent ou s’enroulent aux piles des ponts ; le roulement de ce flot sur lui-même ; et tout cela contenu encore, mais on dirait parce qu’il le veut bien ; et s’il lui plaisait de s’élever...
Voilà qu’il s’est élevé aujourd’hui. Les égouts ont crevé. Quai des Grands-Augustins, les bateaux : une partie de plaisir. Rue de Seine, rue Jacob. Plus loin, rue de Verneuil. La foule qui s’agite en tous sens maladroitement. Les petits soldats, le fusil sur l’épaule. Boulevard Saint-Germain, la prolonge d’artillerie. La dame qui s’évanouit, qui tombe sur le nez et a tout à coup une barbe rouge. Le bel officier sur la prolonge qui discourt avec des gestes arrondis du bras devant le groupe des personnes qui attendent. Un peuple avant tout discoureur. Il explique ce qu’il va faire, avant d’agir. D’ailleurs beaucoup de bonne humeur ; et cela rachète tout ; c’est un signe de vitalité.
28 janvier 1910
Il y aura de la déception chez tout ce monde, lorsque la Seine baissera, parce que c’était un spectacle.
J’ai été de nouveau voir l’inondation. Elle gagne. La rue Bonaparte, à son tour, est envahie. On ne circule plus qu’en barque boulevard Saint-Germain. Et au soleil et au froid sec d’hier succèdent aujourd’hui la pluie et un ciel bas. Alors, d’un même mouvement et parallèlement, à la bonne humeur d’hier succèdent chez les hommes la tristesse, et déjà presque de la peur. Cette pluie de nouveau, une nouvelle crue probable ; on ne voit pas où le mal va s’arrêter. Cette peur on la sent qui monte, elle est sur les visages et dans les gestes ; que la Seine croisse encore, ce sera l’affolement. L’esprit des foules : quelque chose de mystérieux. Cela gagne dans Paris loin des quartiers qui sont sous l’eau, et jusqu’aux plus extérieurs dont hier encore l’aspect n’était en rien changé ; les soldats dans les rues, les voitures du train, l’enchérissement du beurre et des oeufs, mille petits indices qu’on ne perçoit pas séparément, mais dont l’ensemble compose une atmosphère particulière, qui se respire comme l’air et à laquelle nul n’échappe. Je voulais travailler ce soir, je n’ai presque rien fait. »
Charles Ferdinand Ramuz, Journal (Paris : Grasset, 1945)