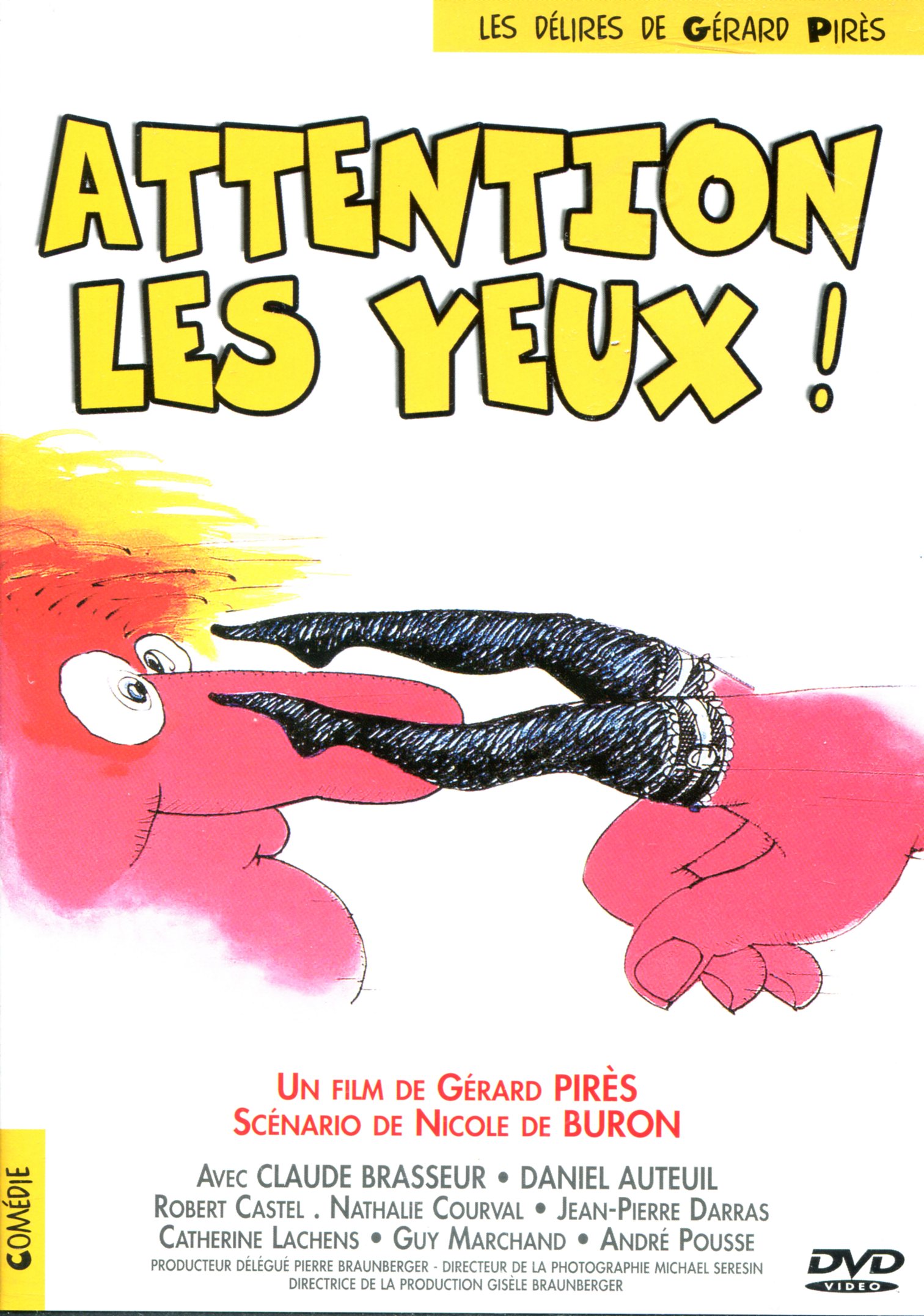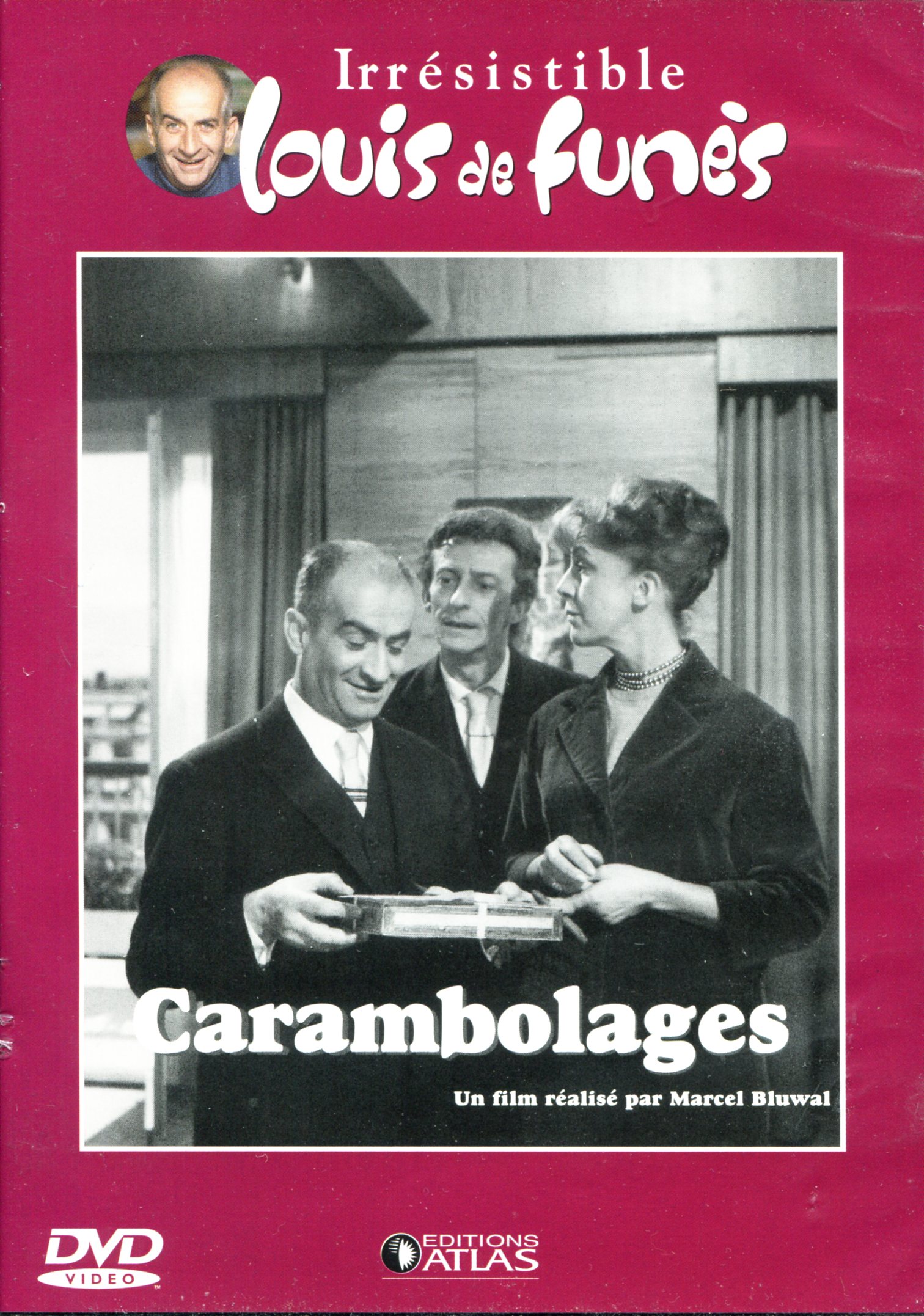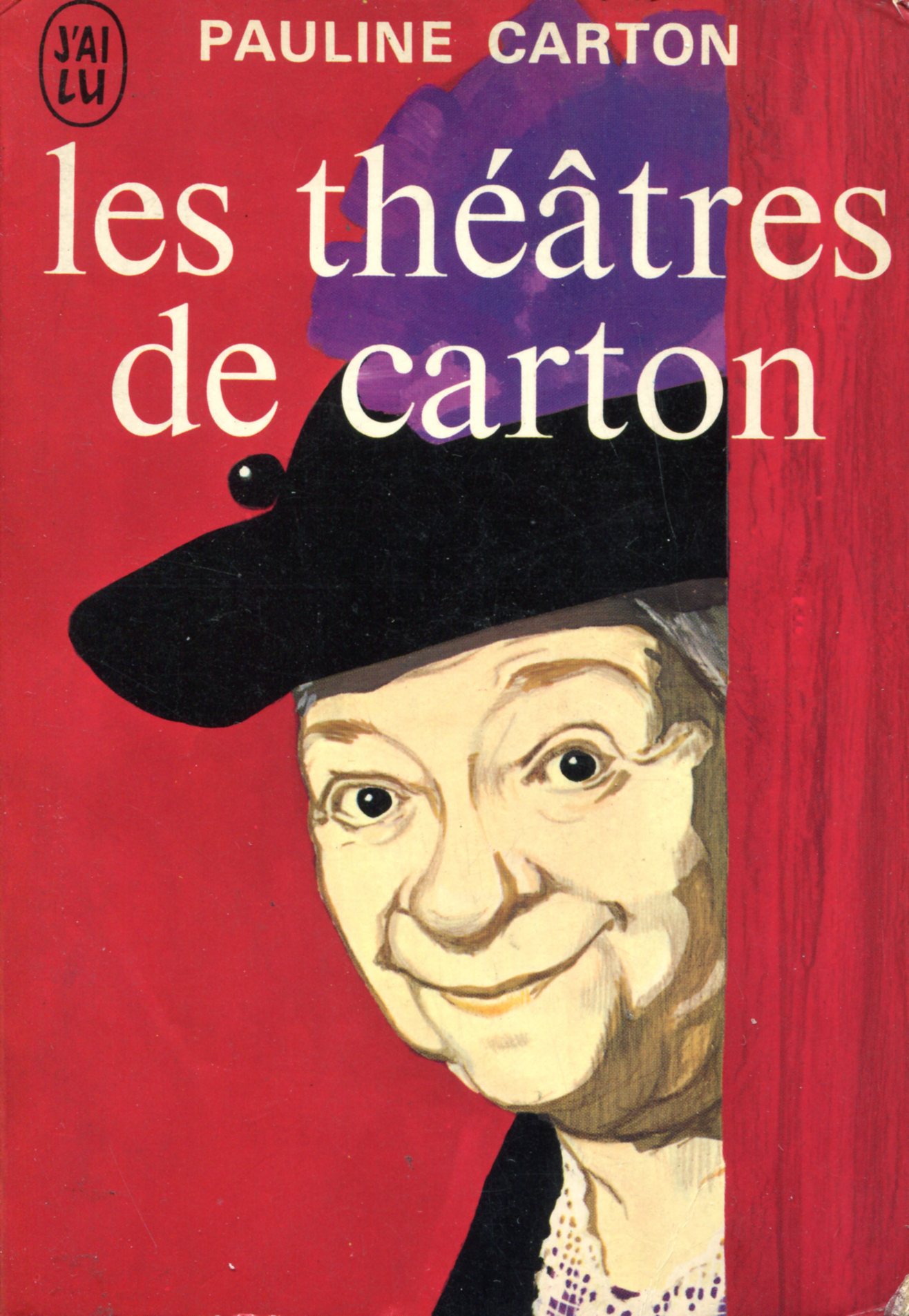AU CINOCHE
De quelques (très bons) nanars français
Je viens de revoir quelques films de Gérard Pirès, réalisateur un peu oublié aujourd’hui et c’est injuste, car ce n’est pas mal du tout, même si chez lui se sent un peu trop l’influence « publicitaire » dans sa manière de filmer, ce qui rend certains passages très factices, dans le montage en particulier.
Erotissimo (1968), avec Jean Yanne et Annie Girardot, fonctionne encore très bien, tout comme Attention les yeux ! (1976) avec Claude Brasseur et Daniel Auteuil. Mais pas Fantasia chez les ploucs avec le même Jean Yanne qui, cette fois-ci, partage l’affiche avec Lino Ventura et Mireille Darc : avec le recul, c’est vraiment très sexiste et très macho dans le sens gras du terme, et l’humour du film - inspiré de The Diamond Bikini (1956) de l'Américain Charles Williams – ne fonctionne plus du tout.
Dans la foulée, j’ai visionné trois films avec l’acteur Paul Meurisse, que j’aime beaucoup, et j’ai été surpris en bien.
Le Monocle noir (1961) et Le Monocle rit jaune (1964), par exemple, sous la direction du brillant et facétieux Georges Lautner qui est aussi aux dialogues (il s’est fait connaître grâce à ce film).
Le deuxième volet (dont le titre passerait mal aujourd’hui...) se passe à Hong Kong et Macao : à part un Paul Meurisse égal à lui-même dans le côté flegmatique, il y a le rythme, le montage serré, les gags, les répliques cocasses et les bruitages incongrus qui font tout le charme et l’humour des films de Lautner, sans compter, pour rallonger un film trop court et à petit budget en utilisant des plans filmés pour les repérages – Lautner est le roi du bout de ficelle astucieux – d’étonnants passages intercalés dans l’intrigue qui, aujourd’hui, sont devenus de fascinants documentaires sur la Chine de ces années-là.
Une autre comédie-polar, L’Assassin connaît la musique (1963), du réalisateur Pierre Chenal, est un petit bijou d’humour noir – les dialogues sont de Fred Kassak, l’auteur du roman à l’origine du film – dont le personnage principal, interprété par Paul Meurisse, est un compositeur de musique classique en décalage avec le monde urbain et bruyant qui l’entoure. Afin de pouvoir terminer dans toute la quiétude requise une composition en cours, il cherche à se caser en campagne, notamment chez une jeune veuve (interprétée par Maria Schell). C’est délicieux de fantaisie.
Une comédie française dans le bon sens du terme, immorale, sarcastique et bon enfant, tout comme ce génial Carambolages (1963) de Marcel Bluwal, un vrai chef-d’œuvre de film comique – Pierre Tchernia est au scénario et les dialogues sont de Michel Audiard – avec un Louis de Funès déchaîné en Président-Directeur-Général d’agence publicitaire et un Jean-Claude Brialy extraordinaire de cynisme nonchalant en jeune ambitieux obséquieux (et meurtrier) aux dents longues.
Un film introuvable, comme souvent les comédies, toujours déconsidérées à priori par une intelligentsia de la pellicule (la Nouvelle Vague et ses critiques-cinéastes féroces, dont Truffaut et Godard, sont passés par là) qui oublie que le cinéma s’est fait les dents avec l’humour – Méliès, Max Sennett, Charlie Chaplin, Buster Keaton, Laurel and Hardy... – et qu’une grande partie de ses chefs-d’œuvre absolus sont des comédies mondialement connues, celles d’Ernst Lubitsch, de Billy Wilder ou de Woody Allen, celles de Federico Fellini, de Vittorio De Sica ou d’Alberto Lattuada, comme celles de Sacha Guitry, de Georges Lautner ou de Philippe de Broca.
Ils ne savent pas ce qu’ils perdent.
©Sergio Belluz, 2022, le journal vagabond (2019)
Rifkin’s Festival et festival Woody Allen en prime
J’ai eu le plaisir de voir, hier soir, masqué et dans une salle clairsemée pour cause de mesures sanitaires, le drôlissime Rifkin’s Festival (2020), le tout dernier opus de Woody Allen qui, à ses 85 ans, en est à son 55e film et prouve qu’il a gardé sa verve et son ingéniosité proverbiales.
Car quoi de plus drôle et de plus cohérent à la fois que l’histoire du personnage principal – joué par Wallace Shawn, un double parfait, verbalement, de Woody Allen, avec un léger zozotement qui accentue son côté gauche et perdu dans la vie – ce Rifkin, intellectuel juif newyorkais, vieux critique de cinéma, admirateur du cinéma européen, qui accompagne son épouse beaucoup plus jeune (Gina Gershon), chargée de relations publiques au festival international du cinéma de San Sebastián, au pays basque espagnol, où elle s’occupe personnellement, et dans tous les sens du terme, d’un jeune cinéaste français à la mode (Louis Garrel) avec qui elle a une histoire d’amour, ou une coucherie, selon le point de vue ?
Le récit, sur fond musical enjoué style vieux jazz manouche à la Django Reinhardt (on est en Espagne, après tout), est raconté et vu par les yeux du critique newyorkais, qui, au début et à la fin, raconte à un journaliste « son » festival – d’où le titre très astucieux de Rifkin’s Festival, car c’est à la fois le festival de cinéma, mais aussi le propre cinéma du protagoniste dans ses aventures comme dans ses fantasmes – qu’ensuite nous voyons se dérouler, avec les péripéties amoureuses des deux parties du couple, qui sont illustrées par les rêveries du narrateur sous forme d’hilarants pastiches de cinéma qui illustrent ce que ressent Rifkin à chaque étape et dont il joue à chaque fois un des personnages principaux.
DU PASTICHE EN VEUX-TU EN VOILÀ
C’est d’une logique absolue, car en somme, est-ce qu’un critique de cinéma ne va pas imaginer sa vie à travers les films qu’il a aimés ?
Dans les pastiches – toujours en noir et blanc pour des classiques qui l’étaient à l’origine, alors que le reste du film est en couleur - on passe d’une scène d’anthologie à une autre au gré des péripéties.
On a droit au tout début de Citizen Kane de Welles, dont le personnage, sur son lit de mort, laisse tomber une boule de verre en murmurant « Rose Budsky » (une petite copine de Rifkin quand il était gosse), à Jules et Jim de Truffaut (avec le jeune réalisateur français amant de la femme de Rifkin, et lui-même, en pull a raies et pas chaud pour un trio, on s’en doute), en passant par la scène de lit d’À bout de souffle de Godard (Rifkin dans le rôle de Belmondo), aux bourgeois bloqués à la sortie de la salle à manger dans L’Ange exterminateur de Buñuel, à la garden party de 8 1/2 de Fellini, aux grandes conversations de table de Sourires d’une nuit d’été ainsi qu'à la célébrissime partie d’échec avec la Mort du Septième Sceau, ces deux derniers du grand Bergman...
Ce film rejoint les chefs-d’œuvre de la veine pasticheuses – de films, de télévision, de radio... – de Woody Allen, avec, entre autres, Comédie érotique d’une nuit d’été (1982), Zelig (1983), La Rose Pourpre du Caire (1985), Radio Days (1987), Crimes et délits (1989), Coups de feu sur Broadway (1994), Tout le monde dit I Love You (1997), Celebrity (1998), Accords et Désaccords (1999), Hollywood Ending (2002), Melinda et Melinda (2004), Whatever Works (2009) ou encore Minuit à Paris (2011).
C’est drôle, c’est décalé, c’est sophistiqué, c’est ingénieux, on fait des ballades automnales dans la superbe ville de San Sebastián et l’on s’amuse du début à la fin avec ce subtil et drolatique hommage aux grands classiques du cinéma européen.
©Sergio Belluz, 2020, le journal vagabond (2020).
Rifkin's Festival: la bande annonce en v.o.
Totò et Peppino contre le Nord (Bienvenu chez les Ch'tis peut aller se rhabiller)
C’est Mastrocinque – un metteur en scène italien bien trop sous-estimé – qui, dans Totò, Peppino e la malafemmina, dirige les deux vedettes comiques, Totò et Peppino De Filippo dans ce chef-d’oeuvre de 1956 qui, bien qu’en noir et blanc, et d’une époque passée, arrive encore à faire rire aux éclats un public de tous âge soixante-deux ans plus tard.
L’argument : deux frères, les frères Caponi, des paysans de la région de Naples, l’un avare et simplet (Peppino), l’autre rusé et bon vivant (Totò) ont un neveu qui étudie la médecine à Naples et qui tombe amoureux d’une actrice - la malafemmina du titre, c’est à dire la séductrice, la femme de mauvaise vie, la plantureuse fausse blonde platine italienne jouée par une actrice célèbre à l’époque (au pseudo révélateur, Dorian Gray), pour laquelle il emprunte de l’argent et part pour Milan.
La mère du jeune homme, une veuve, qui l’apprend par une lettre anonyme, rameute ses deux frères (Totò et Peppino) et toute l’équipe part pour Milan sauver le jeune homme des griffes de l’actrice.
C’est extraordinaire de vitalité, de dialogues déjantés, d’humour décalé, et il y a des scènes d’anthologie, la scène de la lettre qu’un des frères dicte à l’autre, par exemple...
... ou la scène de l’arrivée des deux frères napolitains à Milan – avec Bienvenue chez les Ch’tis, Dany Boon n’a rien inventé – et la scène de la conversation en allemand de cuisine avec l’agent de police milanais, qui, pour ces deux méridionaux, est forcément germanique puisqu’il est Milanais...
Des films aussi brillants que celui-là prouvent qu’il y a un préjugé intellectuel terrible contre le cinéma populaire, qui ressemble beaucoup à ce préjugé tenace contre la comédie en général, qui ne serait pas aussi noble et transcendantale que la tragédie.
Mais combien de nos prétendus grands films arriveront à faire rire aux éclats et à émouvoir toute une foule soixante-deux ans plus tard avec cette efficacité redoutable, avec ce rythme parfait, avec cette mécanique bien rodée et pourtant jamais artificielle ?
Et quelle fantaisie ! Et quelle verve !
©Sergio Belluz, 2019, le journal vagabond (2018)
Le cinéma et la pipe (non, pas celle de Maigret)
J’ai beaucoup aimé Call Me By Your Name, cette histoire d’amour si touchante entre un jeune homme de dix-huit ans environ, attiré sexuellement et amoureusement par un Américain plus âgé qui vient passer l’été dans la belle propriété de famille, un étudiant de son père, archéologue.
Le fait que j’aie vu le film un jour de grisaille, en plein hiver, a été un facteur supplémentaire dans mon appréciation : quel plaisir que de se retrouver en Italie, dans une magnifique maison pleine de soleil et de musique, en plein été, un bel été chaud, qui prête à l’amour et où tous les sens sont en éveil !
Le scénario est de James Ivory, et ça se sent : le film m’a rappelé le magnifique Maurice qui, lui aussi, tournait autour de la passion et de la sexualité exacerbées par les différences et les interdits.
Mais, si je m’en souviens bien, dans Maurice pas de pipe, on évoquait ça assez rarement au cinéma, le siècle passé.
Il y avait du sexe, graphique ou pas, sensuel ou pas, mais les fellations étaient relativement rares, à part dans le porno.
Je trouve curieux cette obsession, aujourd’hui, liée à la fellation.
Est-ce que c’est parce que la cigarette, qui a fait les beaux jours du septième art au XXe siècle – au cinéma, que seraient Bogart ou Deneuve sans leurs éternelles cibiches – est aujourd’hui mal vue, ce qui expliquerait le succès actuel de la pipe ?
Quoi qu’il en soit, dans les films, aujourd’hui, la pipe c’est comme un passage obligé, peut-être parce que c’est facile à suggérer sans rien montrer réellement : on filme l’acteur ou l’actrice en train de s’agenouiller devant une braguette, puis on coupe pour filmer en gros plan le visage de l’acteur censé en bénéficier, et le tour est joué.
En l’occurrence, dans Call Me By Your Name, Elio, le jeune homme – excité parce qu’Oliver (le plus âgé) a commencé à lui faire une gâterie, puis s’est interrompu en lui disant qu’il aurait la suite plus tard –, va se masturber au grenier et, mangeant une pêche bien mûre, en ôte le noyau et se fait tout seul une fellation maison à coup de pêche.
Ça ne me serait jamais venu à l’idée.
Comme quoi, les fruits sont toujours conseillés.
Surtout les fruits du pêcher.
©Sergio Belluz, 2019, le journal vagabond (2018)
‘Miseria e Nobiltà’ : le cinéma italien dans toute sa noblesse populaire
Mario Mattoli, le metteur en scène, a eu l’ingénieuse idée, pour Miseria e Nobiltà (‘Misère et Noblesse’, 1954), d’encadrer – littéralement – le texte de la pièce du grand dramaturge napolitain Scarpetta au début et à la fin : le film commence avec une soirée au théâtre, à Naples, le rideau s’ouvre et le film commence, et se termine avec les protagonistes qui saluent le public du théâtre.
C’est tout simple, c’est de très bon goût, et c’est même subtil.
Ensuite, le texte de Scarpetta est une merveille et c’est incompréhensible pour moi que d’aussi magnifiques dramaturges – je pense aussi, bien sûr, au grand Eduardo De Filipppo – soient si rarement joués chez nous.
Est-ce que c’est une question de traduction ? De droits d’auteur ? Est-ce que ça tient à des préjugés tenaces qui feraient qu’une comédie italienne est forcément superficielle ?
En l’occurrence, la pièce et le film traitent de la valeur de chacun, qu’on soit riche ou pauvre, noble ou roturier : des pauvres se font passer pour des aristocrates afin d'aider des nobles dont certains sont très désargentés, et le plus riche, dans tout ça, est un cuisinier qui a hérité une fortune de son ancien patron.
D’où le titre Miseria e Nobiltà, ‘Misère et Noblesse’.
Évidemment, on rit aux éclats à cette famille pauvre qui doit se débrouiller pour manger – Totò est écrivain public, et dépend d’illettrés pour acheter une pizza, son compagnon d’infortune est photographe à la petite semaine.
Quand on demande à ces gens de se faire passer pour des nobles afin de rendre service à un couple dont le jeune homme est aristocrate mais dont le père refuse qu’il se marie à une danseuse (une toute jeune Sophia Loren), c’est évidemment le regard des gens modestes sur la noblesse, lesdits gens pauvres se prenant au jeu, d’autant qu’ainsi ils accèdent à de la nourriture inespérée et raffinée.
Une verve extraordinaire, un rythme soutenu, des scènes d’anthologie, et cette drôlerie fantasque et triste à la fois de la comédie napolitaine...
Quel dommage, vraiment, que nos élites théâtrales ne soient pas capables de rire – et de rire d’eux-mêmes en premier.
©Sergio Belluz, 2019, le journal vagabond (2018).
Quelle crise du cinéma ?
La cinquante-et-unième édition du Festival international du film fantastique de Sitges bat son plein, dans tous les sens du terme, et attire son lot de monstres sacrés (cette année Nicholas Cage, Tilda Swinton et Pam Grier) et de ‘frikis’ – version espagnole du ‘freak’ américain, le freak, c’est chic – déguisés en créatures de toutes sortes, sans compter la traditionnelle ‘Zombie Walk’.
On vient de loin pour ce défilé et pour danser sur le ‘Thriller’ de Michael Jackson avec pustules, cicatrices sanglantes, crâne aux cheveux arrachés, yeux désorbités ou étoilés ou tigrés (un ami opticien m’a convié, ravi, que ce jour-là la vente de lentilles de contact fantaisie « marchait très fort »).
Il est très bien ce festival, et rappelle à tous les cinéphiles que parler de crise du cinéma est tout relatif : la catégorie ‘slasher’, film à budget modéré comprenant zombie, possession démoniaque, fantôme, vampire, loup-garou, extraterrestre, massacre à la tronçonneuse ou psychopathe – c’est cumulable, il y a des fantômes psychopathes ou des zombies extraterrestres – est extrêmement rentable.
Et ce cinéma-là ne connait pas de frontières et est apprécié partout. D’autres cinématographies y sont passées maîtres, la chinoise, la japonaise, la coréenne, et dans ce cinéma « de genre » – comme on parlerait de roman d’amour, de roman terroir ou de roman policier – se côtoient aussi bien des superproductions aux budgets stratosphériques que le film artisanal mais malin (et quelquefois diabolique).
C’est ce que je me disais en faisant la queue l’autre soir devant le vieux cinéma ‘El Retiro’ de Sitges – sièges de velours bleu cobalt, balcons, fresques, ça existe encore ! – pour assister pendant quatre heures non-stop à ‘Along With The Gods : The Two Worlds’ et sa suite ‘The Last 49 Days’, deux superproductions coréennes avec gros effets spéciaux, images léchées, aventure et humour.
Le premier volet date de 2017, le second de 2018, c’est du metteur en scène Kim Yong-hwa, et les deux ont été de très grands succès (mérités) en Corée comme partout ailleurs en Asie.
Dans une esthétique et un rythme trépidant qui va de ‘Matrix’ (pour le côté rock et les longs manteaux de cuir noirs) au Spielberg des ‘Aventuriers de l’Arche perdue’ pour les péripéties incessantes, c’est l’histoire très mélo aussi d’un pauvre pompier qui meurt en voulant sauver une mère et son enfant.
Il est appelé au Tribunal Bouddhiste où il doit répondre de ses actes devant les dieux et déesses juges de différents péchés (l’avidité, la paresse, la violence...). Condamné à d’horribles tourments éternels – la peine correspond au péché, c’est l’équivalent coréen du ‘contrapasso dantesco’ – par deux procureurs sans pitié mais incompétents, il a la chance d’être défendu par trois avocats commis d’office, deux hommes et une femme, qui en sont à leur énième réincarnation et qui, de leur côté, n’ont pas tout réglé dans leurs vies passées (au pluriel)...
On passe de la Corée hypermoderne à la Corée mythologique et on s’amuse beaucoup avec pleins de petits clins d’oeils anachroniques, sans compter les commentaires cyniques et désabusés des juges et des avocats de l’au-delà, ce même humour qu’on trouve, par exemple, dans le texte parlé de La Flûte Enchantée (les geôliers de Papageno se plaignent qu’on leur envoie n’importe quoi), et qui fonctionne sur le même schéma : des étapes à franchir pour prouver que l’âme d’un possible pécheur en série vaut la peine d’être épargnée.
On pense aussi, à cause des fonctionnaires célestes mais tatillons – rond-de-cuir on nait, rond-de-cuir on renait – à l’’Orphée’ et au ‘Testament d’Orphée’ de Cocteau et on se dit que les cultures en apparence éloignées fonctionnent de la même manière, les vertus et les vices se ressemblant comme deux gouttes d’eau.
Après quatre heures d’évasion dans des paysages spectaculaires – plaines infinies où surgissent des dinosaures, chutes d’eaux vertigineuses, mers peuplées d’énormes et sanguinaires piranhas, déserts rouges, glaciers infranchissables, cratères où flottent d’énormes rochers... – qui alternent avec des scène de pur et bon gros mélodrame, on se dit qu’un certain cinéma n’a rien perdu de ce qui faisait l’attrait de sa jeunesse et de son âge d’or, où la nécessité commerciale n’était pas en contradiction avec le savoir-faire, la qualité de l’histoire et celle de l’image.
Le cinéma est peut-être en crise, mais le bon vieux cinoche, même quand il filme des morts-vivants, se porte comme un charme. Comme quoi certains maléfices peuvent apporter de gros bénéfices.
©Sergio Belluz, 2018, le journal vagabond (2018).
La Carton cartonne!
Ce matin, j’ai terminé ‘Les Théâtres de carton’ de la fabuleuse Pauline Carton, à qui son physique de duègne renfrognée, son timbre acide, son débit cancanier et son humour second degré ont valu tous les plus beaux rôles de bigote cul-pincé, de régente hautaine, de gouvernante qui-ne-dit-rien-mais-qui-n’en-pense-pas-moins, de voisine malveillante, de rosière vieille fille du répertoire, et notamment chez Sacha Guitry, qui la casait dans presque toutes ses pièces et tous ses films, mais aussi dans une multitude de productions où même pour une apparition de cinq minutes, elle arrive à charmer et à faire rire.
Personnellement, j’adore la voir et l’entendre dans Le ‘Mot de Cambronne’, Désiré’ ou ‘Le Trésor de Cantenac’ de Guitry, et dans ‘Toi c’est moi’, l’opérette filmée sur une musique du Cubain Moisés Simons où elle ose un « 'Etrange et douce chose/Je vois la vie en rose' » qui est une merveille de décalage :
C'est dans le même film qu'elle s’est rendue célèbre avec l’immortel duo des Palétuviers :
« Aimons nous sous les palé
Prends-moi sous les létu
Aimons-nous sous l’évier »
VIVE LA PANOUILLE !
Ces 'Théâtres de carton’ c’est un hommage affectueux, drôle, touchant au théâtre populaire, vécu de l’intérieur, l’équivalent – en beaucoup plus talentueux, quand même – du ‘Je suis gugusse, voilà ma gloire’, les mémoires de Micheline Dax, l’inoubliable voix française de Miss Piggy, du Muppets Show, grande amuseuse, grande chanteuse d’opérette et grande siffleuse aussi
On y suit Pauline Carton dans sa carrière de comédienne et dans des tournées théâtrales passant par toutes sortes de lieux improbables, avec les petites gloires et les grandes misères des comédiens de troupe, qui doivent jouer Racine dans les endroits les plus bizarres et dans des conditions artisanales, quand ils ne font pas pleurer Margot avec d’invraisemblables mélodrames à coups de théâtre que des incidents techniques ou des blancs inopportuns transforment en farce, ou quand ils ne feignent pas, pour épater le provincial, la grande vie de la haute bourgeoisie parisienne dans des décors et des costumes improvisés avec le bric-à-brac à disposition :
« – Puisque vous voulez un décor gai, nous dit le chef machiniste d’un patelin près de Montauban, je peux vous donner un très bel intérieur de boucherie, avec des bêtes ouvertes et des charcuteries qui pendent.
Ce décor gai, nous l’avions demandé pour une pièce bien parisienne, où une jeune mariée se couchait, pudiquement, au IIe acte, dans un lit Louis XV, aux accents lointains d’une valse langoureuse.
Pauvre mariée ! Je ne sais pas pourquoi, en somme, nous avons mis tant d’énergie à refuser que la combinaison boucherie servît d’abri à sa nuit de noces. Dans quels décors affolants ne se coucha-t-elle pas, l’infortunée ! Nous l’avons vue se mettre au lit, successivement, dans une salle d’école, dans une sombre galerie du XVIIe siècle connue sous le nom de « Molière », dans des salons bleus élimés, dont la toile s’effilochait ; et devant de mystérieux amalgames de colonnades et de jardins peints, pour l’éternité, sur d’inreculables murs de pierre. »
TOUT ÇA C'EST CINEMA ET COMPAGNIE
Drôle, précis aussi, tout un portrait de théâtreux sympathiques et de la vie de bohème, avec un passage très intelligent et très juste sur le cinéma muet, quand le cinéma ne se prenait pas encore trop au sérieux :
« Tous les personnages gambadant sur les écrans d’alors, fantômes charmants propices à nos rêves, nous venaient de tous les pays, parés de leur seule grâce plastique. Aucune de leurs voix, jamais, ne venait frapper nos oreilles tendues, et, pourtant, ils ne cessaient visiblement de se raconter mille histoires, en remuant les lèvres comme des possédés.
De loin en loin, une des phrases censées dites surgissait en lettres imprimées.
Par exemple : un monsieur à tête d’assassin, tout en vociférant en silence, secouait les épaules d’une femme, la traînait par les cheveux, l’étranglait à moitié, lui présentait un couteau, et l’on était admis à lire, en blanc sur noir, sur le calicot à tout faire :
- ‘Je ne me contiens plus’ (état d’esprit dont on commençait à se douter).
D’autres fois, des textes allongés remplaçaient des scènes loupées. Alors on voyait une dame à plume dire gaiement un mot visiblement de trois syllabes, et passant pour articuler : - ‘Certainement, Monseigneur, après avoir démoli la porte de la lampisterie, le malandrin a dû revenir... » (Etc.). »
©Sergio Belluz, 2018, le journal vagabond (2018)